-
Il y a un certain temps maintenant sortait le premier film d'une nouvelle franchise adaptée de romans adolescents. Nouvelle poule aux œufs d'or pour le studio Lionsgate, Hunger Games se payait même le luxe de réunir l'excellente Jennifer Lawrence et le trop rare Woody Harrelson. Seulement voilà, malgré un background qui semblait intéressant dans les dix premières minutes, le film accumulait les tares et finissait par se vautrer dans une niaiserie trop commune. Recruté pour la suite, le réalisateur de Constantine, Francis Lawrence, avait la lourde tâche de faire mieux, chose ô combien difficile vu le matériel de base. Avec ce second volet, intitulé L'embrasement, le ton est donné.
Alors que Katniss a remporté avec Peeta les derniers Jeux en refusant de s'entretuer, elle est involontairement devenue un symbole pour les districts opprimés par le Capitole. De plus en plus de personnes se levant contre l'autorité établie, le président Snow décide de rappeler directement à l'ordre la vainqueuse avant sa tournée de "triomphe". Malheureusement, malgré les menaces, la chose tourne court et rapidement des nouveaux jeux "exceptionnels" sont organisés. Katniss et Peeta se retrouvent de nouveau confrontés à la brutalité de l'arène.
Hunger Games 2 est l'archétype du film, et même plus loin, d'histoire, qui se fiche de son public/lectorat. Mais pourquoi ? Premièrement parce que pendant près d'une heure, le film brasse du vide, avec deux seuls axes : les Districts vont se révolter car Katniss a fait naître l'espoir et Katniss est traumatisée d'avoir tué. Le résultat est d'une lourdeur et d'une répétitivité... Katniss crie puis pleure puis re-crie (elle fait des cauchemars faut dire) et au final va ENFIN assumer son rôle de symbole à contre-cœur (Oui, du JAMAIS vu au cinéma, JAMAIS, quel coup de théâtre !). A côté, le président Snow vient rappeler ce qui s'est passé à la fin du premier et faire le méchant très très méchant, pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi. On retrouve des personnages connus, Haymich qui...ben qui boit et Peeta qui est toujours aussi...tête-à-claques (au-delà de son nom d'association de défense des animaux, il est un peu le Edward de Katniss...a moins qu'il ne soit Jacob ?). Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait que le film n'a rien à dire de neuf, tous les éléments, absolument tous, ont déjà été vu dans le précédent et il ne fait que rabâcher encore et encore dans la longuuuuuuue attente que les districts se révoltent. Alors bien entendu, on a le droit à la séquence d’exécution sommaire par les militaires pour insister sur le côté totalitaire de la chose, quelque fois qu'on aurait pas tout à fait compris. Mentionnons au passage la cohérence des sanctions dans l'univers de Hunger Games : lever la main en sifflant comme un symbole de mécontentement = une balle dans la nuque, agresser physiquement un commandant militaire = coups de fouet. A ce rythme, tuer le président sera passible de fessée.
Mais passons car il y a bien d'autres choses à dire puisqu'intervient ensuite une nouvelle séance de jeux (absolument pas prévisible d'ailleurs) donnant à Katniss et Peeta l'obligation de recombattre...Avec la rencontre des autres candidats...et les auditions...et le défilé....Ce qui fâche totalement avec ce second volet, c'est qu'en fait c'est un Hunger Games bis. Exceptées la toute fin et les durées relatives, on a droit à la même trame scénaristique. Les districts et les conditions de vie horribles - la sélection - la parade - les auditions - l'arène. Voila. C'est génial. Pour que ce soit moins voyant, on a changé des choses, exit les novices, que des experts... et une nouvelle arène. Ce qui ne change pas, par contre, ce sont les jeux. Copie éhontée à la base du principe de Battle Royal, les Jeux voient de jeunes gens (et même une vieille d'ailleurs,mais faut dire qu'elle remplace la petite black pour le côté émotion) s'entretuer joyeusement. Enfin, il faut le dire vite. Un ou deux morts puis hop, 2 équipes et voilà. Oui. Au moins Battle Royale était ultra-fun. Ici, c'est surtout une séance hardcore de Koh-Lanta. Incapable de construire un jeu de roulette russe efficace entre humains, il faut faire appel à des pièges. Jusqu'à une troupe de babouins enragés...(Soupir). On passera aussi sur le gaz toxique lavable à l'eau (qui vaut bien la crème réparatrice express d'une blessure profonde du premier volet) et au milieu de ça bon, y'a des morts (non pas le spectateur, pas encore).
Le gros soucis de beaucoup de films récents made in Hollywood, c'est de faire mourir des personnages dont, en gros, on a rien à faire. Après la reine de Thor, voici donc la fille camouflée dont on ne sait rien qui meurt. Super. C'est un peu comme si on avait introduit Ned Stark en 30 mn dans l'avant-dernier épisode de Game of Thrones avant de le décapiter dans le même épisode. On en aurait rien eu à faire non plus. Tout tombe à plat parce que tous les personnages importants ne peuvent pas mourir (ben oui, y'a une suite quoi!) et que les nouveaux sont introduits avec une vitesse épatante. "Bonjour, vous voulez m'apprendre à faire des hameçons ? Moi je vous entraîne à l'arc !" "Oui le mec au torse huilée aime beaucoup cette vieille dame". Bim. Morte. Okay...Bon ensuite, pique-nique sur la plage ? Le principal problème des jeux, c'est que c'est immensément chiant. Là où Battle Royal était ultra-jouissif, le besoin d'édulcorer le contenu pour les adolescents rend le tout affligeant de nullité. Hunger Games 2 finira enfin sur un cliff, en fait c'est un peu l'unique bonne chose du film, vous allez attendre 2h20 pour ça et vous en profiterez 7 minutes.Voilà. Au revoir, à l'année prochaine. Sérieusement...
De même, certaines tares du premier subsistent, surement dû au matériel de base d'ailleurs. On retrouvera le Capitole où tout le monde s'habille en drag queens, ce qui risque, forcément, de gravement crédibiliser la science-fiction auprès du grand public. Mais aussi le même manque de finesse dans la situation : le Capitole c'est LE MAL, les districts (donc les pauvres) c'est le BIEN. Idem, ça fait deux films que l'on se demandent pourquoi depuis près de 70 ans les Districts ne se révoltent pas tous d'un coup vu que, sans eux, pas de nourriture, pas d'énergie...Après le Capitole peut tous les tuer mais c'est un peu hautement improbable. Et ça l'est toujours là... Mais mais !!!! Attention, il reste aussi le triangle amoureux. Attention, prenez une grande inspiration ! Etttttttttt Top : Katniss aime Gale mais en fait elle doit faire semblant d'aimer Peeta pour que l'illusion tienne et que ses parents ne meurent pas tuer par Snow (Le président, pas Jon), donc elle embrasse Gale dès qu'elle le revoit et Peeta aussi, mais c'est pour de faux, pourtant loin de Gale pour les jeux, elle tombe amoureuse de Peeta qu'elle ne doit PAS aimer, ben oui elle a un copain, Gale, mais Peeta est beau malgré son regard de homard et en plus il vient dans les jeux LUI, alors que Gale dort sur une table de cuisine pour trois coup de fouet, donc en fait son faux-amour devient un vrai-amour mais son vrai-vrai amour est resté en arrière et on sait pas qui elle va choisir. Ouffff. Ça vous rappelle quelque chose en gros ? Un indice, ajoutez un loup-garou et un vampire qui brille ? Bon. Inutile de dire à quel point c'est assommant de niaiserie et de prévisibilité (même si un instant on croit qu'elle va se taper Finnick, le mec qui frime torse nu mais non, c'est la femme de deux hommes, pas de trois, faut pas déconner).
La réalisation de Lawrence n'a en soit rien de désagréable et Jennifer Lawrence assure le show (malgré quelques grosses séquences de surjeu...), sans compter le fait que Philip Seymour Hoffman a rejoint le projet (Il avait des facture à payer certainement), Hunger Games 2 est d'une médiocrité harassante. Au fond, ce qui est le plus insupportable depuis ces adaptations de franchises pour adolescents, entre Harry Potter et Twilight, c'est qu'à chaque fois elles croient inventer la roue. Pour Hunger Games, c'est peu ou prou pareil. Le grand thème de l'oppression du peuple pauvre par les riches est vu et revu (et surtout récemment avec l'excellentissime Snowpiercer qui est VRAIMENT noir et qui sublime son idée de départ) en meilleur d'ailleurs bien souvent. De même, l'idée de télé-réalité aussi, l'arène avec la forme de son dôme n'est pas sans rappeler un certain Truman Show. Le pire semble être le message de l'histoire qui incite les gens à réfléchir sur l'illusion qu'on leur sert pour ne pas voir les vraies choses importantes alors que le film fait la même chose dans sa non-originalité et sa frilosité. Un beau paradoxe.
Finissons-en donc, puisque Hunger Games n'embrasera pas grand monde à part la niche classique d'adolescents en quête de sensations. Plat, répétitif à souhait, chiant et à la limite de l'escroquerie (on vous donne 2h20 de Hunger Games bis) , le film ne convainc franchement pas.
Jennifer, retourne au cinéma indépendant ou de qualité, vite !
Note : 2.5/10
Meilleure scène : La révélation de fin (pas dur...)
Meilleure réplique : Tu peux rester dormir avec moi ? votre commentaire
votre commentaire
-
S'il existe bien un duo magique dans le monde de la bande-dessinée française que l'on apprécie particulièrement, c'est celui de Ronan Toulhoat et Vincent Brugeas. On les avait découverts en 2010 avec une oeuvre aussi colossale que géniale : Block 109. Déclinée en série (6 tomes à ce jour), cette uchronie apocalyptique sur fond d'affrontement entre la Russie Soviétique et l'Allemagne Nazie avait su épater son monde. Après un crochet par le monde de Chaos Team (dont on reparlera prochainement), les deux compères se sont lancé un tout nouveau défi. Oubliez le monde moderne, leur dernière oeuvre s'intitule Le Roy des Ribauds et nous entraîne au XIIème siècle. Friands d'histoires et de détournements plus ou moins extravagants, les deux français nous livrent cette fois une bande-dessinée rude, haletante mais surtout passionnante.
Nous sommes en l'an de grâce 1194. Le roi Philippe Auguste de France craint la survenue d'un attentat sur sa personne, d'autant plus qu'il doit accueillir ses alliés teutons. Pour le protéger, il peut compter sur un personnage de l'ombre, un certain Triste Sire, qui contrôle en sous-main une bonne partie des affaires de la capitale grâce à ses compagnons d'armes, les Ribauds. Malheureusement, sa position ne va pas sans quelques risques. Lorsqu'un commerçant s'en prend à sa fille, le Triste Sire perd son sang froid et l'assassine. Le problème, c'est qu'il agissait en tant qu'informateur du roi et que celui-ci, fou de rage, réclame la tête de ses assassins. D'autant plus que l'homme connaissait l'identité d'un ennemi terrible n'attendant que le bon moment pour frapper sa majesté.
Scindé en six chapitres, Le Roy des Ribauds nous plonge avec une facilité insolente dans le nouvel univers de Toulhoat et Brugeas. Utilisant son cadre médiéval au mieux de ses possibilités, l'ouvrage renoue avec le charme du premier Block 109 en jonglant avec l'histoire avec un grand H et les fantasmes délicieux des auteurs. Inspiré par des éléments plus ou moins véridiques (à en croire la post-face), Le Roy des Ribauds choisit d'explorer une époque troublée où le roi Philippe Auguste fait face à la menace latente de l'Angleterre. Paris occupe donc une place tout à fait centrale dans l'ouvrage, et l'on ne s'en plaindra pas, tant la cité se trouve magnifiquement illustrée et employée. Entre basse-fosse et cour royale, la ville des Lumières a certes une cathédrale en trop pour l'époque (Notre-Dame n'étant pas encore achevée en réalité), mais elle a également un charme fou à revendre. C'est là le premier succès du Roy des Ribauds.
Le second, c'est bien évidemment ses protagonistes tous plus charismatiques les uns que les autres. En premier lieu, le fameux Triste Sire au design tout à fait génial mêlant bestialité renfrognée de vieux bandit et regard calculateur de chef de bande. Son personnage, génial de bout en bout, reste bien évidemment l'attraction numéro un. Mais il sera également épaulé par un certain nombre de seconds rôles savoureux, à commencer par le belliqueux Glaber ou l'étrange roi Philippe Auguste, un jeune souverain aux allures de vieillard dégageant une aura de puissance impressionnante à chacune de ses apparitions. Une des plus belles trouvailles (que l'on espère retrouver par la suite), c'est également le Hibou... mais on vous laisse le découvrir. Evidemment, à ce stade vous l'aurez deviné, ce qui permet à tout ce beau monde de prendre vie, c'est le trait de Ronan Toulhoat.
A l'instar de son excellentissime travail sur Block 109, Toulhoat nous offre des planches dantesques et une tripotée de designs inspirés. Du Hibou au Triste Sire, en passant par Richard Cœur de Lion, son dessin reste toujours aussi succulent. Allié à l'écriture fluide et intelligente de Vincent Brugeas, le résultat s'avère aussi passionnant qu'admirable. Même si l'intrigue semble un peu maigre au départ, elle s'étoffe rapidement et met en place ses pions. Comme tous les premiers volumes, il s'agit ici plutôt d'installer l'univers tout en happant le lecteur. Deux choses tout à fait réussies par les français. Les amateurs de policier seront aux anges, tout comme les aficionados de capes et d'épée, dans ce récit mené tambour battant qui nous entraîne dans les intrigues de rues et de palais. L'envie clairement affichée de créer une histoire de l'ombre pour une période historique fameuse laisse envisager de beaux développements par la suite. Espérons simplement que le succès soit une fois de plus au rendez-vous !
Nouvelle réussite pour le tandem Brugeas - Toulhoat avec Le Roy des Ribauds. Malgré un premier tome destiné à mettre en place leur univers et leurs personnages, les deux hommes s'en tirent plus qu'avec les honneurs en dépeignant avec talent une période passionnante de l'histoire et en y ajoutant un certain nombre de personnages savoureux. Ajoutez-y un récit un peu linéaire mais franchement efficace, et vous obtenez une bande-dessinée des plus réussies. Vivement la suite !
Note : 8/10Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
La comédie populaire. En France, le genre est, disons-le franchement, sinistré. Écrasé par la médiocrité de l'abrutissante production lambda de l'industrie du cinéma français, la comédie populaire serait presque devenu un synonyme de médiocrité. Après des films aussi affligeants que Bienvenue chez les Ch'tis ou Rien à déclarer, à peine du niveau d'un téléfilm, il ne restait plus grand choses à se mettre sous la dent. Pire encore, même le duo Toledano/Nakache a perdu de sa superbe avec Samba. Qui pouvait donc succéder à Intouchables ou Nos Jours Heureux ? Certainement pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?, film faussement insolent qui enchaîne les gags aux sous-entendus racistes pour faire rebelle (mais qui ne l'est absolument pas au passage). Malgré le sentiment cruel de voir un pan tout entier du cinéma français mourir à petit feu, voici que l'on découvre Papa ou Maman, de l'illustre inconnu Martin Bourboulon. Bande-annonce cruelle, postulat de départ original et casting attirant, le long-métrage a de sacrés atouts à faire valoir. Un nouveau pétard mouillé ?
De quoi parle au juste Papa ou Maman ? Eh bien de divorce tout simplement, un des thèmes les plus rebattus autant dans les drames que dans les comédies. Difficile dès lors de trouver la chose excitante... sauf que le long-métrage imagine un couple, Florence et Vincent, qui ont décidé d'un commun accord de leur séparation, en oubliant un détail : les enfants. Lorsque les deux parents se retrouvent face à une offre d'emploi à l'étranger, l'optique d'obtenir la garde de leurs charmants bambins n’apparaît plus aussi enthousiasmante qu'auparavant ! Dès lors, une seule solution, dégoûter leur propre progéniture pour qu'elle n'aille pas habiter avec eux. Là, tout de suite, les choses deviennent autrement plus originales et enthousiasmantes. Surtout que contrairement à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, Papa ou Maman va au bout des choses et propose des situations vraiment, mais vraiment borderline.
Irrévérencieux du début à la fin, le premier long-métrage de Martin Bourboulon est un régal de gags cruels et sadiques. Il n'épargne rien, ou presque, aux trois enfants du couple qui sont en plus décrits comme d'authentiques gosses du XXIème siècle, c'est-à-dire accrochés à leurs portables ou leurs tablettes, totalement antipathiques et d'une vulgarité à toute épreuve. Les voir prendre très cher arrive donc à procurer une sensation de plaisir coupable totalement jubilatoire pour le spectateur. On sent d'ailleurs que Bourboulon, comme ses deux acteurs, s'y donne à cœur joie, et cette énergie débordante rejaillit sur l'ensemble du métrage, lui insufflant une force véritablement débordante. De la scène d'ouverture aussi turbulente que maîtrisée, jusqu'aux nombreuses séquences de pétages de plombs parents-enfants, Papa ou Maman accumule les scènes cultes et les répliques cultes. Le réalisateur français ne se donne aucune limite (ou presque) et pousse le petit jeu très loin, en prenant bien soin de ménager un petit temps de suspense avant chaque méchanceté s'apprêtant à tomber sur les enfants du couple. Ce petit temps de latence laisse le spectateur faire appel à son imagination en s'attendant au pire... pire qui se produit bien souvent. Emmener sa fille de 12 ans dans un club de strip-tease, tirer sur ses enfants à bout portant au paint-ball, insinuer que l'autre pourrait se suicider en l'absence de tel ou tel enfant... la liste des réjouissances est longue. Pour le coup, oubliez le politiquement correct, bienvenue dans la pure impertinence. Le genre de petites choses qui font un bien fou dans cette époque cinématographique sclérosée par une certaine image proprette de la relation parent-enfant.
Papa ou Maman peut, au-delà de son enchaînement de gags tous plus méchants les uns que les autres (bien que parfois surréalistes), compter sur deux acteurs splendides. Laurent Lafitte en père prêt à tout d'un côté, et Marina Foïs en mère roublarde et revancharde, parfaite de bout en bout et qui fait franchement plaisir à revoir à un tel niveau. Mieux, l'alchimie entre les deux fait mouche dès le départ, l'insolence de l'un et de l'autre s'intrique et magnifie le couple atypique qui s'affronte par enfant interposé. Ils sont formidables, leurs talents naturels jouant énormément à la fois dans le quota sympathique du film mais également dans le côté crédible de cet enchaînement de coups bas. Le long-métrage a également ceci de remarquable qu'il se joue de certains clichés éculés (le médecin qui couche avec son infirmière, le vieux patron d'entreprise misogyne) en les réutilisant de façon intelligente, à l'occasion d'une scène embarrassante à l'hôpital ou pour un dîner très spécial. Bourboulon se révèle là bien plus malin que l'ensemble de ses collègues cinéastes. D'autant plus malin quand il fait correspondre cette petite guerre entre parents à la recherche d'une passion sauvage perdue au fil du temps. Malgré une fin un tantinet trop gentille et un poil attendue, Papa ou Maman offre un beau plaidoyer sur la nécessité de combattre la routine, et ceci d'une façon véritablement déroutante.
Magnifique surprise, Papa ou Maman redore le blason terriblement terni de la comédie populaire grâce à un humour grinçant, à une insolence omniprésente, mais surtout à la volonté d'aller au bout de sa démarche. Grâce à la magie de Marina Foïs et Laurent Lafitte ainsi qu'au talent de mise en scène de Bourboulon, Papa et Maman s'affirme comme une éclatante réussite à peine entachée par une fin un tantinet policée.
Assurément la meilleure comédie française depuis un bail !
Note : 9/10
Meilleures scènes : Le paintball - Les claques - la nouvelle maison - le bar... et tellement d'autres
Meilleures répliques :
- Vas-y, nique lui sa mère au niakwé !
et
- Si tu l'épouses, je te jure que je me drogueSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
![[Critique] Les nouveaux héros](http://ekladata.com/A5T3LRZOa5eZYaoyxju9svuOV9A@500x667.jpg)
Oscar Meilleur film d'animation 2015
Visiblement, l'académie des Oscars aime toujours autant Disney après toutes ces (nombreuses) années. Après la Reine des Neiges, c'est Big Hero 6 (miraculeusement traduit par Les nouveaux héros en France, what else ?) qui vient d'être sacré meilleur film d'animation aux Oscars. Réalisé par le tandem Don Hall et Chris Williams (qui n'ont jusqu'ici pas vraiment brillé chez la firme aux grandes oreilles), le long-métrage bénéficie du rachat de Marvel par Disney, puisque c'est la première fois qu'un métrage est adapté (librement certes) d'un comic book signé Marvel. Outre l'hommage appuyé aux Avengers, la principale caractéristique de ce nouveau film d'animation, c'est de se situer dans un univers japonisant où la ville de San Francisco est devenue San Fransokyo. Bourré de promesses, Les nouveaux héros bénéficie en outre d'un capital sympathie indéniable dès ses premières images. Est-ce seulement suffisant ?
Le jeune Hiro Hamada participe en toute illégalité à des combats de robots. Petit surdoué de l'informatique et des technologies, il se fait de l'argent en pariant sans vergogne sur des affrontements qu'il sait gagnés d'avance. Aidé par son frère Tadashi Hamada, il agace profondément sa tante qui l'élève seule au milieu de la gigantesque San Fransokyo. Pour tenter d'attirer son frère ailleurs que dans la clandestinité, Tadashi essaie de l'introduire dans son monde, c'est à dire l'université où il étudie. Immédiatement captivé par ce qu'il voit et les personnes qu'il rencontre, Hiro relève le défi de construire un projet qui sera à même d'impressionner le directeur de l'université, le professeur Callaghan. Pourtant, Hiro n'est pas encore au bout de ses surprises, puisqu'il découvre le projet de son frère, un robot d’assistance médicale nommé Baymax. Entre le concours et l'étrange Baymax, Hiro aura fort à faire pour parvenir à ses fins !
Big Hero 6 est, sur le papier, un des projets d'animation les plus excitants qui soient. Dès les premières images, impossible de ne pas tomber sous le charme de cet univers atypique où le monde occidental entre en collision avec l'univers japonais. San Fransokyo s'avère un régal pour les yeux. Cela non seulement parce que son esthétique est une éclatante réussite mais aussi, et surtout, parce que l'animation de Big Hero 6 fait figure de petite merveille à la fluidité sans égale. De bout en bout, le long-métrage file des étoiles dans les yeux. Un autre point fort du film, c'est de tenter de reprendre certains codes japonais (les combats de mechas, la fratrie de jeunes héros...) et c'est précisément ici que les défauts du film commencent à se voir. Pourquoi ? Parce qu’exceptée cette atmosphère japonisante, le potentiel de l'univers manga n'est jamais utilisé, jamais les deux réalisateurs ne vont au bout de leur démarche et ne tentent de sortir des sentiers rebattus du Disney traditionnel. D'un coup, la beauté plastique laisse apercevoir les lézardes de l'ouvrage.
Évidemment, Big Hero 6 se suit sans déplaisir aucun, l'aventure est rythmée avec son lot de gentils gags et de protagonistes hauts en couleur. Du fait, difficile de le qualifier de mauvais film. Le principal problème, c'est qu'il n'arrive jamais à être un vrai bon film comme pouvait l'être la Reine des Neiges. La faute à son manque cruel d'originalité au-delà de son environnement. On se rend rapidement compte que Big Hero 6 est un pompage quasi-honteux de tout ce qui se fait ailleurs. La relation entre Baymax et Hiro, tout d'abord, qui semble étrangement se rapprocher de celle de Croc Mou et Harold, avec une phase où l'un apprivoise l'autre. Même si ce n'est pas un total plagiat et si le duo est forcément l'élément le plus sympathique du film, la chose est agaçante. Surtout quand Big Hero 6 remporte l'Oscar devant... Dragons 2. Mais soit. Ensuite, toute la trame scénaristique est cousue de fil blanc, on s'attend à tout ce qui va se passer. A un tel point que le retournement de situation arrive tellement de façon maladroite qu'il est impossible de le rater. Le manque de subtilité du scénario détruit une bonne part de l'histoire.
Enfin, et c'est peut-être le plus gênant, la sempiternelle morale Disney noyée de bons sentiments revient encore et encore. D'un côté la firme oublie les chansons niaises, de l'autre elle nous refourgue une double dose de bons sentiments que seuls les enfants pourront vraiment apprécier. A aucun moment l'adulte ou même l'adolescent ne pourra se sentir réellement concerné par l'entreprise. C'est d'autant plus dommage qu'il était certainement possible de faire quelque chose de plus ambitieux à partir du postulat de base et de cette équipe de nerds super-héros. Si seulement Pixar l'avait pris en main...
Ne nous trompons pas pour autant, Big Hero 6 reste un moment de divertissement honnête et plastiquement parfait, mais il n'arrive jamais à atteindre ce qu'il prétend être dans son pitch de départ. Un pétard mouillé.
Les nouveaux héros, pour lui redonner une fois son titre français, a peut-être une forme splendide mais il oublie au passage toute l'originalité qu'il aurait pu offrir, cela de son scénario jusque dans son univers franchement sous-exploité. Sa consécration aux Oscars a de quoi laisser perplexe quand on sait que Dragons 2 lui était déjà infiniment supérieur et que Le Conte de la princesse Kaguya ainsi que, surtout, le truculent Boxtrolls n'auraient pas eu à rougir d'empocher la statuette. Reste un bon divertissement notamment pour les plus jeunes, mais qui ne restera certainement pas dans les mémoires.
Note : 7/10
Meilleure scène : Baymax tente de soigner Hiro de sa dépression
Meilleure réplique : "C'est la puberté !"Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 3 commentaires
3 commentaires
-
![[Critique] American Sniper](http://ekladata.com/QRfDcVKP0U6uaCpGEJjvFs0Le3U@500x741.jpg)
Nommé Catégorie Meilleur Film Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleur Acteur pour Bradley Cooper Oscars 2015
Véritable carton outre-Atlantique, American Sniper a également soulevé la polémique. Initialement dans le giron de Steven Spielberg, le long-métrage a atterri dans les mains de Clint Eastwood, un autre monstre sacré. Basé sur le livre autobiographique de Chris Kyle, le fameux American Sniper en question, le récit narre la vie d'un soldat de l'armée américaine (plus précisément un SEAL) qui va devoir concilier vie de famille et guerre. Clint étant réputé pour un être un républicain convaincu et le véritable Kyle encore davantage, le long-métrage partait déjà avec une aura sulfureuse pour tous les opposants à l'hégémonie US. Nonobstant ces quelques réserves, le film s'est imposé comme le plus gros succès d'Eastwood aux Etats-Unis... de quoi lui ouvrir la voie des Oscars. Nommé en Meilleur film et en Meilleur acteur pour Bradley Cooper grimé en Chris Kyle, American Sniper a pourtant reçu un accueil beaucoup plus tiède (pour ne pas dire froid) des critiques presses. Qu'en est-il réellement ?
Mettons d'abord les choses au clair concernant le versant politique de l'entreprise. American Sniper raconte la vie d'un sniper US texan convaincu de la supériorité de la nation américaine et totalement dévolu à sa cause. Le film étant basé sur une autobiographie, inutile de dire que le message patriotique et l'amour des USA sont bien présents. Mais c'est un peu logique tout de même. Reprocher à American Sniper d'être un film pro-américain, c'est comme reprocher à un film de Michael Moore d'être anti-américain, ça n'a aucun sens. Reste que le message sur la guerre en Irak et l'interventionnisme dont le film ferait l'apologie ont été montés de toutes pièces. Clint Eastwood est peut-être un républicain mais il était fermement opposé aux interventions américaines dans le monde, cela se ressent d'ailleurs dans le métrage, où Kyle se retrouve bouffé par la guerre, revient broyé psychologiquement dans son pays et surtout où sa femme Taya ne cesse de lui/nous expliquer à quel point ce qu'il fait ne sert à rien en définitive (un didactisme des plus agaçants et sans conviction au passage). Non, en fait, on aurait préféré que Eastwood se positionne clairement, parce que là au moins, on aurait eu un film un tant soit peu brûlant. En l'état, American Sniper accumule d'énormes défauts.
Du fait de cette position timorée qui ne sait jamais clairement où il se trouve, alternant les moments où Kyle se bat contre les terroristes irakiens pour sauver les siens et les interludes où il rentre chez lui pour constater qu'il perd pied vis-à-vis de ses proches, Eastwood ne veut ni trancher ni adopter une position neutre avec une certaine conviction. De ce fait, tout ce qui pourrait être puissant dans le film devient soporifique. Parce qu'à côté de ça, la vie de Chris Kyle est loin d'être aussi passionnante que celle de Hawking ou Turing, c’est même tout le contraire. Difficile d'éprouver une quelconque empathie pour un redneck texan avec un QI proche de 0 lorsqu'il s'agit de penser par lui-même. Eastwood doit quand même décrire un personnage sans nuance ou presque, incapable de penser à autre chose qu'à son pays. Le réalisateur tente de lui rendre hommage en donnant quelques passages plus émotionnels à Kyle (tout l'arc avec sa famille) mais la chose est déjà tellement vue et revue que le résultat rate le coche.
C'est bien là l'autre immense souci du film de Clint : il n'invente rien. Absolument tout ce qui se trouve dans American Sniper a déjà été vu ailleurs en mieux, et même en bien mieux. Prenons le sujet de la guerre en Irak et du traumatisme psychologique pour les soldats envoyés là-bas, des films comme Démineurs de Bigelow ou Jarhead de Mendès en parlent autrement mieux que ne le fait le dernier Eastwood. On ne parlera même pas de la mini-série Generation Kill. Côté politique, c'est un peu la même chose, et ce n'est en fait même pas le but du film tant les choses ne sont qu’effleurées. Il ne s'agit pas tant pour Eastwood de montrer les Irakiens comme des sauvages que le fait qu'il n'a absolument pas le temps de parler du reste de la population. Même sur le versant du terrorisme, les choses sont expédiées pour nous servir un réchauffé médiocre de l'affrontement entre deux snipers style Stalingrad de Jean-Jacques Annaud. Mentionnons au passage que le comble dans ce duel, c'est que Mustafa a plus de charisme que Kyle. Ce dernier, interprété par un Bradley Cooper décevant au possible, reste un personnage tout à fait antipathique mais avant tout ennuyeux. On ne tombe jamais dans la fascination perverse à la John Du Pont de Foxcatcher, personnage tout aussi antipathique mais tellement fort que passionnant au bout du compte. C'est à peine si Cooper versera une larme pour tenter de s'attirer notre compassion.
Le pire c'est qu'à la fin, Eastwood revient sur un sujet déjà plus intéressant, à savoir comment se réintégrer à la société une fois démobilisé et comment un homme atteint du syndrome du sauveur peut surpasser sa condition en aidant d'anciens combattants. Mais voilà, la chose est gérée sur dix minutes à tout casser, avant une conclusion abrupte qui verse dans l'hommage sur fond de bannière étoilée. Que reste-il dès lors à sauver ? Même le côté film de guerre déçoit ! Les phases d'action, même si elles restent filmées de façon décente, n'ont rigoureusement rien de mémorable, à peine pourra-t-on sauver le dernier affrontement en plein milieu d'une tempête de sable. Si vous voulez véritablement voir une bataille moderne, tournez-vous vers l'excellentissime Black Hawk Down. Non, décidément, Eastwood fonctionne encore en mode automatique et livre une copie insipide dont on ressort dubitatif avec une question en tête : à quoi sert ce film ? A rien...
American Sniper est une immense déception. Loin d'être le brûlot politique que l'on nous a vendu (il faut bien faire sensation pour attirer), le dernier Eastwood n'a ni conviction, ni punch, ni message, ni acteur solide, ni scène mémorable, ni aucune once d'originalité. Cela commence à devenir récurrent chez Clint, mais depuis le splendide Lettres d'Iwo Jima (tellement mais tellement meilleur), l'homme n'a cessé de chuter de son piédestal.
Ce serait une pure honte que le film remporte les Oscars... En attendant, regardez plutôt Zero Dark Thirty.
Note : 4/10
Meilleure scène : La tempête de sable qui frappe le dernier affrontementSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 2 commentaires
2 commentaires
-
![[Critique] Une merveilleuse histoire du temps](http://ekladata.com/OCqD23eMAxLWsNLHz60oLz_xEcM@500x667.jpg)
Meilleur Acteur pour Eddie Redmayne BAFTA 2015
Meilleur Film britannique BAFTA 2015
Meilleur scénario adapté BAFTA 2015
Meilleur Acteur pour Eddie Redmayne dans un drame Golden Globes 2015
Meilleur Acteur pour Eddie Redmayne SAG Awards 2015
Meilleur Acteur pour Eddie Redmayne Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleur Actrice pour Felicity Jones Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleur Scénario Adapté Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleur Film Oscars 2015Les biopics sont rois pour cette cérémonie des Oscars 2015. La preuve avec la présence de pas moins de quatre longs-métrages de ce genre en course pour le titre du meilleur film, pas moins ! Après Imitation Game autour de la vie d'Alan Turing et avant l'arrivée d'American Sniper retraçant celle de Chris Kyle, ou de Selma qui reparle d'un certain Martin Luther King, voici Une merveilleuse histoire du temps du britannique James Marsh. Outre son titre français abominable (faut quand même en avoir pour renommer The Theory of Everything de cette manière), le long-métrage s'intéresse à un des esprits les plus brillants de notre époque : le physicien Stephen Hawking. Adapté d'un livre (encore), Une merveilleuse histoire du temps retrace le parcours d'un homme à la destinée hors du commun. Pour interpréter ce rôle très difficile, c'est le jeune Eddie Redmayne (déjà aperçu dans l'excellentissime Black Death) qui reçoit la lourde responsabilité de porter le film sur ses épaules. Couronné aux BAFTAs en tant que meilleur film, le long-métrage a aussi fait une razzia sur les prix pré-Oscars pour, justement, la prestation de Redmayne. Un grand film pour autant ?
A Cambridge, dans les années 60, un jeune étudiant va connaître une fulgurante ascension. Fasciné par la physique et l'univers quantique, Stephen Hawking va rapidement s'affirmer comme un immense génie. Malheureusement, derrière l'intelligence extraordinaire de cet homme se cache une terrible réalité, celle de la maladie. Frappé de plein fouet par une affection terrible connue sous le nom de Maladie de Charcot (ou Sclérose Latérale Amyotrophique) qui détruit les motoneurones de la moelle épinière et, à terme, rend la victime totalement paralysée. Aidé par l'amour inconditionnel de sa femme, Jane, Stephen va traverser les pires épreuves. Pourtant, les choses ne seront pas simples et même la plus grande des histoires de cœur peut faillir devant l'érosion du corps. En quête de la théorie qui expliquera tout, Stephen Hawking devra aussi trouver un nouveau sens à sa propre existence.La comparaison entre Imitation Game et Une merveilleuse histoire du temps est inévitable. Les deux films parlent de deux génies scientifiques atypiques et aux parcours remarquables. Cependant, ils abordent les choses d'une façon tout à fait différente. Le métrage de Marsh fait un choix radical en se concentrant sur la vie intime du scientifique ainsi que sur la relation entre Stephen et sa femme, Jane. C'est aussi, il faut l'avouer, le point le plus contestable du récit puisque si vous veniez tenter d'appréhender les travaux d'Hawking... il va falloir aller voir (lire) ailleurs. Une déception certes mais justifiée par le résultat final. Une merveilleuse histoire du temps met en lumière avant tout un combat de titan, celui d'un couple contre la fatalité, contre la maladie. Dès lors, Marsh se débrouille vraiment bien et se tient toujours en équilibre précaire sur un fil étroit où guette le mélodrame guimauve. Même s'il tombe à quelques reprises dans ce piège épineux, le britannique s'en sort extrêmement bien en misant davantage sur une mise en scène enthousiasmante. Il ne s'agit certainement pas du meilleur film de cette année, comme l'ont un peu trop surestimé les BAFTAs, mais on tient là une réalisation de qualité qui enrobe parfaitement le travail des acteurs.
Parce qu'en réalité, Une merveilleuse histoire du temps est avant tout un grand numéro d'acteur. Evidemment, on citera la talentueuse Felicity Jones, parfaite en femme forte et tendre, mais c'est surtout le jeune Redmayne qui va faire parler. Taillé pour les Oscars, son rôle n'a pourtant rien de superficiel. Disons-le plus simplement : il est extraordinaire. Il faut tout de même un sacré talent pour mimer un malade atteint de SLA et parvenir à représenter de façon parfaite sa lente et inexorable dégradation physique. Plus encore que ses membres s'immobilisant, Redmayne accomplit un travail épatant sur sa voix et ses expressions faciales. Une chose d'autant plus remarquable qu'il ressemble réellement au véritable Stephen Hawking. Il n'a vraiment pas volé sa nomination pour la statuette. Ce grand numéro pousse le film bien plus haut qu'Imitation Game, où Cumberbatch restait bon mais très peu original dans sa prestation. Ici, Redmayne porte le film sur ses épaules, et il a une carrure de titan malgré son jeune âge. Il peut certainement remercier Marsh pour son excellente direction d'acteurs (au contraire des Wachowski dans Jupiter Ascending où il est.. .on en reparlera...).
L'autre grande réussite du long-métrage, c'est donc bien sa façon d'appréhender la maladie en jonglant tout à tour avec la compassion du spectateur et son admiration. Bien loin des deux années qu'on lui prédisait, Hawking a bravé tous les obstacles pour vivre. Le paradoxe tient un peu dans cette résistance miraculeuse et le travail d'un homme qui cherche à comprendre le temps et l'univers. Le film ne se mouille pas quant à la position à adopter sur l'existence de Dieu, mais il montre avec un certain talent que tout ne peut pas s'expliquer et que, autant de temps que l'homme vivra sur Terre, certaines choses ne s'expliqueront pas. De ces petits mystères qui bâtissent les légendes et donnent de la poésie à une vie souvent bien cruelle. On appréciera enfin la tentative certes timide mais bien présente de lancer une réflexion sur le tourbillon du temps, avec une séquence finale qui rembobine à la façon d'un trou noir et aspire les émotions pour revenir au fondamental : l'amour entre deux êtres. Un autre grand mystère qui peut soulever des montagnes, et certainement une des choses les plus touchantes du film.
Bien que davantage porté sur l'histoire de Jane et du couple Hawking, Une merveilleuse histoire du temps fait certainement un choix judicieux en ne tentant pas de plonger dans la complexité de la physique (on doute que Marsh aurait eu les épaules pour une telle entreprise). Au lieu de ça, il mise sur une dimension humaine et poignante, véritable déclaration d'espoir à tous les malades et hommage à tous ceux qui souffrent, proches compris. Une belle petite surprise.
Note : 8/10
Meilleure scène : Jane qui avoue à Hawking ses sentiments
Meilleure réplique : Exterminate !Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 1 commentaire
1 commentaire
-
![[Critique] Imitation Game](http://ekladata.com/HFiMBaZBg7Y_ku3VK5qEzREOaAA@500x740.jpg)
Nommé Catégorie Meilleur Film Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleur Réalisateur Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleur Acteur pour Benedict Cumberbatch Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleure Actrice dans un second rôle pour Keira Knigthley Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleur Scénario Adapté Oscars 2015
Nommé Catégorie Meilleure Musique Oscars 2015Contrairement à beaucoup d'idées reçues, la seconde guerre mondiale ne s'est pas gagnée que sur le terrain. Derrière les divisions et les grandes batailles se trouvaient également d'autres combats, moins dangereux certes, mais tout aussi cruciaux. Parmi ceux-ci, celui des Britanniques pour casser le fameux Code Enigma, un cryptage d'une efficacité redoutable qui permettait aux Allemands de communiquer sans se soucier de l'espionnage allié. Pour relever ce défi, les agents de la couronne réunirent quelques-uns des esprits les plus brillants du royaume, parmi lesquels un certain Alan Turing. Mathématicien de génie, l'homme n'est pas des plus reconnus lorsqu'il s'agit de s'intégrer parmi ses pairs. Pourtant, grâce à son aide, les alliés arriveront à dominer le secteur de l'espionnage. Loin de devenir un héros, Turing va connaître une fin des plus ignominieuses liée à un secret encore inavouable à l'époque en Angleterre.
Imitation Game représente le tremplin international (et hollywoodien) du réalisateur norvégien Morten Tyldum. Inconnu hors des frontières de son pays d'origine, il a jusqu'ici eu les honneurs douteux de sorties directement en DVD. Biopic 4 étoiles emmenant des acteurs reconnus tels que Keira Knightley ou Benedict Cumberbatch, le long-métrage propose un des sujets favoris de l'académie des Oscars, à savoir le parcours d'un homme hors du commun oublié par l'histoire. Pourtant, au vu de l'expérience toute relative de son réalisateur et des nombreux pièges qui guettent lors de la réalisation de ce genre de films, Imitation Game fait figure de défi un peu casse-gueule. Plébiscité pendant la période faste des récompenses pré-Oscars, le film a également réussi à empocher un sacré nombre de nominations pour la course à la précieuse statuette dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur ou encore meilleur actrice dans un second rôle. Mais au fait, le film est-il aussi bon que l'annonce la rumeur ?
Pour clarifier immédiatement les choses, Imitation Game est une fiction historique. Inspiré du livre d'Andrew Hodges, le récit auquel on assiste durant les deux heures de film reste en fait assez romancé et grandement sujet à controverse, principalement sur la personnalité de Turing et sur les détails exacts de l'entreprise. En l'état, il faut donc prendre l'histoire racontée avec des pincettes. D'une des principales divergences autour du comportement du mathématicien, découle un des principaux défauts du film. Malgré l'affection que l'on porte à Benedict Cumberbatch et à la qualité de son jeu, l'idée de présenter Alan Turing comme une sorte de Sheldon bis gâche un tantinet la chose. On assiste dès lors à un certain nombre de scènes et de rebondissements convenus qui voient le mathématicien se faire accepter par les autres. Quand on sait qu'en plus cette vision du scientifique est très contestée, on se demande si c'était réellement une bonne idée. Mais passons. Imitation Game fait donc le pari du film d'histoire et, sur ce plan, réussit en grande partie à atteindre ses objectifs.
Tyldum montre comment la guerre de l'ombre a permis aux alliés de remporter le conflit (même si la chose est un peu exagérée ici ou là) et raconte un volet passionnant de cette période tumultueuse. On suit dès lors avec un grand plaisir le challenge fou de cette équipe atypique qui aboutira à rien de moins qu'une révolution technologique. Intellectuellement parlant, et pour qui s'intéresse un peu à cet aspect de l'histoire, Imitation Game reste un film passionnant. Il l'est d'ailleurs d'autant plus lorsqu'il dénonce avec virulence le motif de la mise au ban de la société d'Alan Turing, permettant d'aborder un sujet grave et douloureux qui méritait certainement que l'on remette les pendules à l'heure. Un des petits soucis qui émaille cette partie, c'est la volonté d'intégrer des images de guerre entre les deux pour faire plus réel. Si l'on peut encore trouver les images d'archives en noir et blanc pas forcément mauvaises, les petites séquences en images de synthèse sont elles d'une laideur consommée. Une énorme faute de goût pour Tyldum.
C'est à ce point que l'on se rend compte que le réalisateur n'a peut-être pas encore les épaules pour une telle entreprise. Non seulement sa mise en scène manque cruellement de personnalité mais, en plus, l'imbrication de son intrigue laisse dubitatif. Le film est séparé artificiellement en trois fils narratifs : le premier (et le plus important) sur l'entreprise de Turing et de ses acolytes pendant la guerre, le second fait des flashbacks sur l'adolescence du mathématicien et le dernier explique la fin de sa vie. Le choix d'intriquer celui-ci en plein milieu des deux autres coupe gravement le rythme et fait intervenir une narration bien moins passionnante que les autres événements. Du fait, on se retrouve souvent à patienter pour rattraper un fil narratif différent. Pire encore, la révélation sur le "secret" de Turing intervient de ce fait bien trop tôt et gâche un peu l’ambiguïté du personnage. Dommage.
Heureusement, ce défaut n'empêche pas le long-métrage d'adopter un rythme à même de maintenir éveillée l'attention du public. De même, la prestation du casting assure également une fluidité à l'action, même si c’est parfois des acteurs secondaires tels que Keira Knightley ou le trop rare Matthew Goode qui volent la vedette à Cumberbatch. Finalement, le principal talon d'Achille du film, c'est la timidité de son réalisateur ainsi que la volonté clairement affichée d'être un "film à Oscars". Très académique dans sa réalisation et parfaitement attendu dans son message, Imitation Game s'avère un film très sage et assez policé avec une performance d'acteur de qualité mais loin d'être inoubliable. Le manque de prises de risques en fait en réalité un long-métrage intéressant mais sans envergure. Le genre de choses qui devrait, en toute logique, le faire passer à côté des récompenses suprêmes... surtout avec les compétiteurs qui se trouvent en face de lui.
Pour son premier grand essai à Hollywood, Morten Tyldum n'a pas forcément à rougir du résultat puisque Imitation Game se regarde sans déplaisir et possède un certain nombres de qualités indéniables. Malheureusement, son académisme et quelques défauts irritants empêchent le long-métrage de se hisser dans le haut du panier. Reste un agréable moment de cinéma porté par une brochette d'acteurs inspirés.
Note : 7.5/10
Meilleure séquence : Joan retrouvant Alan dans sa maison dans les années 50Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le nombre d’œuvres légendaires du non moins légendaire William Shakespeare a permis à l'écrivain de s'imposer durablement dans les esprits. Hamlet, Othello, Songes d'une nuit d'été, MacBeth...autant de classiques qu'on ne présente plus. Si l'on devait finalement désigner le récit le plus connu de l'anglais, nul doute qu'on pourrait tomber d'accord sur Roméo et Juliette. Quintessence du drame romantique paru en 1597, Roméo et Juliette s'est imposé comme un classique à travers les siècles, adapté sous tous les formats. Pourtant, en 2015, que pensez d'un récit qui apparaît comme un des plus gros "clichés" qui soit, à savoir l'amour impossible d'un homme et d'une femme que tout sépare ? Shakespeare est-il encore aussi formidable à la lecture près de quatre siècles plus tard ?
La réponse est oui, et même trois fois oui. Le lecteur plonge tête la première dans l'existence de deux familles d'aristocrates de Vérone, les Capulet et les Montaigu. Toujours prêt à se nuire l'une à l'autre, elles ne s'attendent pas à ce que l'impossible se produise, que deux de leurs membres tombent amoureux l'un de l'autre. D'un côté, Roméo, l'héritier du patriarche Montaigu, de l'autre Juliette, unique héritière des Capulet. Cette histoire, archi-connue à l'heure actuelle, n'a cependant rien de rédhibitoire. Mythe fondateur d'une grande part du romantisme moderne, Roméo et Juliette constitue aussi une tragédie flamboyante et fascinante. Même si l'histoire n'est en réalité pas novatrice - Tristan et Yseult étant déjà passés par là - Shakespeare puise dans son génie consommé de conteur pour transcender les limites de son récit.
Ce qui permet à Roméo et Juliette de rester toujours aussi puissant à l'heure actuelle, outre son universalité, c'est avant tout le style d'écriture de William Shakespeare. Avec ses jeux de mots, ses rimes ou encore son sens inné du rythme, la pièce acquiert une puissance hors du commun. L'anglais ose tout, alternant monologue passionnant et déclamations ardentes de deux âmes éprises l'une de l'autre. Oubliez ce que vous croyez savoir de la désuétude des dialogues, si certains sont d'un cliché qui pourrait faire grincer des dents ( "O Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom ; ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet."), ils prennent une toute autre envergure insérés dans le récit, constamment magnifiés par la langue mirifique d'un Shakespeare au sommet de son art. Rien que pour celle-ci, Roméo et Juliette est un chef d'oeuvre intemporel.
Plus loin que le simple aspect formel, c'est la dénonciation en règle de la stupidité humaine qui rend Roméo et Juliette si poignant. Tout le tragique de la pièce tient, au fond, dans l'entêtement maladif des deux familles pour se sauter à la gorge, et cela à la moindre occasion. Brillamment orchestré par Shakespeare, la guerre de clans entre Capulet et Montaigu est aussi passionnante que dénuée du moindre sens, l'écrivain décrivant avec brio comment des personnes, même de bonne éducation, arrivent à s'étriper et à causer les pires drames pour des choses aussi triviales et abstraites que l'honneur ou le respect. Parmi tous les absurdes conflits que se livrent les deux familles, la pureté et la grandeur d'âme de Roméo et de Juliette les rendent presque anachroniques. Oasis de lucidité sauvés par l'amour, les deux personnages seront pourtant tout du long esclaves d'un destin qui les poursuit sans relâche. Maudits par leur nom et par leur propre chair, Shakespeare leur refuse l'amour et les mène au drame, entre les mâchoires d'une destinée finalement impitoyable.
Reste une dernière question essentielle pour le lecteur français, celle de la traduction. Comme avec La Nuit des Rois, on constate qu'il est primordiale d'acquérir la pièce de théâtre dans une traduction de qualité supérieure pour pleinement apprécier son contenu. Dès lors, l'édition magnifique, mais chère, de la Pléaide parait la plus appropriée. Bilingue, avec une foultitude de notes et une présentation exhaustive de la pièce, elle comprend en outre plusieurs autres œuvres de Shakespeare. Il s'agit donc d'un investissement, mais de par sa qualité exceptionnelle, l'achat s'avère tout à fait justifié.
Classique parmi les classiques, summum de l'amour romantique et incarnation flamboyante du drame Shakespearien, Roméo et Juliette trouve toujours sa place parmi les récits les plus passionnants de l'histoire de la littérature. Oubliez ce que vous pensez en savoir et jetez-vous dessus.
Note : 9.5/10
Voilà ton or, pire poison pour l'âme des hommes,
Commettant plus de meurtres en ce monde écœurant
Que ces pauvres mixtures qu'on t'interdit de vendreLivre lu dans le cadre du challenge Morwenna's List du blog La Prophétie des Ânes
 votre commentaire
votre commentaire
-
![[Critique] Les ascensions de Werner Herzog](http://ekladata.com/4cMoube2fwhPiESnOOhmjzZYTBI.jpg)
Cinéaste désormais légendaire, Werner Herzog n'est cependant pas connu uniquement pour ses long-métrages. Loin de là même. Il est aussi un maître ès documentaires reconnu. Dans le cadre d'une rétrospective récente, les cinéma Majestic ont eu la bonne idée de projeter deux moyens-métrages documentaires rassemblés sous le nom "Les ascensions de Werner Herzog". A l'intérieur, le spectateur aura le bonheur de visionner La Soufrière datant de 1977 et Gasherbrum, la montagne lumineuse de 1984, deux documentaires qui ont en commun de s'intéresser à des montagnes (plus exactement deux montagnes et un volcan). Un bon moyen de découvrir Herzog sans passer par la face nord.
Le premier documentaire nous transporter en 1976 sur l'île de la Guadeloupe. La Soufrière est sur le point d'entrer en éruption selon tous les spécialistes. Ainsi, les 75000 habitants de Basse-Terre ont été évacué en attendant l'inévitable catastrophe. Tous ? Non, pas tous ! Quelques irréductibles guadeloupéens ont refusé de partir. Surpris par ce courage insensé, Werner Herzog décide de se rendre sur place pour aller à leur rencontre alors que le volcan menace d'exploser d'un instant à l'autre. La Soufrière est un document étrange. En fait, Herzog le reconnait d’ailleurs lui-même, il s'agit d'un témoignage sur une catastrophe inéluctable qui n'est jamais arrivée. Quel est dès lors l’intérêt de ce reportage ? D'abord de nous montrer une ville morte, totalement déserte avec une ambiance de fin du monde étrange et cotonneuse dans l'ombre d'un Dieu en colère, le dieu volcan. Les images de Basse-Terre sont saisissantes mais c'est finalement l'interview des quelques habitants résolus à rester qui fait beaucoup. On y découvre des noirs démunis et d'une fatalité à toute épreuve. Herzog interpelle face à la misère d'hommes qui n'ont rien et ne voient pas la différence de partir ou pas, puisqu'il ne change pas leur destin. La non-catastrophe alertera d'ailleurs les autorités sur la pauvreté et la détresse de la population noire de Guadeloupe. Au milieu, Herzog nous apprend également le pourquoi de cette peur panique en nous narrant la catastrophe de l'éruption du mont Pelée en 1902. A faire froid dans le dos. Arrivé au bout, le document laisse une étrange sensation. On s'attendait à une catastrophe volcanique et puis...rien. Reste que La Soufrière est une expérience aussi courte que surprenante, filmée avec le talent coutumier de Herzog. Une curiosité.
Pour le second document, Werner Herzog choisit de suivre l'expédition des alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander. Les deux hommes ont décidé d'enchaîner l'ascension successive de deux sommets de la chaîne Himalayenne culminant à 8000 mètres d'altitude, le tout sans camp de base. L'immense intelligence d'Herzog dans Gasherbrum, la montagne lumineuse, c'est d'éviter de nous entraîner dans un énième suivi d'une ascension montagneuse. L'allemand choisi de porter son attention sur un élément bien plus subtil et important : la motivation des alpinistes. Qu'est ce qui fait qu'un homme peut décider d'affronter une telle tourmente ? La pulsion de mort ? L'envie de mourir ? Ou bien plutôt une irrépressible envie de vivre, de se sentir vivant ? En focalisant son attention sur Reinhold Messner qui n'est alors qu'au début de sa carrière légendaire - le premier homme à avoir atteint tous les sommets de plus de 8000 mètres du monde - Herzog touche à l'humanité qui se terre derrière ces défis qui semblent insensés. Son document culmine lors de l'interview dans la tente de Messner où celui-ci en vient à parler de la mort de son frère sur le Nanga Parbat, il touche alors au plus près de la fragilité mais aussi de la force hors du commun de cet alpiniste hors norme. Une autre séquence marque par sa bonhomie et son décalage, et qui vous fera franchement sourire, c'est le massage du Pakistanais de Reinhold alors que celui-ci tente envers et contre tout de répondre à Herzog. Une tranche d'humanité et de pittoresque infiniment touchante. Même si le réalisateur allemand ne suivra pas l'ascension des deux hommes, il filme quelques images lointaines de l'entreprise, d'autant plus impressionnantes que l'on ignore le sort des explorateurs pendant un temps. Gasherbrum s'affirme en réalité non pas comme une entreprise physiquement éprouvante mais plutôt comme une dissection psychologique fascinante. Une petite pépite.
Malgré l'importance toute relative de La Soufrière, la présence de Gasherbrum dans Les ascensions de Werner Herzog permet d'inscrire le métrage dans la liste des indispensables. Court mais passionnant, cette oeuvre facile d'accès permettra à un certain nombre de spectateurs de découvrir une des voix les plus importantes du cinéma.
Note : 8/10
Meilleur segment : Gasherbrum, la montagne lumineuse
Meilleure scène : L'interview sur la perte du frère de Messner
Meilleur réplique : "Je ne pense pas qu'un homme qui voudrait se suicider entreprenne même l'ascension d'une montagne" votre commentaire
votre commentaire
-
![[Critique] Les nouveaux sauvages](http://ekladata.com/87762WNF68nQ1pf5R2p4S31X_00@500x669.jpg)
GOYA Meilleur film étranger en langue espagnole 2015
Nommé Catégorie Meilleur Film en langue étrangère Oscar 2015
Festival de Cannes 2014
Sous le patronage de Pedro Almodovar, l'argentin Damien Szifron a créé la surprise dans le petit monde du cinéma. Présenté sur la Croisette cette année, son premier long-métrage intitulé Relatos salvajes (Les nouveaux sauvages en français) n'a pourtant rien de l'académisme recherché par les festivaliers. Comédie à sketchs grinçante, l'oeuvre de Szifron se divise en six segments de durées inégales portant chacun sur des personnages et une histoire différente. Mais contrairement à un film comme Infidèles, chaque récit est façonné par le même réalisateur. En découle forcément une plus grande homogénéité de propos d'une part, et de mise en scène d'autre part. Le métrage fut un tel succès critique qu'il a même reçu une petite consécration, celle de se retrouver nommé dans la catégorie meilleur film étranger des Oscars 2015 aux côtés de Timbuktu, Léviathan, Tangerines ou Ida. Ce petit délice sauvage pourra-t-il vraiment plaire à tout le monde ?
Les nouveaux sauvages s'ouvre sur le plus petit des segments de l'ensemble, à savoir Pasternak. Dans celui-ci, Szifron immerge directement le spectateur dans son univers caustique. Il arrive à faire virer avec une grande dextérité une discussion anodine mais sérieuse dans un grand n'importe quoi hilarant, mais surtout jouissif. Le ton est donné et tout ira crescendo par la suite. Le pari de l'argentin est simple : dresser en six tableaux un portrait de notre société moderne et au milieu, des hommes étouffés par une sauvagerie refoulée n'attendant qu'un simple déclencheur pour émerger. Pourtant, au lieu de choisir une voie traditionnelle pour ce genre de choses, c'est-à-dire le drame, le réalisateur se lance dans 6 courts/moyens-métrages comiques mais avant toute chose, méchamment impertinents. Au-delà des gros éclats de rire que suscitent les situations successives, Szifron transgresse et démasque. Si Pasternak procure un gros frisson de jouissance initial (et inattendu), il reste cependant tout à fait anecdotique.La suite elle, devient nettement plus excitante. A partir de son second segment, Las Ratas, où une serveuse tombe par hasard sur l'homme qui a pourri sa vie, Szifron tend à affirmer son message social. La vengeance, déjà entraperçue auparavant, occupe une grande place dans Les nouveaux sauvages. Un acte de faible la vengeance ? Pas pour Szifron. Un acte de courage, un acte de rébellion. Comme cette cuisinière qui va faire tomber les barrières morales pour punir le puissant qui se croit intouchable. Le résultat, drôle au possible, renferme aussi sa part de subtilité. Bien entendu, à ce stade, on ne va pas chercher très loin, mais l'argentin continue à hausser le niveau avec El mas Fuerte qui délaisse ce message de vendetta pour transformer deux chauffards ordinaires, aussi médiocres que détestables, en véritables bêtes assoiffées de sang. La surenchère dans la violence n'est pourtant pas gratuite. L'argentin continue à explorer la bestialité qui se terre en chacun, même le plus costard-cravate de ses compatriotes. La fin de ce segment, juste géniale, n'oublie jamais l'énorme dose d'ironie nécessaire pour faire passer les choses en "douceur".
Après ces trois premiers récits, on tombe davantage dans le moyen-métrage. Le quatrième segment, Bombita, revient sur la vengeance et la désobéissance en centrant son récit sur un expert en démolition, à l'existence des plus banales, qui se retrouve piégé dans un vrai dédale administratif digne de Kafka. Mais au lieu de la résignation, l'homme va finir par exploser et canaliser sa sauvagerie pour faire tomber l'establishment. Sous des allures comiques, Szifron charge notre passivité et appelle à la révolte. Bien sûr, c'est drôle, mais c'est avant tout grinçant et jouissif. Jouissif dans le sens que cet homme ordinaire devient en quelque sorte extraordinaire et que l'on rêve tous de l'incarner, puisqu'on a tous été piégé un jour par ce genre de situation où les lois, l'administration et l'autorité se liguent en dépit de tout bon sens. Au fond, la grande victoire de ce segment, c'est bien de nous titiller comme il faut, car malgré sa prévisibilité, Bombita joue surtout sur notre irrépressible envie de rébellion dans un monde insensé.
C'est alors qu'arrive La Propuesta, le segment le plus réussi de ces nouveaux sauvages. Szifron renverse la vapeur et nous positionne du côté des méchants, des vrais. Il nous raconte la monstrueuse supercherie d'un homme riche pour sauver son fils qui vient de renverser une femme enceinte. Le récit est rageant, bien noir et avec cette dose d'ironie géniale qui le fait s’élever au-dessus de tous les autres. Le réalisateur argentin diminue le nombre d'éclats de rire dans la salle mais accentue drastiquement sa critique de la société moderne. Pouvoir de l'argent, corruption, inhumanité, tout y est. Au-delà d'une simple critique de la société moderne, le réalisateur livre ici une vision d'absolue noirceur de l'homme, prêt à vendre son âme à condition d'y mettre le prix. Si la réaction du patriarche acculé par un tas de requins plus retors les uns que les autres prête à sourire, on rit jaune au final devant cette cruelle réalité. Heureusement, Les nouveaux sauvages s'achève sur un récit un peu moins grave et bien plus délirant avec Haste que la muerte nos separe où la mariée découvre que son mari l'a trompée... le jour de son mariage. Le réalisateur prend alors un malin plaisir à déconstruire un des fondements de la culture moderne, tout en synthétisant les thèmes qu'il a mis en place tout du long : la vengeance, la bestialité et la transgression des normes. Un feu d'artifice en guise d'apothéose.
Au final, Les nouveaux sauvages se révèle tout aussi brillant sur le plan de la mise en scène pure et simple que sur celui de sa construction scénaristique. Drôle, impertinent, méchant, cynique et bourré d'excellentes idées, le film de Damien Szifron s'affirme comme une vraie réussite. On l'imagine difficilement remporter les Oscars, tant il semble décalé par rapport aux goûts très traditionnels de l'académie, mais il reste le meilleur challenger au Léviathan d'Andrey Zvyagintsev pour le moment.
Si vous souhaitez rire sans laisser votre cerveau à l'entrée de la salle, Les nouveaux sauvages est fait pour vous.
Note : 8.5/10
Meilleur segment : La Propuesta votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Regardez les étoiles

![[Critique] Le roy des ribauds, Livre 1](http://ekladata.com/_hIpGOdgQU4fp5jp640Br9rb96Q@500x682.jpg)
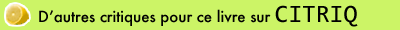


![[Critique] Papa ou maman](http://ekladata.com/aZsYAXFf5vXlSR_111JjggEYMYU@500x679.jpg)
![[Critique] Roméo et Juliette](http://ekladata.com/cVgGGKfpNmtOeGrCfE-FqPuUn3c@500x887.jpg)



