-
A peine sortis de Massada et de la première rencontre avec le Graal, Jesse et Cassidy font cette fois chemin vers la Nouvelle-Orléans après un bref passage par New-York pour retrouver une Tulip légèrement sur les nerfs. Conscient qu'il doit percer les secrets de Genesis, l'entité qui l'habite désormais, Jesse est prêt à toutes les folies (ou presque...) pour découvrir les vilains secrets de Dieu. Heureusement Cassidy connaît toujours un tas de monde dès qu'il s'agit des trucs un peu louche. Il demande donc à son ancien ami Xavier de pratiquer un rituel vaudou pour explorer les tréfonds de l'âme de Jesse. Ce qu'a oublié de dire le vampire irlandais par contre, c'est qu'il n'a pas que des amis à la Nouvelle-Orléans et qu'une secte d'apprentis-vampires, les Enfants du Sang, ne voit pas d'un bon œil le retour de Cassidy dans leur ville. Mais pire encore, un autre secret bien gardé de Cassidy risque de détruire le trio le plus déjanté de tout les temps...
Pour ce troisième tour de piste, Preacher entre dans un nouvel arc narratif : Dixie Fried. Après le grand feu d'artifice à Massada, Ennis et Dillon calment un tantinet le jeu en se recentrant dans un premier temps sur les retrouvailles de Jesse et Tulip, cette dernière ayant été laissé en arrière pour éviter qu'elle ne soit blessée dans la bataille. Forcément hautes en couleurs, les conséquences de cette "gentille" trahison de Jesse fait long feu et l'on s'amuse particulièrement de l'amour enragé de ces deux-là. Sauf que l'histoire introduit alors un nouveau bouleversement : Cassidy à Tulip son lourd secret. Nécessaire pour la suite de l'histoire (on y reviendra dans le prochain tome), ce retournement apparaît cependant comme relativement poussif et cliché. Le trio amoureux étant certainement l'un des poncifs les plus usés qu'Ennis pouvait nous sortir. Du coup, la déception s'invite pour la première fois dans la série. Heureusement, à côté des errements émotionnels de Tulip et Cassidy, il reste les tribulations de Jesse pour découvrir la vérité sur Genesis, le Saint des Tueurs et Dieu.
Les Enfants du sang, une secte ridicule au possible, remplace le Graal pour cet arc en apportant encore davantage de situations comiques, Ennis s'attaquant cette fois aux clichés qui entourent les vampires avec une joie non dissimulée. Il mixe tout ça avec un rituel vaudou qui tourne mal et de vieilles connaissances qui semblent en savoir long sur Cassidy. Le résultat tient en haleine et fait oublier la plupart du temps les geignements d'un Cassidy qui, du coup, apparaît bien moins charismatique qu'auparavant. L'action s'avère pourtant toujours au rendez-vous et le jusqu'au boutisme des deux auteurs également. Si l'on perd de vue Herr Starr et son organisation, on recroise le désopilant Tête-de-Fion, toujours aussi sympathique et pathétique, qui va par la suite permettre à Ennis de se foutre royalement du monde de la musique US.Ce troisième tome comprend également deux autres spin-offs : Saint of Killers et Cassidy : Blood and Whiskey.
Saint of Killers raconte l'histoire du Saint des Tueurs en laissant à Ennis l'occasion d'accomplir son rêve le plus fou : scénariser un vrai western burné (dans une veine plus "traditionnelle" que Preacher). Cette fois, Steve Dillon cède la place à Steve Pugh pour un trait plus râpeux et certainement plus daté qui sied à merveille au côté Far-West de l'histoire. On apprends enfin la vérité sur le Saint des Tueurs tout en faisant un détour par l'Enfer pour y découvrir un Diable un tantinet dépassé par les événements. Toujours aussi jouissif, le récit ne révolutionne pas le genre mais offre une petite ballade récréative et pétaradante au lecteur.
Cassidy : Blood and Whiskey replonge quant à lui dans la première rencontre entre Cassidy et les Enfants du Sang avant les événements de l'arc principal. Garth Ennis oppose sa vision du vampire à celle d'une Anne Rice ou d'un Bram Stoker pour se moquer ouvertement des clichés de la littérature à propos des seigneurs de la nuit. L'histoire d'Eccarius, authentique parodie d'Entretien avec un Vampire, s'avère hilarante de bout en bout grâce aux réponses cinglantes d'un Cassidy en grande forme. Peut-être le meilleur arc de ce troisième tome ou, tout du moins, le plus drôle et impertinent.
Malgré une petite déception liée au choix scénaristique de Garth Ennis à propos de Cassidy, Preacher reste une valeur sûre et arrive une nouvelle fois à tenir en haleine le lecteur. Les deux spin-offs qui accompagnent l'histoire principale ajoutent encore davantage de plaisir à cette lecture acidulée, faisant la lumière sur quelques recoins obscurs de l'aventure par la même occasion. Soyons rassurés, Preacher sent toujours la poudre, la drogue et le sang.Note : 8.5/10
Disponibles également aux Editions Panini :
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Convaincu par The Killing, MGM offre un budget confortable à Stanley Kubrick pour réaliser son prochain film. Le problème, c’est que le jeune cinéaste désire faire un film anti-militariste se déroulant durant la Première Guerre Mondiale. La MGM n’étant alors pas intéressé par un film de guerre, et encore moins par un film anti-guerre, le projet semble vouer à l’échec. Jusqu’à ce qu’un certain Kirk Douglas reçoive le script de Stanley Kubrick et se mette à soutenir le projet même si, selon lui, le film ne marchera pas en termes de recettes. Fort de ce soutien de poids, Kubrick entame donc le tournage des Sentiers de la gloire qui sort finalement dans les salles américaines en 1957.
Inspiré par des faits historiques, l’affaire des caporaux de Souain de mars 1915, Les Sentiers de la Gloire permet à Stanley Kubrick de revenir dans un domaine qu’il affectionne tout particulièrement : le film de guerre. Ce genre, qu’il n’avait pas approché depuis son Fear and Desire, lui permet de discourir sur des thèmes qui lui sont chers. Pour ce long-métrage, il nous raconte l’histoire du colonel Dax et de ses hommes du 701ième Régiment contraint par ordre de leur supérieur, le général Mireau, d’attaquer une position allemande réputée imprenable : Anthill. Malgré les réticences de Dax, celui-ci lance ses hommes à l’assaut et, évidemment, la forte résistance allemande cueille ses troupes en plein no man’s land. Le massacre est telle que la compagnie B, chargée de soutenir l’attaque, refuse de monter à l’assaut. Fou de rage, le général Mireau demande à ses propres batteries d’artillerie d’ouvrir le feu sur la compagnie B, indiquant qu’il s’agit de réprimer un acte de couardise et de traitrise. Le chef d’artillerie refuse et, devant l’échec de l’attaque, Mireau demande des sanctions à son supérieur, le général Broulard. Pour l’exemple, il faut fusiller 100 hommes du 701ième. Après maintes protestations, Dax arrive à faire réduire ce nombre à trois. Le caporal Paris, le soldat Ferol et le soldat Arnaud sont alors désignés pour être fusillés.
Ce sujet en or massif pour Stanley Kubrik lui permet enfin de révéler la pleine mesure de son talent. Fasciné par la guerre et par la folie humaine, Kubrick capture celle-ci avec une brillante acuité. Les Sentiers de la Gloire illustre la folie du général Mireau et, plus généralement, de la chaîne de commandement et de l’armée. Impossible de prendre Anthill, à moins d’être prêt à mourir comme un chien dans le no man’s land. Ce que les hommes de la compagnie B n’ont pas l’intention de faire, naturellement. En face, le général Mireau (et l’armée qu’il symbolise), est totalement en dehors des réalités. Pour tout dire, il est fou, aveugle et ne comprend pas ce qui se déroule devant ses yeux. Avec brio, Kubrik montre la folie totale de l’armée. On pourrait voir dans le métrage un plaidoyer contre la guerre, mais le cinéaste est plus fin. Il se sert des horreurs de la guerre, notamment à travers l’impressionnante séquence de charge dans le no man’s land par le Colonel Dax - où Kubrick utilise plusieurs caméras pour capturer tous les angles possibles - pour dénoncer la folie de la hiérarchie militaire et des puissants.
Profondément manichéen, Les Sentiers de la gloire ne souffre pourtant aucunement de ce manque de nuance. Tout simplement car il ne peut y en avoir vu les faits largement authentiques rapportés, mais aussi parce ce manichéisme illustre à merveille le propos anti-militariste du film. Il permet aussi à Kubrick de mettre en place des doubles, l’une de ses obsessions les plus profondes, avec le Colonel Dax et le Général Mireau. Le premier est aussi droit, moral et honorable que l’autre est vil, opportuniste et sans pitié. Si les deux hommes sont amenés à tant se détester au cours de l’histoire, c’est aussi parce qu’il se tende un miroir déformant l’un à l’autre symbolisant tout ce qu’ils détestent.
Cette charge anti-militariste s’accompagne d’une mise en scène prodigieuse. Très tôt dans le film, Kubrick étale son savoir-faire. Il suit d’abord le général Mireau en visite dans les tranchées, bien avant l’invention de la steady-cam, et nous convie dans un labyrinthe de boue, de sang et de folie. En quelques instants seulement, Kubrick capture toute l’essence de cette guerre de tranchées en faisant se balader un général propret et patriotique dans un enfer creusé par des hommes éreintés, épuisés et, pour tout dire, prisonniers. Pour peu, on se croirait à la fin du monde, dans les tranchées de l’Armageddon. Avec la maturité, Kubrick a appris à utiliser plus parcimonieusement les plans serrés sur ses acteurs. Lorsqu’il filme les trois soldats condamnés à mort, qu’il capture leur visage plein de peur, de larmes et de colère, cette fois, on est renversé. Renversé par le malheur de ces hommes, brillamment interprétés par Timothy Carey, Joe Turkel et Ralph Meeker. Chacun incarnant une réaction différente face à l’injustice : la peur, la colère, la résignation. La séquence de leur exécution restera l’un des points d’orgue du film.
Mais les Sentiers de la Gloire doit aussi beaucoup aux qualités de Kubrick en tant que directeur d’acteur. Kirk Douglas, déjà formidable à l’origine, y est parfaitement dirigé composant un colonel Dax inoubliable tant Kubrick l’immortalise sur pellicule comme une figure héroïque mais humble. Un homme capable de tout risquer pour sauver la vie de ses hommes et qui porte sur ces gueules cassées un regard attendri lors d’une scène finale carrément poignante. A cet instant, Kubrick réunit toutes ses qualités pour délivrer un message somme. Il nous montre des hommes aux instincts primaires beuglant dans un café, abrutis par la guerre et l’injustice, mais qui redeviennent humains par la chanson d’une allemande prisonnière, seule femme du film. Il capture alors les visages de ces anonymes qui ont fait la guerre et connaîtront pour beaucoup une mort inutile. Dax dévisage avec compassion ces types-là, avec plus d’humanité que tout le métrage n’en aura montré jusque-là.
Les Sentiers de la gloire représente la première consécration pour Stanley Kubrick.
Le film est si brillamment dérangeant qu’il sera interdit en France jusqu’en 1975 (soit pendant près de dix-huit ans !), en Suisse jusque 1970 et en Espagne jusqu’en 1986. Véritable charge anti-militariste, Les Sentiers de la gloire permet non seulement à Kubrick d’éclabousser de son talent le monde du cinéma mais également de lui ouvrir les portes d’Hollywood par l’intermédiaire de Kirk Douglas.
Pour le meilleur…et pour le pire.Note : 9.5/10
Meilleures scènes : L’exécution - La charge dans le no man's land - le caféSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 1 commentaire
1 commentaire
-
Premier film de Stanley Kubrick avec une équipe professionnelle et un véritable budget, The Killing (connu en France comme L'Utime Razzia) sort en salles en 1956, soit un an après Killer's Kiss. C'est grâce à la rencontre avec le producteur James B. Harris que le jeune cinéaste fonde sa première société de production dans le but de racheter les droits du roman Clean Break de Lionel White. Entouré par le scénariste Jim Thompson et par le vétéran Lucien Ballard à la photographie, Kubrick se lance dans sa première réalisation d'envergure. Influence avouée des dizaines d'années plus tard par Quentin Tarantino pour son Reservoir Dogs, The Killing raconte le braquage d'un champ de courses avec une efficacité narrative redoutable. Pourtant, c'est peut-être l'un des films les moins Kubrickiens qui soit.
The Killing amène Kubrick dans un genre qu'on attendait pas forcément : le film de braquage. Supporté par une véritable équipe technique et, surtout, de véritables acteurs, le long-métrage s'avère d'emblée plus impressionnant que les deux précédents. En fait, on peut voir The Killing comme une démonstration du jeune cinéaste américain lui permettant enfin d'accéder à la notoriété. Ce qui entraîne plusieurs choses. D'abord, on ne trouve pratiquement aucune des obsessions de Kubrick dans l'histoire - exceptée peut-être la folie de George Patty en fin de métrage. Ensuite, The Killing se révèle le film le plus lisse et le plus propre jusqu'ici de l'oeuvre de Kubrick. On sent que tout y est calibré et millimétré pour montrer la maîtrise du réalisateur sur le plan technique et narratif. Il n'y aura pas cette fois d'affrontement dans un entrepôt de mannequins ou de questions existentielles sur la mort et la culpabilité.
En lieu et place, Stanley Kubrick construit une histoire de braquage dont le déroulement narratif force le respect. En employant le flash-back à bon escient et, surtout, en exploitant les divers points de vues des participants au dit braquage, le réalisateur arrive à tenir son spectateur en haleine de bout en bout. Sorti du travelling d'entrée, la réalisation se fait efficace et fonctionnelle, oubliant les tâtonnements d'un Fear and Desire ou la course-poursuite d'un Killer's Kiss. Les personnages restent assez caricaturaux mais servent à merveille l'histoire, faisant de The Killing une vraie réussite sur le plan du divertissement pur. Au-delà de celui-ci, et malgré la maîtrise évidente de l'ensemble, difficile de trouver le métrage exceptionnel. C'est certainement là le revers de la médaille pour l'entreprise de Kubrick et Harris.
L’enchevêtrement des fils narratifs a cependant pour l'époque quelque chose d'impressionnant. La multitude de points de vues permet à Kubrick se s'amuser à reconstituer un fait unique, le braquage, avec plusieurs angles d'attaques. On pourrait presque parler de film choral à certains moments. La fin, quant à elle, a quelque chose de délicieusement ironique avec cette conclusion toute simple de Johnny "What's the difference ?". The Killing n'a donc qu'un intérêt mineur dans la filmographie du réalisateur américain en terme de cinéma pur. Il reste cependant son film le plus important du point de vue de la reconnaissance artistique. Il fait en effet forte impression sur la critique de l'époque ainsi que sur la MGM. C’est le début de la grande aventure pour Kubrick attendu sur les sentiers de la gloire.
Film mineur au retentissement majeur pour Stanley Kubrick, The Killing n'en reste pas moins un excellent film de braquage, conventionnel d'autant plus à l'heure actuelle mais maîtrisé de bout en bout et d'une efficacité narrative redoutable.Note : 6.5/10
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
![[Critique] Killer's Kiss (Le Baiser du tueur)](http://ekladata.com/10-8vqaQSYtSG_abmyZcEQzpnXU@555x847.jpg)
En 1995, Stanley Kubrick a 26 ans. Franchement déçu par son Fear and Desire, il décide d’emprunter la coquette somme de 40.000 dollars à son oncle pour financer son deuxième film. Si cela fait de Killer’s Kiss un métrage quatre fois plus cher que le précédent, il reste un (très) petit budget. Désireux de tout contrôler, Kubrick enfile la casquette de réalisateur, de monteur, de co-scénariste, de producteur et de directeur de la photographie. Ironie de la démarche, ce sera tout de même United Artist qui disposera du final cut et imposera une happy-end. Considéré par le cinéaste comme sa vraie première réalisation, Killer’s Kiss s’avère un film personnel…et classique à la fois.
Stanley Kubrick quitte l’univers de la guerre pour revenir dans un New-York des années 50 où un boxeur du nom de Davey Gordon fait la rencontre de sa belle voisine danseuse : Gloria. Les deux jeunes gens tombent rapidement amoureux au grand dam de l’employeur de Gloria, le gangster Rapallo. Ce dernier décide de tout mettre en œuvre pour empêcher le départ de la femme qu’il aime. Ce postulat archi-convenu renvoie évidemment aux films noirs de l’époque et n’offre malheureusement pas beaucoup plus que ce qu’il laisse entrevoir de prime abord.
Stanley Kubrick reprend Frank Silvera pour interpréter Rapallo – on l’avait déjà aperçu dans Fear and Desire sous les traits du sergent Mac – et offre le rôle féminin à Irene Kane. On s’aperçoit immédiatement que ce second film corrige les nombreux défauts de son prédécesseur. Kubrick dirige mieux ses acteurs, apprend à gérer ses plans et son cadre…bref, l’américain prend ses marques. Film noir classique et, pour tout dire, assez cliché, Killer’s Kiss n’explore que de loin les thèmes chers à Kubrick. Cependant, il permet à celui-ci de filmer un sport qu’il affectionne tout particulièrement : la boxe. En un sens, il reste toujours un peu de Kubrick dans l’histoire.
Côté réalisation, tout s’améliore grandement. Si Kubrick n’est pas un scénariste à la hauteur (il ne le sera plus jamais par la suite), il offre cependant une remarquable scène en fin de métrage : la poursuite entre Rapallo et Davey. Celle-ci utilise au mieux l’espace des ruelles New-Yorkaises puis s’envole vers les toits des immeubles avant de terminer dans une usine de fabrications de mannequins. L’atmosphère qui se dégage de la scène se révèle très particulière. Pour dire vrai, et pour la première fois, on sent un peu la patte du cinéaste américain. Dans cet affrontement, les corps artificiels sont massacrés, lancés, piétinés, écrasés. Comme autant de victimes collatérales innocentes et muettes. Il est d’ailleurs assez cocasse de constater que Kubrick semble parfois plus occupé à filmer ces mannequins de plastique anonymes broyés à la hache que les combattants eux-mêmes. C’est véritablement cette séquence qui tire le film vers le haut et permet de l'extirper de l’anonymat total.
Il faudra pourtant attendre encore, car, malgré toute la bonne volonté du jeune Stanley Kubrick, Killer’s Kiss reste un film noir banal, bien filmé et agréable à suivre mais dépourvu de l’ambiance narrative de son prédécesseur. Anecdotique en somme.Note : 5.5/10
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Longtemps introuvable sur le marché, Fear and Desire est le premier film d’un certain Stanley Kubrick. Tourné en 1953 avec un budget ridicule (pour ne pas dire inexistant) de 10 000 dollars, le long-métrage deviendra une source d’embarras pour celui qui sera appelé par la suite à devenir l’un des plus grands cinéastes du XXème siècle. Qualifiant lui-même ce premier film d’amateur, Kubrick a vainement tenté d’en détruire les copies en circulation. C’est en 2012 que le film ressort sur le marché et permet de se pencher sur l’œuvre de jeunesse d’un illustre inconnu à cette époque.
Très court, une heure au total, Fear and Desire n’est pas si dénué d’intérêt qu’on le clame souvent. Monté, joué et filmé en amateur il est vrai, le long-métrage s’intéresse à une troupe de militaires perdue en territoire ennemi. Accompagné d’une voix-off pesante, l’histoire prend place dans un lieu et une époque indéterminés, les soldats appartenant à des belligérants non identifiés. L’histoire reste assez simpliste puisqu’elle nous propose de suivre l’échappée des quatre hommes. On assiste à plusieurs rebondissements, notamment la rencontre avec une jeune femme et la découverte d’un quartier général non loin de la rivière.
Ecrit par un ami de Kubrick, Howard Sackler, Fear and Desire reste cependant intéressant dans la filmographie du réalisateur. Maladroit, le film l’est sans aucun doute. On relève un certain nombre de faux raccords, une tendance aux gros plans ennuyeuse et un montage hasardeux…mais qui tente quelques petites choses. En réalité, Fear and Desire porte en lui les germes d’un réalisateur qui se cherche. On sent que Kubrick tente de dégager des idées, notamment en saisissant dès que possible ses personnages en plan serré, comme pour capter leurs pensées, leurs démons intérieurs. De même, son cadrage étonne par son efficacité. De fait, même si Fear and Desire n’a rien d’extraordinaire, il présente déjà quelques marottes de l’américain.
On retrouve en effet un récit de guerre qui évoque déjà la noirceur d’un Full Metal Jacket, une fascination pour la folie qui s’incarne dans le jeune soldat chargé de garder la femme capturée ou encore un propos sur la violence prépondérant. En ajoutant l’idée simple de faire jouer les soldats ennemis par les mêmes acteurs que les personnages principaux, Kubrick affirme déjà une tendance à brouiller les pistes, à questionner le sens de la réalité ainsi que de la culpabilité. Ainsi, malgré la faiblesse générale de cette première œuvre, Fear and Desire apporte un propos noir quasiment poétique par moments (la voix-off du sergent sur le radeau ou celle du général se questionnant sur le lieu de sa mort) que l’on retrouvera bien plus tard dans la filmographie du cinéaste.
Amateur, Fear and Desire n’est pas en soi un film marquant, loin de là même. Il intéressera avant tout les spectateurs curieux des débuts d’un cinéaste hors pair. Au-delà des faiblesses du long-métrage, on y décèlera pourtant un propos pas si innocent et bien plus captivant qu’il n’y parait.Note : 4.5/10
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
![[Critique] Preacher, Tome 2](http://ekladata.com/gICynifUiyCjpGhpZg_8gfGItho@555x849.jpg)
Pour ce second tome toujours aussi volumineux, nous retrouvons le trio de Preacher - Jesse Custer, Cassidy et Tulip O'Hare - après les événements de l'arc All in the Family. Garth Ennis en ayant terminé pour le moment avec les origines de Jesse Custer et de sa diabolique famille, le scénariste peut s'employer à dévoiler une des grandes menaces autour de Custer : le Graal. Dans le premier arc de ce second tome, Hunters, Jesse et Tulip rejoignent Cassidy en Californie. Occupés à boire, baiser et casser des tronches, nos joyeux comparses ne se doutent pas un instant qu'Herr Starr, le bras droit de l'archipère d'Aronique, s'apprête à tout bouleverser. ce dernier fait parti d'une organisation secrète qui commande aux plus puissants de la planète : le Graal. Voyant en Jesse un nouveau Sauveur potentiel, Herr Starr va remuer ciel et terre pour le capturer. Autant dire que la folie maintenant bien connue de la série s'avère au rendez-vous.
Ennis ne change pas une recette qui marche en tissant avec toujours plus de fantaisie et d'impertinence les liens qui unissent le trio principal. Seulement, là où Tulip et Jesse constituaient le point de mire du précédent volume, c'est Cassidy qui va trouver cette fois une place bien plus importante en devenant, bien malgré lui, l'enjeu principal des deux arcs présentés ici. Avant de parler du vampire irlandais, disons quelque mots de la nouvelle création d'Ennis et Dillon : Le Graal. Toujours dans l'optique de parodier l'Eglise, les auteurs imaginent une secte de l'ombre qui ressemble fichtrement à une bonne grosse parodie dégénérée du Vatican et du Saint-Père. Puisqu'il s'agit de Garth Ennis, autant dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'organisation est dirigée par un gros porc boulimique ne rêvant que de placer un nouveau messie protégé par le Graal à la tête de l'humanité. Sauf que le messie en question est issu d'une longue tradition de consanguins attardés et qu'il est...légèrement débile. Avec son humour corrosif coutumier, Ennis place un allemand qu'on penserait échappé d'un vieux James Bond autant que d'un quartier général SS en tant que bras droit de l'archipère. Une façon assez drôle de rappeler les accointances de l'Eglise et de l'Allemagne à une certaine période de l'Histoire. Pour parfaire le tout, il s'amuse avec la sexualité du viril Herr Starr en ajoutant deux guignols dans l'histoire : les détectives du sexe. Bref, vous l'avez compris, Preacher ne s'arrange pas côté politiquement correct.En conservant son sens du dialogue qui claque et de l'insulte qui fait du bien, Ennis s'amuse donc à faire s'affronter le Graal et le trio de choc de Preacher. Et puisqu'on est à San Francisco, terre de débauche par excellence, autant y aller à fond dans les clichés. On fait donc la connaissance d'un certain Jesus de Sade (parfait oxymore quand même) qui organise une soirée pour le moins haute en couleurs durant laquelle tout ce beau monde se rencontre. Les nombreuses saloperies des invités s'avèrent tour à tour drôles, odieuses, insupportables et hilarantes. D'autant plus hilarantes quand Jesse et les autres décident d'y jouer les trouble-fêtes. Forcément, ça tire dans tous les sens, ça gicle, ça meurt bruyamment et de façon improbable...mais c'est surtout jouissif...comme d'habitude. Tout finit par une erreur d'appréciation d'Herr Starr qui présente par la même occasion Massada, la base opérationnelle du Graal, au lecteur.
L'arc suivant, bien plus conséquent, s'intitule Proud Americans. Garth Ennis plonge sans retenue dans l'organisation du Graal, présente les personnages débiles et savoureux du Messie et de Frankie, ainsi que les machinations d'Herr Starr pour prendre le pouvoir des mains de d'Aronique. Le numéro #18 offre cependant une parenthèse dans cette aventure et replonge un tantinet dans le passé de Jesse en expliquant l'histoire du briquet Fuck Communism du père du prêcheur. En parlant de la guerre du Vietnam, Garth Ennis fait des merveilles, arrive à faire passer un message plein de tristesse et de rancœur au milieu des excès habituels pour finir par une note sérieuse au sujet des soldats jetés dans l'enfer du Vietnam. C'est foutrement beau. S'ensuit alors 5 numéros d'aventures menées tambour battant où l'enjeu principal est Cassidy, préparant le terrain pour les deux derniers numéros. Ici, Ennis s'emploie à remettre Cass' au centre du trio d'origine, lui donnant l'importance qu'il mérite tout en s'amusant comme un petit fou des pouvoirs de régénération extraordinaire de notre vampire préféré. Il en profite également pour discourir sur le machisme ordinaire de Custer, un machisme pas si méchant que ça puisque motivé par l'amour et la peur de perdre Tulip. Une façon futé pour affirmer la force de caractère (et l'habilité à l'auto-défense) de Tulip.
Le scénariste finit par faire intervenir Le Saint des Tueurs, commence à relier les différentes histoires introduites précédemment et termine sur une note bien plus intimiste. Les deux derniers numéros, #25 et #26, raconte l'histoire de Cassidy. On sent ici bien davantage l'implication personnelle de Garth Ennis dans le récit, lui aussi d'origine Nord-Irlandaise. Il raconte la guerre civile de 1916 à Dublin, la futilité de la lutte et les nombreux loups qui se sont repus de la mort de jeunes garçons plein d'idéalisme. En mêlant Cassidy à la lutte pour l'indépendance, Garth Ennis finit de bâtir un personnage exceptionnel, à la fois habité par son sentiment de patriotisme bafoué mais, également, par l'horreur du temps qui passe. Devenu vampire, Cassidy traverse les époques, perd ses amis et connaît la solitude. Devant le ciel étoilé New-Yorkais, Cassidy et Jesse se font témoins du temps passé, jetant à New-York un Je t'aime plein de mélancolie et de tendresse. Cassidy trouve définitivement sa place dans l'aventure, et offre par la même occasion l'une des scènes les plus fortes du comic book. Ces fiers Américains aussi prompts à se foutre de la gueule des français que du passé peu glorieux de leur pays, ces fiers américains valent leur pesant d'or.
Avec ce second volume toujours aussi maîtrisé, bourré de folie, d'idées hilarantes (le chat et Cassidy, le Messie demeuré...), de sous-textes hérétiques et, forcément de vrais moments d'émotions, Preacher continue sa route sanglante et jouissive. Une immense et glorieuse réussite qui donne envie de boire du whisky et de monter tout en haut de l'Empire State Building.Disponibles également aux Editions Panini :
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Il arrive des jours comme ça où le temps est beau, les oiseaux chantent, les marmottes font leur toilette.
Des jours où tout semble aller bien dans le meilleur des mondes.
Innocents, insouciants, on va se faire un petit film au cinéma du coin. Titillé par la nostalgie des années 90, on prend un ticket pour la suite d'Independence Day, ce métrage signé Roland Emmerich sorti en 1996.
Alors, oui, il faut être d'une grande naïveté pour croire que l'homme qui a commis 2012 pouvait encore sortir un divertissement coupable et décomplexé correct avec des aliens et des grosses explosions. Mais on se dit que la vie peut être surprenante, qu'un jour Luc Besson finira par faire un bon film par erreur, que David Guetta prendra sa retraite, que Marc Levy se fera mordre par un castor enragé...bref, la réalité, c'est que la vie est une pute.
Nous sommes bien des années plus tard après le premier film. La Terre, grâce à l'invasion extra-terrestre déjouée par Will Smith et Jeff Goldblum - ainsi qu'un virus informatique révélant que les E.T tournaient sous Windows (c'est quand même con un alien) - a tiré les leçons de ses échecs. Unit dans un même objectif, et grâce aux épaves récupérées, la technologie humaine a fait un bon sidérant. Sauf que, manque de bol (et aussi parce qu'il fallait une raison à cette suite autre que "je dois me payer un nouveau jacuzzi"), les bestioles de l'espace reviennent. Avec un plus gros vaisseau, une plus grosse armée et une reine dirigeante mal lunée. David Levinson avertit encore une fois du danger tout comme l'ancien président devenu à moitié sénile et boiteux, Thomas Whitmore. Heureusement, des héros se lèvent à nouveau pour combattre l'ennemi en ce 4 juillet, jour emblématique (et pourri quand même) de cette uchronie.En effet, Independence Day : Resurgence est une uchronie. Le film part du postulat que les humains ont évolué bien plus rapidement que nous dans cette Terre alternative du fait de la technologie extra-terrestre laissée sur place après la grande défaite du 4 juillet. De ce fait, l'armée humaine dispose d'une base lunaire, d'un réseau de défense orbital et d'avions armés de laser qui font piou piou piou (Tu fais très bien le laser ! Merci ! Non mais vraiment je le pense). C'est certainement la seule et unique bonne idée du film. Le reste...comment décrire le reste...il faut être technique et pas vulgaire à la fois.
Certes, Independence Day premier du nom était un film bas du front, une ode à l'american way of life et à la suprématie US. C'était bourrin, très con parfois, mais c'était cool, attachant et souvent diablement épique.
Là...c'est autre chose.
Tout commence déjà avec les personnages. Concentré à 200% sur son fan service, le film offre à peu près toute la brochette des acteurs du précédent, à commencer par Jeff Goldblum et Bill Pullman. Mais pas Will Smith, qui n'était pas assez désespéré pour tenter l'aventure. Du coup, Roland Emmerich l'a remplacé par un acteur noir leader price (car il faut savoir que l'acteur noir est interchangeable) sans l'ombre du quart du centième de la classe d'un Will Smith. Ce Willus Smith va même avoir un pote avec qui il est fâché (ça met du piment à l'intrigue) en la personne de Jake Morrison interprété par Liam Hemsworth qui avait déjà joué auparavant dans Hunger Games (du lourd). Entre deux, la traditionnelle petite amie dont on ne souvient jamais du nom, un deuxième noir plus gros avec des machettes, parce que le quota de noirs dans les films Hollywoodien a augmenté depuis 1996, et Charlotte Gainsbourg. On ne sait pas ce qu'elle est venue faire là, elle non plus à priori vu son jeu d'actrice au cours de l'aventure, mais quelque chose nous dit qu'elle va vite regretter Lars.
Passé le casting aussi excitant que l'on avait pas osé l'imaginer, il y a une histoire. Enfin, une histoire... Un timbre poste. Les aliens reviennent pour détruire la Terre, ils sont encore plus méchants, ils font les mêmes choses ou presque que dans le précédent film, et voila. Bon. Sauf que le côté découverte du premier n'est forcément plus présent, on sait exactement de quoi il retourne. Roland Emmerich va aussi à cent à l'heure, ne laissant plus du tout son aventure se poser pour créer un suspense digne de ce nom. Et puis l'évolution technologique annihile le côté guerrier épique du premier (on se souvient tous des "Eagle Un, Fox deux" quand les avions tiraient des missiles) remplaçant tout ça par une bouillie de pixels avec lasers intégrés. Independence Day : Resurgence n'a plus aucun moment palpitant à offrir, ni même héroïque à l'américaine comme dans son prédécesseur. Tout s’enchaîne si vite avec si peu de conviction que rien ne prend, même pas la première offensive aérienne ou le final pourtant pensé pour être une apothéose. Dans tout cela, le pire reste que le film tente constamment de renouer avec les éléments qui avaient fait le succès du film de 1996...en utilisant des clichés aussi énormes qu'un François Hollande pré-électoral.
On pourrait pleurer devant un tel spectacle, ou rire de bien des scènes contenues dans le métrage, mais on est juste fasciné par autant de bêtises. Pour illustrer plus clairement l'échec total du film, prenons une scène symptomatique de ce ratage. Le scientifique de la zone 51 du premier film et son comparse scientifique vont se réfugier dans la salle d'isolation pendant que des aliens les attaquent. L'un des deux meurent et l'on assiste alors à la traditionnelle scène "Je prends l'agonisant dans mes bras pour échanger quelques belles paroles." Sauf que là, cela concerne un personnage que l'on a vu que 35 secondes à l'écran auparavant, dont on a clairement rien à foutre, qui est ridicule de surcroît et qui se révèle être gay. Surprise. Alors on sent qu'il y a forcément du second degré la-dedans (on l'espère en fait, sinon c'est un vrai chef d'oeuvre de nanardise) mais cela illustre toute la médiocrité du film. Un enchaînement d'événements trop rapides pour qu'on les assimile sur des personnages clichés et inconsistants, pour des enjeux vus et revus, et surtout...on ne sait absolument pas si c'est de l'humour intentionnel ou non. Un drame.
On ne parlera volontairement pas de la sphère blanche Apple qui se révèle un allié dans la lutte que livrent les humains (une des nombreuses idées WTF du film) ni de la cruauté de voir un Willus Smith sans copine pour le retrouver à la fin (mais c'est pas Will Smith, donc la nana forcément, il peut rêver !) ou encore du périple des enfants et du père de David (qui ne sert à rien, ne fait pas rire...on ne sait même pas ce qu'il fait encore là en fait !).
Pour conclure au sujet d'Independence Day : Resurgence... la vie est une pute mais qui a le sens de l'humour.Note : 0.5/10
Meilleure scène : Le scientifique qui meurt dans les bras de son pote et à qui il n'a pas tricoté le pull qu'il voulait, juste une écharpe. (Non mais, c'est vrai en plus!)
Meilleure réplique : "Il n'y aura plus jamais de paix possible" (prononcé par la présidente avant de mourir des mains des aliens, alors que ceux-ci viennent de détruire la planète pour la deuxième fois. On s'attendait clairement à un pique-nique après ça, c'est certain.)
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 1 commentaire
1 commentaire
-
Jeune prodige anglais dans le monde des comics dans les années 90, Garth Ennis a fréquenté comme nombre de ses collègues de l’époque 2000 A.D, un hebdomadaire de science-fiction britannique où Alan Moore, Brian Bolland ou encore Neil Gaiman ont officié. Il faut pourtant attendre 1991 pour qu’Ennis devienne scénariste d’une des séries les plus cultes du label Vertigo (la collection « adulte » de DC Comics) : Hellblazer. Durant 4 ans, l’anglais va appliquer sa recette maison à Constantine, rendant la série plus brutale et irrévérencieuse que jamais. C’est également à cette période que Garth Ennis rencontre un certain Steve Dillon, dessinateur génial s’il en est, qui va par la suite collaborer avec lui sur un tout nouveau projet pour Vertigo : Preacher.
Preacher deviendra au fil des numéros l'une des séries les plus cultes de Vertigo, voyant la parution de 66 numéros jusqu’en 2000. Récompensé par pas moins de quatre prix Eisner, le bébé d’Ennis et Dillon s’attire les louanges de la presse spécialisée comme du public. Il faut attendre l’année 2016 pour que le comic book soit porté sur le petit écran par la chaîne américaine AMC dans un format similaire à celui de The Walking Dead. Avant de reparler de la série télévisée, il était tout naturel de se pencher sur le comics d’ailleurs récemment réédité dans une édition respectant le découpage VO par Urban Comics. On mentionnera ici que cette critique porte sur le premier tome de l’édition Urban, ou sur le premier tome de l’édition Panini et la moitié du second.
De quoi parle donc ce fameux Preacher ?
D’un pasteur du nom de Jesse Custer qui vit dans une petite ville au fin fond du Texas. Un beau jour, alors qu’il n’en peut plus de sa congrégation de rednecks débiles, Jesse est frappé par une entité échappée des geôles du Paradis : Génésis. En s’unissant à lui, Génésis lui donne un pouvoir inestimable : La Voix de Dieu. Du coup, tout ce que demande Jesse grâce à la Voix devient réalité. S’il vous dit de lui préparer un café, vous lui préparez un café sur le champ. S’il vous dit d’aller vous faire enculer par un taureau…espérons que vous avez de la crème hémorroïdaire sur vous, et de la bonne. Suite au cataclysme provoqué par cette rencontre, qui souffle son Eglise au passage et une grande partie des bouseux de la petite ville en question, Jesse est tiré des décombres par son ex-petite amie, Tulip O’Hare, et le déjanté Cassidy qu’elle a elle-même rencontré auparavant dans des circonstances discutables. Commence alors une quête pleine de bruits, de fureur, de violence, de sexe, de vulgarité et de vaseline, le tout saupoudré d’une histoire d’amour torride. Jesse a une idée : trouver ce connard de Dieu et lui demander de rendre des comptes sur sa façon douteuse de gérer ses enfants. Traduction : Dieu va avoir mal à l’anus.
Ce premier (imposant) volume rassemble les douze premiers numéros de la série. On peut encore scinder ces douze numéros en deux arcs : Gone to Texas (#1-7) et Until the End of the World (#8-12). D’emblée, Preacher s’impose comme une série de comics irrévérencieux et bourrés de personnages vulgaires, brutaux et, pour tout dire absolument jouissifs. Ennis nous emmène dans le Texas, avec tous les stéréotypes que cela présuppose, et s’amuse comme un fou à décrire une humanité écœurante de médiocrité et de brutalité. Sauf qu’il ne s’agit pas véritablement d’une peinture dramatique ordinaire. Il s’agit avant tout d’un tour de piste à la Ennis avec un humour noir (parfois même très très noir) succulent qui mêle tour à tour tabassage en règle, vampire, scène de sexe hardcore, massacre au colt et autres évocations zoophiles. Preacher n’est pas vraiment là pour faire dans la dentelle et cela se voit dès son premier arc. Ennis nous montre le paradis comme on l’a rarement vu avec des anges un tantinet dépassés, un Dieu démissionnaire et puis surtout un pasteur qui en a un peu marre de toutes ces conneries de religion.
Avant d’être un joyeux road-movie référencé, Preacher est un brûlot absolu à l’encontre de la religion chrétienne. Si vous êtes pratiquant, vous risquez de mourir rapidement d’étouffement à la lecture de Preacher. Il faut dire aussi que les « bons chrétiens » qui font partie de la congrégation de Jesse n’ont pas vraiment voler le vitriol balancé par Ennis. Pourtant, le britannique a l’intelligence de ne pas nier l’existence de Dieu mais d'en faire un véritable élément moteur de son intrigue, une entité toute-puissante à qui Jesse doit remonter les bretelles pour ses conneries. Rapidement, Ennis fait de Preacher un road-movie, déplaçant son action quasi-immédiatement ailleurs que dans le trou du cul du Texas. On s’ennuie donc difficilement dans cette tornade d’action, de fou-rire corrosif et de satire grinçante. Les personnage quand à eux s’avèrent instantanément à la hauteur.
D’abord, Jesse, pasteur désabusé mais combatif au lourd passé (que l’on ne découvre que dans le second arc de l’album). Ensuite, Tulip O’Hare, ex-petite amie de Jesse, sacrée bout de femme qui ne s’en laisse pas conter facilement. Enfin, Cassidy, truculent vampire irlandais véritable monument d’humour douteux et dictionnaire de jurons sur pattes. Ce trio magique charme d’emblée, on s’attache comme pas possible à cette équipe de bras cassés aussi forte en gueule qu’en présence. C’est aussi la relation qu’entretienne ces trois-là qui donne à Preacher son charme fou. Si l’on attendra le second album pour approfondir le personnage de Cassidy, le deuxième arc du présent volume permet de revenir sur la relation Tulip-Jesse. En supplément de son hommage au western (même John Wayne est un personnage de Preacher !), Ennis est capable de nous décrire une histoire d’amour passionnée au milieu des trucs les plus dégoûtants du monde. Comme la maison des L’angelles. Entre T.C, enculeur de poules notoires et Jody, tueur fanatique de la vieille pourriture qui sert de mémé à Jesse, Garth nous explique comment est né l’amour entre Tulip et Jesse. Le résultat s’avère foutrement romantique. Qui l’eut cru ?C’est aussi la violence et l’absolue liberté de ton de Preacher qui surprennent le lecteur même encore à l'heure actuelle. On imagine d’ici la surprise des lecteurs de années 90 ! Preacher emploie un langage très cru, ne recule devant aucune blague de mauvais goût, trouve des tortures toujours plus repoussantes (le cercueil de Mémé en est un brillant exemple) mais surtout, Preacher tourne en ridicule la religion et pervertit la cellule familiale. L’œuvre remet Dieu à l’image de l’homme, s’en moque, lui tire dans les pattes et finit par lui retirer son aura (cf la discussion entre Tulip et Dieu dans le numéro 11 et 12). Garth Ennis a une façon bien à lui de réfléchir sur le dogme et le sens des responsabilités. Ajoutez à cela un goût prononcé pour le western à l’ancienne et quelques personnages qu’on n’aurait jamais imaginé un jour en comics (Tête de Fion et le Saint des Tueurs pour ne pas les nommer) et vous obtenez un premier album culte dans tous les sens du terme.
Preacher convainc d’emblée. Méchant, joyeusement foutraque, irrévérencieux, drôle, noir… Preacher, c'est aussi jouissif que de voir Justin Bieber se faire attaquer par un ragondin dopé au viagra, le tout sans capote et a cappella. Un trio d’enfer a pris la route et l’on espère que vous êtes bien accrochés à votre siège, parce que ça va faire mal.
Note : 9.5/10Disponibles également aux Editions Panini :
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Alors soyons clairs.
On bout d'impatience pour Suicide Squad depuis le premier trailer dévoilé par Warner. A l'époque, c'était lui qui avait volé la vedette à Civil War et Batman vs Superman. Devenu depuis le film de super-héros le plus attendu de l'année (notamment depuis le plan marketing autour de Leto et son interprétation du Joker), Suicide Squad était attendu au tournant.
Aux commandes, un réalisateur inégal, capable du meilleur (Fury) comme du pire (Sabotage) mais avant tout un réalisateur abonné aux films d'actions qui correspondait donc plutôt bien au ton général du métrage.
En n'oubliant pas que derrière, le projet est chapeauté par Zack Snyder himself et que la fameuse Task Force X doit permettre l'envolée du DC Universe dont elle cumule un bon nombre de super-vilains.
L'idée géniale : faire des méchants les héros du films. Le plus gros danger : une overdose de personnages et un scénario trop simpliste.
Résultat ?
Une sacrée claque super-héroïque....mais pas forcément cinématographique.
Explications.
Suicide Squad, si vous viviez dans une grotte ces six derniers mois, c'est l'histoire d'une équipe de super-vilains sensément sacrifiable devant une menace méta-humaine. Dedans, la crème des méchants DC avec Deadshot, Killer Croc, Harley Quinn, Captain Boomerang ou encore Enchantress. Il parait même que le Joker passerait par là. Après le recrutement de la team, une menace s'abat sur Midway City et par un artifice vieux comme New-York 1997, les super-vilains sont contraint de se battre contre ce qui ravage la ville sous les ordres du Navy Seal Rick Flag et de l'impitoyable Amanda Waller.
De ce pitch prometteur, Ayer tire un film électrique de deux heures qui permet une chose jusqu'ici totalement inédite : faire une vraie adaptation de comic book sur grand écran.
Ce qui manquait à tous les précédents films de super-héros, c'était cet aspect joyeux et décomplexé émanant du comic mainstream et qui signait pour nombre de ses lecteurs la personnalité du média lui-même. Avec Suicide Squad, Ayer trouve exactement ce ton et offre le juste milieu entre la noirceur et le réalisme d'un Batman vs Superman ,et le fun d'un Gardiens de la Galaxie. Mieux encore, Suicide Squad s'affirme d'emblée comme le prolongement direct de Batman vs Superman, de façon bien plus évidente et intelligente que tous les Marvels l'ont fait auparavant. Ce sont les conséquences de la mort de Superman ainsi que de la polémique qui l'entoure qui fait naître l'équipe de Waller. Et tout comme son prédécesseur, le film d'Ayer aime lancer des clin d’œils complice au spectateur sur le parallèle avec le réel (Guantanamo/Les marais de Louisiane, le terrorisme, la délimitation bien/mal par le gouvernement...) tout en restant assez jouissif et fun pour ne jamais lasser le spectateur. C'est là le point le plus notable de Suicide Squad qui le différencie grandement du film de Snyder : il est ludique et amusant...dans son style.
Ce qui rapproche par contre Suicide Squad de Batman vs Superman, c'est sa mise en scène. On sent qu'il y a un véritable réalisateur avec du caractère derrière. Les scènes d'actions sont toujours iconiques et jouissives au possible, l'univers a de la gueule, les personnages un cachet et un charme beaucoup plus "adulte" que les productions Marvel tout en trouvant leur propre ton décalé par moment. De ce côté, on pourrait presque croire que Suicide Squad est le Gardiens de la galaxie de DC Comics. Sauf que la noirceur de ce qui se passe derrière différencie carrément les deux, on retrouve la touche réaliste et le côté sombre inhérents aux oeuvres DC, sans la chape de plomb narrative dont souffrait Batman vs Superman. Ayer gère sa présentation de personnages comme un chef, la chose s’avérant aussi ludique que stylée...faisant totalement oublier le didactisme obligé qui se cache derrière. Parmi les membres de l'équipe, ce seront évidemment Harley Quinn et Deadshot qui seront les plus mis en avant. Margot Robbie et Wil Smith imposant avec une facilité étonnante leur visage sur ces deux figures pourtant bien connus. Pour être plus précis, ils sont parfaits de bout en bout, touchant même à un côté émotionnel relativement inattendu.
Il reste évidemment des défauts à Suicide Squad. A savoir une dernière partie franchement prévisible à deux/trois détails près, et (forcément) des super-vilains sous-exploités, une chose qui semble logique du fait de la durée du film et de la volonté manifeste d'introduire le Joker en parallèle. Ce dernier avait beaucoup fait parler de lui ces dernier temps d'ailleurs. Même s'il est finalement assez peu présent, son inclusion dans Suicide Squad n'a rien à voir avec Wonder Woman dans Batman vs Superman : ici tout fonctionne sacrément bien. Ayer et Snyder se débrouillent pour nous dresser le portrait d'un joker radicalement différent de celui incarné par Ledger. On pense tout du long à celui de Brian Azzarello dans le comics Joker, et l'on est surtout impatient de voir Jared Leto revenir à ce personnage tant sa prestation est un sans-faute total. Le Joker version Ayer est un Joker gangsta/roi du crime, à la fois inquiétant et imposant mais sans le caractère psychopathe jusqu'au boutiste de Nolan. Cette vision préliminaire (au prochain Batman ?) promet énormément. Sa relation avec Harley Quinn ne dépareille pas. Elle est troublante, touchante et recèle même lors d'une certaine séquence une poésie creepy du plus bel effet (Killing Joke inside).
Si le grand méchant de cet épisode surprend sans pour autant convaincre totalement, c'est finalement le remarquable sens du rythme du long-métrage et sa volonté de ne laisser aucun temps mort qui en fait une des adaptations de comics les plus réussies qui soit. Bien davantage que Batman vs Superman, Suicide Squad marque le début du DC Universe au cinéma. On sent que Snyder a des idées, qu'il dissémine ses indices au fan (la mention co-assassin de Robin dans la présentation d'Harley !) et qu'Ayer jouit totalement des possibilités offertes en terme d'action et de mise en scène. De même, la bande originale du film par Steven Price se révèle une monumentale réussite, toutes les chansons choisies ici apportent quelque chose au long-métrage, une dose de folie-pop entraînante dont on se délecte constamment. C'est là la plus grande réussite de Suicide Squad : proposer un blockbuster malin où la mise en scène et la musique épousent totalement le propos pour accoucher d'une montagne russe d'action au caractère visuel bien trempé.
David Ayer réussit à tenir toutes les promesses de ses bande-annonces. Voir davantage. On peut évidemment regretter la prévisibilité de sa dernière partie mais ce serait vraiment être aveugle en face de l'efficacité narrative globale. Casting parfait, mise en scène stylisée et rythme dantesque font de Suicide Squad un bon film de super-héros super-vilains. Tout simplement.
On est impatient de voir la suite !Note : 8.5/10
Meilleure scène : Deadshot qui arrête la vague ennemie à lui seul
Meilleure réplique : "No, too easy. Can you...live for me?"Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Entre les ténors de l'animation occidentale tels que Pixar, Blue Sky et Dreamworks, un petit studio tente de se faire une place : Illumination Entertainement. Déjà à l'origine de la franchise Moi, moche et méchant et du Lorax, les créateurs des Minions nous offrent pas moins de deux nouveaux films d'animation cette année. Si Tous en scène ne sortira que bien plus tard, c'est déjà l'heure pour The Secret Life of Pets (renommé Comme des bêtes pour le territoire français, car le français moyen aime les titres débiles semble-t-il...) de jouer dans la cour des grands. Entre L'Âge de glace 5, Le Monde de Dory et La Tortue Rouge, on peut dire que la concurrence sera rude. Heureusement, Comme des bêtes a quelques atouts dans sa manche, à commencer par un character design attachant et une thématique qui laisse entrevoir de grandes possibilités. Un pari réussi ?
En réalité...pas vraiment.
Comme des bêtes entraîne le spectateur dans la vie des chiens, chats, oiseaux et autres rongeurs qui nous servent d'animaux de compagnie...une fois que nous les laissons seuls. Première mauvaise surprise, la bande-annonce initiale a tout montré des cinq premières minutes du film. Du coup, aucun éclat de rire ou sourire. Deuxième mauvaise surprise, et malgré ce que semblait affirmer la campagne marketing autour du film, Comme des bêtes reste un film à l'ancienne. Une fois la porte refermée, Chris Renaud et Yarrow Cheney nous entraînent dans l'histoire de Max et Duke, deux chiens qui vont devoir cohabiter ensemble et qui, forcément, n'en ont aucune envie. Autour d'eux gravitent un tas de second rôle, de Chloé à Pops en passant par Gidget. Jusque là, rien de mauvais, beaucoup de divertissement et une aventure joyeuse et relativement rythmée.
Sauf que les choses n'iront jamais plus loin.
Il faut bien comprendre que Comme des Bêtes n'est pas un mauvais film d'animation. Aucun aspect du long-métrage n'est mauvais en soi, on peut même dire que l'animation en elle-même est une pure réussite. C'est juste qu'il semble relever d'une autre époque. Au-delà de son aventure principale et de quelques fils secondaires (notamment la quête de Gidget et des autres), il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune émotion profonde dans Comme des Bêtes. On se retrouve devant un film d'animation agréable mais dénué de tout fond. Ou tout du moins, qui ne fait qu'effleurer très rapidement ce qui aurait pu constituer des thématiques fortes tels que l'abandon, le temps qui passe, le lien maître-animaux...Tout est survolé, jamais exploité. On éclate parfois de rire devant les répliques de Kevin, le lapin déglingué vivant dans les égouts avec sa bande, mais on ne retrouve jamais le dimension supplémentaire apportée par les films Pixar ou l'immense intelligence d'une Tortue Rouge.
A côté de ça, les réalisateurs nous offrent tout de même un agréable moment de détente avec quelques trouvailles vraiment amusantes, du lapin dont on parlait plus haut au running-gag du hamster. Les personnages sont attachants, l'histoire ne laisse pas beaucoup de temps morts. Bref, Comme des bêtes peut s'apprécier comme un dessin-animé occidental à l'ancienne, sans sous-texte, sans double lecture. Au vu des possibilités qu'il renferme, le film ne peut pourtant que décevoir tant ses créateurs peinent à faire jaillir la moindre émotion. Ils n'arrivent jamais à atteindre la tendresse qui se tissait entre Gru et les enfants dans le premier Moi, moche et méchant, restant constamment un large cran en-dessous de ce dernier. Le résultat s'avère frustrant.
Loin de la poésie de La Tortue Rouge ou de l'émotion latente du Monde de Dory, Comme des bêtes assure le minimum et se repose sur une formule un tantinet dépassée. On espère que Tous en scène parviendra à rectifier le tir.
Amusant mais rapidement oublié.Note : 7/10
Meilleure scène : L'arrivée du lapin et de son gang
Meilleure réplique : Ricky, on pense à toi !Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Regardez les étoiles
![[Critique] Preacher, Tome 3](http://ekladata.com/zXH8eUpEHtDD7OnA97sZh5-fmmA@555x835.jpg)
![[Critique] Preacher, Tome 3](http://ekladata.com/UQUxc-dNozgpFg-wEQHehyJ8lHs@250x369.jpg)
![[Critique] Preacher, Tome 3](http://ekladata.com/dOWB7RbgvEdKSp-AJpyIS-elU0o@250x379.jpg)


![[Critique] Les Sentiers de la gloire](http://ekladata.com/hfJVqyBcH2hGudZ3swaXRNlp2Dk@555x740.jpg)
![[Critique] The Killing (L'Ultime Razzia)](http://ekladata.com/Cb9h8Vwx6gVgvgMb7ZR2C-pB66s@555x801.jpg)
![[Critique] Fear and Desire](http://ekladata.com/lD1cr7EXQdPJOTMhqBMLUkZa0r0@555x740.jpg)
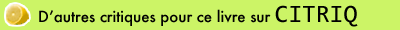
![[Critique] Preacher, tome 1](http://ekladata.com/AZuoTkZlxDghM3q9pdMH99XLX2E@240x363.jpg)
![[Critique] Preacher, Tome 2](http://ekladata.com/5QqaCS3sZsfuJwKNZlsUyKRAqfs@242x330.jpg)
![[Critique] Independence Day : Resurgence](http://ekladata.com/d_VEPvbhm_DXq94UtmOSnJnCGHo@555x823.jpg)
![[Critique] Preacher, tome 1](http://ekladata.com/BwoBY2lPTULwZoZfdC4g1Ku0inA@555x851.jpg)

![[Critique] Preacher, tome 1](http://ekladata.com/dfctLQVMQBnM0mlCEAaP_G7GGOY@243x332.jpg)
![[Critique] Suicide Squad](http://ekladata.com/j4l09NPB-zZ3STxD550QVNRC2QA@555x833.jpg)
![[Critique] Comme des bêtes](http://ekladata.com/6uER34Ma5jv-WBMqNHsDiNCGAEk@555x879.jpg)
