-
Cinéma & Série TV
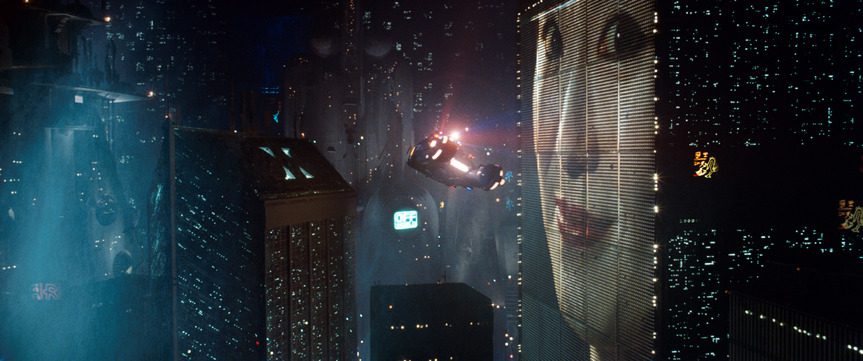
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
-
Par Nicolas Winter le 3 Juin 2017 à 15:10
Triste destin que celui de la franchise Pirates des Caraïbes. Ce coup de poker des studios Disney en 2003 qui tentent alors d'adapter une attraction-phare du parc devient un énorme succès. Forcément, deux suites sont mises en chantier, Le secret du coffre maudit et Jusqu'au bout du monde, toujours sous la direction de Gore Verbinski mais qui finit clairement par épuiser le filon avec un épisode trois poussif. Malgré le départ du créateur de la trilogie, la production choisit de remettre le couvert en confiant le quatrième volet à Rob Marshall. La Fontaine de Jouvence s'avère logiquement un échec artistique quasi-total. Malgré tout, le public suivant, un cinquième film est mis en chantier. Cette fois, le métrage est co-réalisé par les réalisateurs norvégiens Joachim Rønning et Espen Sandberg à qui l'on doit Kon-Tiki mais aussi Bandidas. Difficile donc de soulever un véritable enthousiasme pour cette énième aventure malgré la présence inattendue de Javier Bardem. Ne serait-il pas temps de couleur le Black Pearl ?
Difficile de se voiler la face, ce nouveau volet de Pirates des Caraïbes n'a plus la fraîcheur d'antan. En effet, on marche en territoire connu avec malédictions, moussaillons, canonnades, couple d'amoureux, abordages, singes voleurs, Jack Sparrow et autre Barbossa. A priori rien de nouveau sous le soleil. Cependant, les cinéastes étant certainement bien conscients de cet état de fait, capitalisent justement sur ce qui a fait le succès de la franchise à ses débuts. La Vengeance de Salazar (en réalité Dead men tell no tales, mais les français adorent les titres moisis, c'est bien connu) s'ouvre donc de façon très semblable au premier opus en misant tout, ou presque, sur un côté aventure décontractée qu'il fait assez plaisir de retrouver. Le ton mystérieux est là, Jack Sparrow égal à lui-même (bien que le personnage commence à lasser) et surtout les réalisateurs norvégiens nous présentent Salazar. Très (très) loin du fade Barbe Noire, le grand méchant interprété par un succulent Javier Bardem bénéficie non seulement d'un background efficace mais également de superbes effets spéciaux qui, sans égaler la perfection graphique du Hollandais Volant, renvoie à l'équipage maudit du Secret du coffre maudit.
En s'ouvrant sur une séquence d'action drôle et impressionnante à souhait, La Vengeance de Salazar réjouit. Certes, on le savait en entrant dans la salle, on ne trouvera rien de véritablement nouveau là-dedans mais au moins Joachim Rønning et Espen Sandberg ont-ils la bonne idée d'offrir un divertissement le plus proche possible des origines. On évite évidemment pas les défauts comme celui du couple formé par Brenton Thwaites-Kaya Scodelario, copie à peine masquée de celui d'Elizabeth et Will, ou le manque cruel de scènes véritablement épiques. Mais ce cinquième volet a pourtant bien des choses à proposer. A commencer par un antagoniste puissant au navire franchement excellent, et surtout, comme on le disait plus haut, d'un background qui fait plaisir et sort des ornières habituelles. De même, l'humour, malgré quelques errements, s'avère globalement meilleur avec quelques blagues franchement drôles (l'astrologue putative). Saluons enfin quelques séquences qui sortent du lot comme le combat sur les canons, la libération de Jack ou encore le cambriolage. Tout cela sur une bande-son dans la droite lignée des autres opus et, donc, excellente.
Plus court que tous les autres volets précédents, La Vengeance de Salazar n'a pas le temps de faire bailler son spectateur comme pouvait le faire Jusqu'au bout du monde ou La Fontaine de Jouvence. Mieux même, les deux réalisateurs tentent de rattacher les wagons de l'histoire de la trilogie originale pour lui donner un épilogue qui, s'il semble un peu téléphoné, n'en demeure pas moins touchant. Reste alors le cas de Jack Sparrow interprété par un Johnny Depp égal à lui-même qui finit, simplement par agacer. Pas que le personnage en lui-même soit mauvais - il a été brillantissime par le passé - mais il est l'exemple même du héros usé jusqu'à la corde et dont on connaît chaque réplique. C'est pourquoi la séquence si contestée du flash-back s'avère une excellente idée. Elle permet de montrer quelque chose de neuf à propos de Jack tout en achevant en un certain sens sa légende. Espérons simplement qu'il s'agisse là de la dernière apparition de l'excentrique pirate des caraïbes.
Surprenant par sa volonté affichée de revenir aux sources d'une saga passablement essoufflé, Pirates des Caraïbes 5 se hisse au rang des bons divertissements. En tentant de se faire plus léger, plus rythmé, plus esthétique et surtout de rassembler les personnages des premiers volets, le long-métrage de Joachim Rønning et Espen Sandberg offre une fin satisfaisante aux aventures de Jack Sparrow. Du moins, on l'espère.Note : 6.5/10
Meilleure(s) scène(s) : Le cambriolage
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 7 commentaires
7 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 23 Mai 2017 à 11:42
Le réalisateur franco-belge Fabrice Du Welz, à qui l'on doit des pépites horrifiques comme Alléluia ou Calvaire, se tourne aujourd'hui vers Hollywood. Si l'on sait très bien que ce milieu a une fâcheuse tendance à broyer les cinéastes devant des impératifs budgétaires et scénaristiques, on est tout de même heureux de voir Fabrice revenir derrière la caméra pour s'essayer à un genre radicalement différent, celui du revenge movie. Dès la première bande-annonce le ton est donné, Message from the King ne va pas faire dans la dentelle et c'est tant mieux. Avec un casting aux petits oignons qui regroupe Chadwick "Black Panther" Boseman, Teresa Palmer, Luke Ewans ou le trop ignoré Alfred Molina, on peut dire que Du Welz sait s'entourer. Reste maintenant à voir comment il va gérer le changement d'univers et son passage à Hollywood.
Première bonne chose, Message from the King n'est pas là pour ergoter pendant des heures, à peine commencer que l'on plonge déjà dans l'intrigue, tout à fait simpliste d'ailleurs : Jacob King débarque à Los Angeles pour retrouver sa sœur Bianca qui lui a laissé un message de détresse sur son répondeur quelques jours plus tôt. Il ne dispose que de quelques centaines de dollars, d'un sac de vêtements pour sept jours. Du Welz pose les bases en quelques minutes et s'intéresse ensuite à son histoire de vengeance. Le métrage va droit au but, fonctionne d'abord comme une enquête pour rapidement suivre les traces d'un vigilante-movie à l'ancienne. Chadwick Boseman, impressionnant de bout en bout, trouve en Jacob King un personnage excellent que Du Welz laisse à moitié inexploré jusqu'à la toute fin de son métrage. Le spectateur ne connaît pas Jacob mais comprend vite que ses origines sud-africaines en font quelqu'un d'autrement plus dangereux et déterminé que des gangsters américains lambda. De Boseman se dégage une aura de charisme brutal mais aussi une sympathie instantanée envers un homme qui tente de faire justice sans chercher à excuser ou minimiser. C'est certes assez basique mais diablement efficace.
Malheureusement, qui dit revenge movie dit scènes de combat...et là, Fabrice Du Welz montre ses limites de metteur en scène. En effets, les affrontements sont le plus souvent brouillons et parfois carrément illisibles. Si l'on excepte l'idée de la chaîne de vélo (qui renvoie en un sens au marteau de Old Boy, chacun ses goûts), l'action dans Message from the King s'avère simplement ratée. A côté de ce défaut ennuyeux, le film accumule les bonnes idées. La première étant de faire de Los Angeles un endroit crade et violent où les rêves des jeunettes en quête de gloire se brisent sur les rochers de la réalité américaine. Bianca en est le parfaite exemple et le fait même de la rendre aussi peu sympathique permet au film de donner une dimension d'autant plus poignante à la relation Bianca-Jacob. Jacob venge un souvenir plus qu'une réelle personne, il venge sa petite sœur du Cap et pas la droguée paumée de Los Angeles. Sous la caméra de Du Welz, la Cité des Anges adopte un aspect tout à fait repoussant où la richesse n'est qu'une façade, où le mal rode dans les coins. De ce côté-là, le cinéaste n'a rien perdu de son talent de mise en scène.
Enfin, on peut regretter la simplicité extrême de l'histoire qui, s'il on y réfléchit bien, tient sur un timbre-poste plié en quatre. Cela semble pourtant renouer avec les revenge-movie old school des années 80-90 mais peut très certainement décevoir des gens habitués à des joyaux noirs ultra-fouillés comme Old Boy ou Lady Vengeance. Cette caractéristique d'uppercut de Message from the King s'avère donc à double-tranchant. Reste que le métrage arrive à éviter certains clichés inhérents à ce type de film, comme l'histoire d'amour qui, cette fois, n'en sera heureusement pas une. Malgré la volonté de Fabrice de toujours vouloir investir tout son être dans ses films (cf. Interview), on se rend compte que Message from the King reste tout de même assez loin de la qualité de ses autres long-métrages, plus étranges, plus audacieux et, simplement, plus personnels.
Direct, sec et sans pitié, Message from the King tient ses promesses. Emporté par un Chadwick Boseman impeccable dans un Los Angeles magnifiquement capturé par Fabrice Du Welz, le film est aussi simple qu'efficace tout en se permettant quelques subtilités bienvenues.
On attend maintenant le retour du réalisateur dans un domaine plus personnel et forcément plus captivant.Note : 7/10
Meilleure(s) scène(s) : La scène de la morgue
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 18 Avril 2017 à 15:56
Pour adapter son roman autobiographique, le chanteur Grand Corps Malade décide d'appliquer l'adage qui dit que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout de même épaulé par son ami Mehdi Idir - réalisateur des clips du chanteur -, le français Fabien Marsaud met en scène Patients, long-métrage à propos de sa rééducation suite à un accident dans une piscine qui lui a presque fait perdre totalement l'usage de ses jambes et qui l'a mené à mettre fin à sa pratique du basket. Pour se faire, il recrute un casting de jeunes acteurs et donne son propre rôle à Pablo Pauly qui va de ce fait porter tout le film (ou presque) sur ses épaules. Reste maintenant à savoir si Grand Corps Malade réussi son pari de passer derrière la caméra.
On ne reviendra pas sur l'histoire puisqu'il s'agit en réalité de celle du chanteur avec des noms différents. Rappelons juste que l'on suit la difficile rééducation de Benjamin, un jeune qui doit tout réapprendre suite à un accident dans une piscine. Le but de Patients n'est cependant pas tant de dresser le portrait d'un homme que celui plus ambitieux, et certainement plus original, de décrire le milieu des soins de suites et réadaptation. Par le regard de Benjamin puis de ses amis, le spectateur découvre un univers médical un peu différent de la norme habituelle et certainement bien plus réel que les conceptions aseptisées que l'on peut trouver ailleurs. Grand Corps Malade évite deux des principaux pièges de ce genre d'entreprise : il conserve une certaine forme d'humour sans cependant effacer toute trace dramatique...et il reste sobre sans chercher à tirer à tout prix des larmes au spectateur.
Alors que l'on ne s'y attendait pas du tout, Patients s'avère un film humble qui sait parler du handicap sans verser dans les excès de misérabilisme ou au contraire de bienveillance que l'on aurait pu craindre. Il ne rechigne pas à parler de la vérité du handicap avec les lavages évacuateurs, l'impossibilité de se nettoyer seul ou de manger seul, mais il le fait avec une sincérité omniprésente. Quand le long-métrage montre l'absurde du comportement de Jean-Marie, c'est pour mieux faire comprendre par la suite qu'il n'est pas vraiment méchant...il est juste comme ça. Du coup, on en rigole bien plus facilement. De même, les relations qui se nouent entre Benjamin et ses potes, tous issus de la banlieue, se révèlent nuancées et équilibrées évitant la plupart du temps de tomber dans la caricature maladroite. De ce fait, le long-métrage apparaît comme éminemment sincère, davantage encore qu'un Intouchables.
Sur le plan des défauts, il faut pointer la longueur certainement un peu excessive de Patients au regard de son sujet. En voulant uniquement traiter l'environnement de la rééducation, Marsaud a une excellente idée mais il ne peut éviter une certaine lassitude du spectateur. Certes, on peut aussi arguer que c'est aussi le but, faire ressentir la lenteur du processus de réhabilitation...Pourtant, on finit un tant soit peu par tourner en rond. Heureusement, le ton d'une grande justesse adopté par le métrage sauve le film du ratage, lui donnant au contraire un capital sympathie énorme. Il faut dire que Pablo Pauly assure dans le rôle de Benjamin et que le refus de faire de son récit un tire-larme facile aide à s'identifier au personnage.
Enfin, il faut reconnaître le mérite de Grand Corps Malade qui propose une mise en scène sobre et efficace, ne tombant pas dans l'excès ou le tape à l’œil. Certains choix de musiques sont discutables (même si celles-ci s'incluent parfaitement dans le monde social décrit...) ainsi que certaines scènes finalement très clipesques, mais il faut saluer le recours au silence plutôt qu'à une musique pesante dans les scènes émouvantes. En ce sens, on peut vraiment dire que le jeune réalisateur réussi à raconter quelque chose de touchant sans tomber dans l'excès bien connu du cinéma français populaire habituel. Au fond, mis à part un sous-texte social un peu maladroit (le film n'a ni la place ni l'intelligence nécessaire pour s'intéresser véritablement au sujet), Patients parle avec brio du courage, de l'abnégation, de la persévérance et du regard de l'autre quand on est handicapé. Rien que pour cela, le métrage mérite que l'on s'y attarde.
Petite surprise de ce début d'année 2017, Patients permet à Grand Corps Malade de parler avec sincérité de son histoire tout en évitant un pathos que l'on pensait inévitable. Drôle et touchant, le long-métrage n'a pas à rougir de la concurrence, au contraire.
Note : 7/10
Meilleure scène : Le premier jour en rééducation et l'arrivée de Jean-Marie.
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 8 Mars 2017 à 22:41
Après un dernier long-métrage plutôt décevant, Midnight Special, l'américain Jeff Nichols s'éloigne du cinéma de genre pour s'intéresser à un fait historique autour de la ségrégation raciale aux Etats-unis. De nouveau sur les marches de Cannes en 2016, le cinéaste y présente Loving, histoire d'amour et combat pour l'égalité dans une Amérique des années 60 où certains états tels que la Virginie rejette l'existence d'unions mixtes entre blancs et personnes de couleurs. Malgré un accueil tiède sur la Croisette, le long-métrage a permis à l'actrice Ruth Negga (récemment aperçue dans Preacher) de décrocher une nomination à l'oscar de la meilleure actrice. Il était donc temps de découvrir si Nichols pouvait renouer avec la réussite...
Bâti comme un biopic mais cette fois consacré au combat juridique - et moral - d'un couple dit "mixte" dans l'Amérique des années soixante, Loving s'intéresse plus précisément à Mildred et Richard Loving qui décidèrent de se marier malgré l'interdiction faîtes à ce genre d'union dans leur état de résidence, la Virginie. Immédiatement arrêtés et mis en accusation, les Loving devront mener un combat éprouvant pour gagner le droit de revenir sur la terre qui les a vu naître. Symbole des lois raciales qui avaient alors encore cours dans certains états, l'affaire Loving contre la Virginie fut l'étape décisive qui décida du droit au couple mixte à exister partout aux Etats-Unis suite au jugement du 12 juin 1967 rendu par la Cour Suprême américaine. Devant ce fait historique archi-connu, Jeff Nichols tente donc de rendre honneur au couple Loving et à son combat.
Incarnée par Ruth Negga, que l'on sent d'ailleurs très investie dans son rôle et qui fait ici oublier sa prestation douteuse de Preacher, et Joel Edgerton, beaucoup trop monolithique dans son jeu d'acteur quant à lui, le couple Loving a toutes les cartes en mains pour nous émouvoir. Il s'agit tout de même d'une histoire d'amour interdite et tragique dont l'intensité va finir par triompher d'une des lois les plus injustes des Etats-Unis de l'époque. En ajoutant à cela que Jeff Nichols sait d'ordinaire très bien gérer l'intimité de ses personnages et les bouleversements qu'ils affrontent - il suffit de revoir l'excellent Mud ou le chef d'oeuvre Take Shelter pour s'en convaincre -, Loving ne pouvait être qu'un grand film.
Sauf qu'il ne l'est pas. Loving fait parti de cette malheureusement catégorie de films qui manquent leur objectif. Pour tout dire, Loving s'avère un film raté.
Parce que là où l'on devrait se retrouver devant une histoire d'amour qui nous prend aux tripes et/ou un combat juridique qui se fait de plus en plus poignant, Nichols choisit la sobriété envers et contre tout. Ce qui dessert totalement son sujet et ses personnages. Jamais le spectateur ne sentira l'intense amour des Loving devant une mise en scène d'une extrême discrétion et des acteurs dont le jeu s'efface totalement. Quand en face American Honey bouillonne d'émotions et brûle d'amour, Loving se révèle un objet filmique élégant mais totalement froid au cheminement balisé et un poil longuet. On assiste à une histoire certes importante au sujet passionnant mais traitée avec une telle distance qu'on ne se sent jamais impliqué. Il faudra attendre les quelques minutes d'écran d'un Michael Shannon toujours aussi génial pour réchauffer un tantinet cet amour devenu de glace.
L'échec de Loving est d'autant plus dommage qu'il ne peut pas légitimement être qualifié de mauvais film. Jeff Nichols reste un excellent metteur en scène avec l'élégance qu'on lui connaît, Ruth Negga et Joel Edgerton tente de faire passer ce qu'ils peuvent dans les limites du cadre imposé par le cinéaste...et le sujet surtout reste quelque chose de fort, d'important. C'est juste qu'on ne sentira jamais germer la colère légitime qu'une telle histoire devrait soulever, ni même l'empathie qu'elle devrait susciter. Ajoutons à cela que le film prend un temps fou à aller à son but principal (l'affaire devant la Cour Suprême) et l'on ne peut que constater l'échec de Nichols, cette fois-ci bien plus évident que pour son tiède Midnight Special qui laissait déjà entrevoir nombre des tares de Loving...
Nouvelle déception, et non des moindres, dans l'oeuvre du jeune réalisateur, Loving prouve que le ton d'un film a une importance cruciale pour son bon fonctionnement. Froid, presque clinique, le long-métrage de Jeff Nichols laisse le spectateur sur le bord du chemin admirant avec respect la tentative mais ne pouvant que constater l’évidence : Loving passe totalement à côté de son sujet.
Note : 4.5/10
Meilleure scène : Michael Shannon qui photographie les Loving
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 18 Février 2017 à 17:32
On ne présente plus Martin Scorsese, réalisateur américain incontournable à la carrière jalonnée de grands films inoubliables. Trois ans après Le Loup de Wall Street, Scorsese revient à un genre plus sage, celui du récit historique. Avec Silence, projet de longue date du cinéaste, il adapte le roman éponyme de Shusaku Endo se déroulant dans le Japon du XVIIème siècle en proie aux persécutions de la minorité chrétienne. Emmené par Andrew Garfield - décidément très en vogue ces derniers temps puisqu'il était également à l'affiche du Hacksaw Ridge de Mel Gibson - et Liam Neeson, Silence se penche sur la question de la foi. Superbement ignoré à la prochaine cérémonie des oscars, le long-métrage n'a pourtant pas à rougir de la concurrence. Sur près de 2h40, Martin Scorsese nous transporte dans le temps pour revivre le chemin de croix du père Sebastião Rodrigues.
Silence n'a cependant rien d'un film facile, à l'image des souffrances endurées par les chrétiens de cette sombre période. Immédiatement, Scorsese affirme sa maîtrise absolu sur le plan formel par une introduction dans les brumes de toute beauté. La voix-off, omniprésente de bout en bout, nous fait pénétrer dans l'esprit torturé des différents prêtres qui traversent le film. C'est avec le père Ferreira que l'on commence Silence mais c'est rapidement avec le père Rodrigues que l'on continue à explorer ce Japon effrayant. Bien décidé à éradiquer la religion chrétienne de leur île, les autorités japonaises, menées par l'impitoyable inquisiteur Inoue, vont torturer les croyants mais également les prêtes. Leur but est simple : l'apostasie. Réduire au néant le culte chrétien et restaurer la tradition. Au milieu de ce carnage abominable, Les pères Rodrigues et Garupe débarquent du Portugal pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, dont on dit qu'il a apostasié et qu'il vit désormais comme un authentique japonais. Confronté à l'immense souffrance des chrétiens de l'île, Rodrigues et Garupe vont durement éprouvés leur propre foi.
...Et le spectateur aussi. Silence n'est pas le Loup de Wall Street. Il n'est pas un film facile d'accès ou même divertissant. Silence est une épopée introspective dans la tête du père Rodrigues. Scorsese livre un métrage à la fois bavard - par l'intermédiaire des voix-off - et taiseux - par l'absence de dialogues entre les personnages à l'écran une bonne partie du temps. Il raconte le chemin de croix à la fois d'une figure christique et d'un avatar de Pierre (qui renia le Christ justement). Le père Rodrigues (et par extension le père Ferreira) synthétise en eux une bonne part de ces deux personnages bibliques et incarnent à eux seuls la souffrance des chrétiens de l'époque mais également le dilemme théologique qu'est celui de renier sa propre foi. Sur près de 2h40, Silence prend donc un temps fou (certainement trop long par ailleurs) pour raconter, en somme, la souffrance morale et physique.
Pour se faire, c'est Andrew Garfield qui va tenir le film sur ses épaules. Tout le long-métrage s'intéressant au calvaire enduré par le père Rodrigues, la prestation de Garfield devient dès lors essentiel. Peut-être un peu trop jeune encore pour ce rôle (qu'on aurait en fait bien plus imaginé pour son partenaire sous-exploité à l'écran, l'excellent Adam Driver), l'américain s'en tire plutôt bien parvenant même parfois à susciter de vrais instants d'émotions (on pense à la séquence de la plage ou aux Adieux à Mokichi).A l'instar de ce héros, le film de Scorsese fait souffrir le spectateur. Il est lent, répète sans cesse la torture et la souffrance, et ne semble jamais vouloir dévier de cet axe de réflexion. Pour cause d'ailleurs, puisque tout l'histoire elle-même parle de résilience, de courage et de lutte spirituelle.
Il faut donc immédiatement avouer que si le sujet ne vous passionne guère de base, Silence sera certainement une épreuve pour vous. Cependant la mise en scène toujours aussi épatante de Scorsese ainsi que sa reconstitution minutieuse du Japon de l'époque forcent le respect. Silence nous embarque dans un autre temps, plus noir, plus désespéré mais aussi, et certainement, plus courageux à bien des égards. Authentique leçon de bravoure et d'abnégation, l'histoire de Silence interroge sur la capacité à croire envers et contre tout, sur la persécution des minorités religieuses dans le monde et sur l'universalité des croyances. Il le fait en exposant des choses horribles mais d'où peut jaillir des éclairs de beauté insoupçonnés, comme ces communautés qui n'ont rien mais qui vivent par leur foi ardente, ou ce père qui va tout sacrifier pour sauver les siens. Silence apporte un message fascinant sur la confrontation à Dieu, sur la recherche de sa voix et la solitude de l'homme.
Mais il échoue aussi d'une certaine façon, non seulement dans sa façon abrupte de présenter son sujet - peu nombreux seront les spectateurs à pénétrer l'histoire - mais aussi avec sa profusion de voix-off. Cette dernière reste assez surprenante chez Martin Scorsese qui devrait pourtant être capable de faire passer les émotions de ses personnages ainsi que leurs sentiments sans cette lourdeur didactique parfois lassante. Silence aurait également mérité de franches coupes, ne serait-ce que pour éviter la répétition dont il est victime. Certes le film est à l'image du chemin de croix de son héros mais on l'aurait bien compris au bout de deux heures derrière l'écran. C'est d'autant plus dommage que le long-métrage présente une véritable ambition narrative qui fait du bien, bien davantage en tout cas que le mou et consensuel Sully de Clint Eastwood.
Film clivant mais fascinant, Silence permet d'aborder une autre facette de Martin Scorsese tout en réaffirmant le talent de mise en scène extraordinaire de l'américain. Certainement difficile pour le spectateur lambda, le long-métrage n'en reste pas moins une formidable plongée sur les croyances et la capacité à se battre pour sa foi et les siens. Un chemin de croix qui en vaut la peine.Note : 8/10
Meilleure scène : L'adieu à Mokichi sous la pluie
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 12 Janvier 2017 à 19:08
S'il existe une chose difficile, c'est de mener à bien un premier long-métrage. La chose est encore plus ardue lorsque l'on est un acteur reconnu qui doit faire ses preuves derrière la caméra. Clint Eastwood ou Ben Affleck en savent quelque chose. C'est aujourd'hui au tour d'un autre grand nom d'Hollywood de tenter de devenir réalisateur : Ewan McGregor. L'acteur britannique recrute Jennifer Connelly et Dakota Fanning (un peu perdue dans l'ombre de sa sœur, Elle Fanning) pour un drame académique sur une famille américaine typique adapté du roman éponyme de l'immense Philip Roth. Cependant, malgré tout le talent d'acteur qu'on lui connaît, Ewan McGregor aura fort à faire pour nous convaincre. Cela même s'il est également l'acteur principal de son film. Que vaut réellement cet American Pastoral ?
Tout d'abord, McGregor choisit d'introduire son film par une histoire annexe à celle de la famille principale. En faisant intervenir un écrivain qui finit par nous raconter le drame qu'a subi les Levov, le réalisateur britannique commet une faute qu'on pourrait dire de didactisme. Quelque soit la raison pour laquelle il fait intervenir ce procédé, il perd la fluidité de son récit dans la prmeière partie et le rallonge de façon tout à fait artificielle. Cette introduction maladroite et assez lourde ne peut cependant pas occulter le fait que d'emblée, McGregor dispose d'une mise en scène élégante, académique certes mais véritablement élégante. Ses plans, ses cadres, tout concourt à nous immerger dans son aventure sans jamais remarquer qu'il s'agit là d'une première fois derrière la caméra. Le vraie problème dans la narration d'American Pastoral s'envole dès que l'on plonge dans l'histoire des Levov.
A ce stade, McGregor acteur tient le film sur ses épaules d'une façon remarquable. En face, Jennifer Connelly rappelle qu'elle est une très grande actrice injustement négligée. Ce que vont traverser Swede et Dawn Levov pourtant n'a rien d'anodin. Nous en arrivons donc au cœur de ce drame familial et, d'une certaine façon, social. American Pastoral raconte comment tout peut s'effondrer pour un couple à qui tout semble sourire. Il le fait en exploitant l'un des aspects les plus redoutables de la société américaine : son fanatisme. Qu'il soit religieux ou politique, le fanatisme américain s'incarne dans la jeune Merry, fille brillante mais influençable et fragile, qui perd pied par les manipulations qu'elle va subir. Avec un simple grain de sable dans les rouages harmonieux de la famille Levov - la vision de ce moine qui s'immole à la télévision - tout vole en éclats.
American Pastoral se retrouve alors en même temps un drame familial poignant magnifié par la prestation de son couple vedette, et une mise en abîme de la fragilité de la société américaine. Ou comment sa propension à l'extrême peut finir par détruire ses valeurs les plus sacrées. Ce qui touche le plus en réalité, c'est la relation entre un père et sa fille, une fille qu'il ne cessera de rechercher jusqu'à la fin et qui, selon toute évidence, est morte sans qu'il s'en aperçoive. American Pastoral parle donc du passage à l'âge adulte, de comment les enfants peuvent aller vers des horizons plus sombres où quoique l'on fasse, on ne pourra jamais les rattraper. A cet égard, American Pastoral reste un grand film triste jusqu'à sa scène de fin magnifique mais tragique en diable. On retrouve dans cette dernière partie la lourdeur didactique imposée par le choix narratif de départ mais la force émotionnelle dégagée amoindrit quelque peu ce défaut.
Pour une première réalisation, et malgré un académisme certain ainsi que des choix narratifs discutables, American Pastoral s'avère un film de qualité. Ewan McGregor assure deux rôles extrêmement difficiles en s'en sortant franchement de belle manière pour accoucher d'un long-métrage poignant et sombre sur les travers d'une société américaine qui n'en a pas fini avec ses vieux démons.Note : 8/10
Meilleure scène : Swede découvrant sa fille en banlieue
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 8 Janvier 2017 à 18:39
Certains mystères continuent à planer sur le cinéma hollywoodien. L'un des plus impénétrables pourrait être la disparition quasi-totale d'immenses acteurs qui finissent par croupir dans des métrages de seconde zone. Prenons, au hasard, Beauté Cachée de David Frankel (un nom qui ne vous dis rien mais qui est à l'origine Du Diable s'habille en Prada ou encore de Marley et moi), ce film rassemble un casting tout à fait époustouflant avec, en tête, le génial Edward Norton, la formidable Helen Mirren et l'excellente Kate Winslet (on reparlera du cas Will Smith plus tard...). Un trio d'acteurs presque tombés dans l'oubli de façon totalement...incompréhensible. On les retrouve donc au casting de Beauté Cachée, film choral mélodramatique qui, ne le cachons pas, résume toutes les choses détestables de ce sous-genre lorsqu'il est bouffé par le système Hollywoodien. Un résultat d'autant plus pathétique que l'idée de départ, elle, n'est pas forcément mauvaise.
En effet, Beauté Cachée nous parle de la descente aux enfers d'Howard Inlet, chef d'entreprise et publicitaire New-Yorkais, qui n'arrive pas à surmonter la mort de sa fille. Pour l'aider (et aussi un peu pour sauver leurs miches), ses trois plus "proches" amis vont faire intervenir des acteurs pour incarner la Mort, l'Amour et le Temps, des abstractions chères à Howard et auxquelles il écrit depuis un certain temps. Malgré un arrière-goût déjà assez sirupeux (on sent que l'on peut glisser à tout moment dans le tire-larmes facile), le postulat pourrait être intéressant au vu du casting assez hallucinant engagé. Le problème, et on s'en rend compte dès les premiers instants, c'est que Beauté Cachée n'est qu'un projet de commande lambda sans âme, sans talent et bouffé de tous les côtés par des hordes barbares de clichés.
Le problème le plus évident, c'est évidemment le scénario. Tout dans Beauté Cachée est d'une prévisibilité sans nom. A moins d'avoir vécu dans une grotte les dix dernières années et n'avoir jamais vu un seul film mélodramatique, tout se devine à l'avance. Cette incapacité à ménager la moindre surprise aurait cependant pu être compensée par de beaux personnages...et là, c'est encore le drame. Caricatures sur pattes ne servant qu'à s'imbriquer dans un scénario cousu de fil blanc, les héros de l'histoire n'ont en fait qu'une seule facette qui permet d'ébaucher sur chacun d'entre eux une sous-intrigue. De ce fait, les trois amis d'Howard sont liés à l'un des trois acteurs qu'ils engagent et Frankel morcelle son récit pour en faire une sorte de simili-film choral. En anémiant son histoire principal, il se doit donc être d'une subtilité éléphantesque pour tout régler dans le temps imparti. Donc, les acteurs qu'il dirige jouent sans aucune conviction, juste là pour encaisser leur chèque. Tout ce rassemblement de talents pour rien en somme....Arriver à faire jouer de façon totalement oubliable Norton et Mirren reste tout de même un sacré exploit en soi.
Il faut alors reparler du cas Will Smith, un peu sensé être le centre de tout ça. En réalité, Will Smith fait du Will Smith. Depuis un certain temps, celui-ci ne fait que répéter ad vitam aeternam le même rôle larmoyant avec un père qui pleurniche sur son enfant. Will Smith tend à devenir l'empereur du tire-larme facile mêlé à une espèce de cool-attitude qui finit par agacer. Un pur produit Hollywoodien alors qu'il avait à la base un potentiel sympathie énorme. Forcément, Beauté Cachée semble taillé pour lui. Le film s'avère tout à fait incapable de sortir de son carcan de drame affligeant où il faut pleurer mais...quand même à la fin...on doit avoir le sourire parce que même si tu vas crever, même si tu es divorcé, même si tu vas finir vieille fille, même si ta gosse est morte...la vie est pas si mal quoi. Merde, on peut quand même faire des ballades à Central Park et voir des écureuils. Beauté Cachée n'a rien compris au potentiel de son postulat de base et on soupçonne qu'il n'en a jamais rien eu à faire en réalité.
Qu'est-ce qui peut alors rattraper le métrage ? Ce n'est ni la mise en scène banale au possible, ni la musique sans saveur, ni même son pseudo-twist de fin que tout le monde a compris depuis le début. Vous pleurez très certainement devant Beauté Cachée de David Frankel mais pas pour les raisons attendues. On cherche toujours l’intérêt de ce genre de film, à part de payer les impôts de Smith et compagnie.
Note : 1.5/10
Meilleure scène : Euh...
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 1 Janvier 2017 à 16:34
TOP CINE 2016 - JUST A WORD
Ce top a été composé après visionnage de 96 films au cinéma sortis cette année 2016.
10 - Nocturama de Bertrand Bonello
Et si l'on commençait ce top par un film français ?
Nocturama, c'est le dernier bébé de l'excellent Bertrand Bonello qui nous démontre avec brio que le malaise de la société moderne va bien plus loin que ce que constate les journalistes. Après une première partie en apesanteur, Bonello traîne son regard de vieux révolutionnaire déçu sur une jeunesse sacrifiée qui ne sait plus comment exister et combattre. C'est aussi beau que fort et ça prouve que le cinéma français vit encore quelque part !
>>>>> CRITIQUE9 - Ma Loute de Bruno Dumont
Encore un film français ?
Avec Ma Loute, nouvelle dinguerie signée Bruno Dumont, le top 2016 est bien représenté sous nos latitudes ! Accompagné d'une bande de joyeux drilles tous plus loufoques les uns que les autres, Bruno délivre un chant d'amour à sa région du Nord en s'en gaussant à outrance avec une caméra virtuose, un humour improbable et un sens de la mise en scène impressionnant. L'un des films les plus drôles et les plus jusqu'au-boutistes de l'année !
>>>>> CRITIQUE8 - La Tortue Rouge de Michael Dudok De Wit
Le film d'animation à l'occidental est-il mort dans l'ombre de l'anime japonais ?
Avec la fusion de ces deux univers, Michael Dudok De Wit nous démontre qu'il n'en est rien. Petit joyaux brut inattendu, La Tortue Rouge est un monument de poésie muet où la beauté se cache dans la moindre image. Ode à la vie, au temps qui passe, à la nature et tout simplement à l'amour, La Tortue Rouge émerveille de la première à la dernière seconde. Le film d'animation de l'année !
>>>>> CRITIQUE7 - Comancheria (Hell or High Water) de David MacKenzie
L'année 2016 réservait au moins une authentique surprise avec Comancheria de David MacKenzie. L'auteur de Perfect Sense nous offre rien de moins qu'un des meilleurs films de l'année et cela en toute discrétion. Passé inaperçu en salles sauf pour une poignée de cinéphiles avertis, Comancheria revisite le western à la sauce sociale, charge une Amérique en train de se bouffer elle-même et offre un portrait de frères touchant en diable. Une véritable merveille.
>>>>> CRITIQUE6 - The Witch de Robert Eggers
Catégorie injustice, voici The Witch.
Sorti directement en DVD, ce film d'horreur arrive pourtant à mettre une bonne claque à 99% des long-métrages sortis en salles. Dans une Amérique puritaine, une famille va découvrir l'horreur à l'orée d'une forêt pleine de mystères. Avec une économie de moyens tout à fait remarquable, Robert Eggers vous donne la chair de poule en filmant un lapin et un bouc. Redoutablement intelligent et incroyablement mis en scène, The Witch ne laisse personne indemne. Et c'est un premier film...
>>>>> CRITIQUE5 - Jodorowsky’s Dune de Frank Pavich
Après The Look of Silence l'année dernière, c'est cette fois Jodorowsky's Dune qui gagne la place du documentaire de l'année ! Frank Pavich ébauche un film passionnant sur un projet mythique qui n'a jamais vu le jour mais semble couvrir de son ombre toute la production moderne. Tour à tour truculent, hilarant et passionnant, le documentaire émerveille par la passion qui en suinte par tous les pores. C'est jubilatoire de bout en bout et ça fait du bien à notre cœur de cinéphile !
>>>>> CRITIQUE4 - The Revenant d’Alejandro González Iñárritu
Premier choc cinématographique de l'année, The Revenant n'a pas que permis à Di Caprio de recevoir l'oscar mais de confirmer l'incroyable talent du réalisateur mexicain. Pièce de choix du survival, The Revenant offre un moment de cinéma confinant au sublime dans une première séquence à couper le souffle puis en émerveillant à chaque seconde par la beauté maniaque de ses plans. En y ajoutant une dimension mystique passionnante et une pléiade d'acteurs formidables - Tom Hardy en tête - The Revenant entre dans l'histoire. Prenez une doudoune quand même.
>>>>> CRITIQUE3 - Premier Contact de Denis Villeneuve
Voici donc le podium de l'année en commençant par Premier Contact de Denis Villeneuve.
Basé sur le texte de Ted Chiang, Premier Contact déjoue les pièges du blockbuster américain et se concentre sur l'intime devant tout le reste. Porté par une Amy Adams en état de grâce, le film de Villeneuve montre à nouveau le talent de mise en scène fabuleux du canadien. Véritable chant d'amour à une Science-fiction de l'humain, Premier Contact émeut. Devant l'immensité spatiale, c'est bien tout ce qui compte. La vie comme un palindrome.
>>>>> CRITIQUE2 ex-aequo - Mademoiselle de Park Chan-Wook
Tricherie éhontée dans ce top ! Un ex-æquo !!!!!
Eh bien oui, devant l'impossibilité de faire un top 3 digne de ce nom, Mademoiselle de Park Chan Wook se retrouve ex-æquo ! Oeuvre incroyablement sensuelle et dense, Mademoiselle consacre de nouveau le réalisateur coréen comme un artiste de toute première catégorie. Mise en scène à tomber, musique raffinée et héroïnes extraordinaires, Mademoiselle incarne la quintessence du cinéma dans tout ce qu'il a de sensuel. En réalisateur machiavélique, Park Chan-Wook nous tient au creux de sa main pour mieux nous faire jubiler avec des plaisirs inavouables !
>>>>> CRITIQUE2 ex aequo - Steve Jobs de Danny Boyle
La surprise du podium de cette année, c'est bien l'apparition d'un biopic sur la seconde marche.
Danny Boyle profite de l'expertise d'Aaron Sorkin pour livrer un long-métrage tout simplement extraordinaire sur un homme fascinant : Steve Jobs. Pensé comme une pièce de théâtre, Steve Jobs offre des dialogues succulents accompagné par une mise en scène qui n'en finit pas d'épater le spectateur pendant qu'un certain Michael Fassbender vole le show à lui seul. En contournant les pièges du biopic classique et en donnant sa vision de l'homme devant le génie, Boyle et Sorkin ont tout compris. Et si l'amour d'une fille était tout ce qui comptait en réalité ?
Juste sublime.
>>>>> CRITIQUE1 - The Neon Demon de Nicolas Winding Refn
La beauté est tout.
Vainqueur de cette année 2016, le film-expérimental de Nicolas Winding Refn laisse un peu tout le monde sur le carreau. Dans une ambiance qui vire peu à peu vers le glauque, The Neon Demon se révèle une véritable oeuvre d'art ciselée dans les moindres détails par un artiste fou. Parabole sur le monde moderne de l'apparence à tout prix, le long-métrage vous chope à la gorge pour vous murmurer à l'oreille que votre existence n'a aucun but. Que vous serez dévoré par le système. Plastiquement irréprochable, thématiquement terrifiant, The Neon Demon s'arroge la première place pour cliver encore un peu plus son monde.
Hail to the king !>>>>> CRITIQUE
Les Coups de Cœur :
- Captain Fantastic de Matt Ross -- Critique
- Paterson de Jim Jarmusch -- Critique
- Vaiana de John Musker et Ron Clements
- Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson -- Critique
- Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar
- Ma Vie de Courgette de Claude Barras -- Critique
- L’effet aquatique de Solveig Anspach
- Men & Chicken de Anders Thomas Jensen -- Critique
- Batman vs Superman de Zach Snyder -- Critique
- Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 4 Décembre 2016 à 19:40
Attendu au tournant, Moi, Daniel Blake de Ken Loach a beaucoup fait parler de lui depuis sa présentation au festival de Cannes cette année. Pourquoi cela ? Parce que le film a été récompensé par rien de moins que la Palme d’or, la récompense suprême de la Croisette. Le problème là-dedans c’est que non seulement un certain nombre de films méritait bien davantage la Palme (Qui a dit Mademoiselle ?) mais qu’en plus Ken Loach est un réalisateur très (très) connu à Cannes. Il avait déjà décroché la Palme en 2006 pour Le Vent se lève ainsi que trois Prix du Jury. Dire qu’on soupçonne George Miller (le président du jury 2016) d’un délit de copinage est un doux euphémisme. Cependant, comme cela doit toujours être le cas, il faut d’abord voir le film en question avant de pouvoir juger du bien-fondé de cette récompense et de la hype qui l’accompagne.
Moi, Daniel Blake est un film social. Cela ne surprendra personne de la part d’un Ken Loach toujours très engagé même à l’âge de 80 ans. Il nous présente donc Daniel Blake, un veuf de 59 ans qui a perdu son travail de menuisier suite à un infarctus sur le lieu de son travail. Désirant plus que tout reprendre son activité, il demande donc une aide sociale en attendant de pouvoir travailler de nouveau. Sauf qu’on lui refuse et qu’il tombe alors dans les méandres Kafkaïens du Pôle Emploi anglais et des services sociaux attenant. Il y fait la rencontre d’une jeune femme, Katie, mère célibataire de deux enfants, qui survit tant bien que mal en attendant que les services sociaux daignent lui venir en aide.
Film lent mais rageur, Moi, Daniel Blake pose son personnage principal avec une habilité remarquable. Daniel est le type même de vieux bougre qui ne mâche pas ses mots dans une société où tout a l’air de foutre le camp. La réalisation très sobre et très naturaliste de Ken Loach fait des merveilles dans un Londres froid et souvent déshumanisé qui ne trouve un peu de chaleur qu’à la lumière de ces « parasites ». Moi, Daniel Blake a donc un défaut assez évident : il n’a quasiment aucune nuance. Il s’agit là d’un film à charge et il ne montre que les valeureux écrasés par le système. Il ne fait état d’aucun profiteur ou d’aucun abus. Dans le monde vu par la loupe de Loach, tout le monde est opprimé, est victime, personne n’est profiteur. Le manque de nuance a parfois tendance à agacer, mais c’est sans compter sur la rage qu’il reste au réalisateur. Non seulement à travers deux personnages magnifiques, Katie et Daniel, mais aussi à travers la relation qui en ressort, cette tendresse instantanée qu’on a pour ces deux-là. Le portrait humain n’a rien à se reprocher, même s’il semble être le seul modèle concevable pour le cinéaste.
C’est ici que cette critique prendra pour le lecteur habituel de ce site une tournure inattendue. Il n’est ordinairement jamais question de point de vue politique ici mais…pour une fois…
Moi, Daniel Blake s’apprécie et ne se conçoit pas en dehors d’une perspective politique et sociale. Oui, le film n’a pas de nuance. Oui, Ken Loach voit tout de façon très caricaturale, parfois avec bonheur (l’administration froide et mécanique, totalement déshumanisée) parfois avec trop de naïveté (le gentil voisin qui fait de la contrefaçon).
Mais Moi, Daniel Blake est un film nécessaire, un film qui fait du bien. Sortez de chez vous, allez-y.
Regardez les trottoirs. Regardez ces gens-là qui crèvent de faim, de froid, de tout. Ces gens qui vous culpabilisent quand vous passez à côté, que vous ne donnez pas assez ou pas du tout alors que vous-même, souvent, vous êtes écrasés par les impôts d’un état totalitaire qui ne dit plus son nom. Ken Loach donne une voix, une dignité à ces gens-là, à ces crève-la-faim qui ne sont pas là pour vous sucer le sang mais pour vivre décemment, qui veulent juste un toit, à bouffer et un travail. Quand votre président gagne rubis sur l’ongle, que vos députés se goinfrent comme des porcs, quand vos footballeurs gagnent des millions, quand les grands du CAC 40 se caviardisent.
Entendre Daniel Blake fait un bien fou, c’est un cri de raison dans une société moderne capitaliste devenue folle, devenue monstrueuse. Dénuée de toute parcelle d’humanité.
Mais là où Ken Loach touche au sublime, c’est lors d’une séquence à la banque alimentaire.
Dans celle-ci, Katie, qui se prive depuis des jours pour que ses enfants puissent manger, ouvre une boîte de conserve en catimini pour pouvoir manger des haricots froids parce qu’elle a « tellement faim ». Cette séquence est terrible, glaçante, magistrale. Sans musique, sans emphase, avec juste sa caméra et rien d’autre, Ken Loach capture l’indicible de notre société. Une femme qui pleure parce qu’elle a honte de mourir de faim.
Parce qu’elle a honte de mourir de faim !
Cette scène, emblématique de la rage du film et de sa charge totalement sans nuance fait autant de bien que de mal au spectateur. Rien que pour ça, rien que pour les milliers de personnes dans ce cas, ballottées par des services sociaux débiles et des gouvernements qui nous apprennent à nous détester entre petits plutôt qu’à les brûler vifs eux pour nous laisser crever, rien que pour ça Moi, Daniel Blake n’est pas le film mauvais ou insuffisant qu’on nous a vendu. Au contraire, il s’agit d’un excellent film.
Le long-métrage de Ken Loach ne méritait pas la Palme d’Or cette année à Cannes d’un point de vue purement cinématographique. Mais cela n’enlève en rien ses qualités. Le cinéaste pousse un cri de douleur, un cri feutré dans ce monde moderne absurde, aidé par deux comédiens extraordinaires – Dave Johns et Hayley Squires – et par une réalisation d’une sobriété exemplaire. Pas de musique, juste des mots, juste des êtres humains qui, l’espace d’un film, redeviennent autre chose que des invisibles.
Bravo Mr Loach !
Note : 8.5/10
Meilleure scène : La banque alimentaireSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 10 Novembre 2016 à 18:10
Parfois, on s'imagine les réunions de projets des producteurs Hollywoodiens, surtout dans l'industrie de l'animation.
Par exemple, comment un jour une personne a pu se dire "Tiens, et si on faisait un film sur des Legos ?" ou "Tiens, si on faisait un film avec des saucisses ?".
Ou comment un scénariste ou producteur a pu regarder cette figurine culte des années 80-90, le fameux Troll de la société Dam Things et se dire : "Wahou, ça ferait un super film d'animation ?"Non, parce que, franchement, vu comme ça, c'est pas vraiment la première chose à laquelle on pense. Pourtant, c'est bien ce que Dreamworks a fait en confiant le projet à Mike Mitchell et Walt Dohrn qui avaient surtout bosser sur Bob L'éponge et Shrek auparavant. Pas de quoi être rassuré à priori surtout si l'on rajoute que c'est Justin Timberlake qui supervise la partie musicale.
Soyons cependant juste quelques minutes. En effet, Lego : The Movie ne fut pas seulement une bonne surprise mais une petite bombe animée délicieuse et complètement malade, Sausage Party bénéficie quand à lui d'une remarquable presse outre-Atlantique. Alors quand on regarde ce projet totalement improbable, on a envie de se dire "Pourquoi pas ?"
Et justement...pourquoi pas...
Premier défi pour les réalisateurs, inventer une histoire derrière de simples figurines. Nous sommes dans le pays des Trolls, d'adorables créatures à la chevelure pour le moins détonante, qui adorent chanter, se faire des câlins et dire tout plein de choses gentilles. En gros, les Trolls sont des bisounours version pop-rock. Le problème, c'est que leur joie de vivre leur donne un goût particulièrement délicieux pour le palais des Bergen, des sortes de trolls au vrai sens du terme avec le physique qui va avec. Devenus des mets précieux pour les Bergen et enfermés dans un arbre-prison pour la dégustation annuelle des Bergens, les Trolls retrouvent espoir grâce à leur roi qui les emmène dans une contrée lointaine pour vivre en harmonie. Le souvenir des Bergen s'effaçant, la fille du roi, Poppy, ainsi que ses amis Trolls, oublient ce qu'était le danger. Seul un Troll continue à vivre en reclus dans un bunker en attendant le retour de la menace Bergen. Le sinistre Branche qui ne chante pas, n'aime pas les câlins et refuse de se mêler aux autres. Jusqu'au jour où la terreur resurgit.
Expliqué de cette façon, le scénario des trolls ne restitue pas la folie de l'entreprise parce que, soyons clairs, à l'écran c'est un festival de WTF pendant les trente premières minutes. Les Bergens sont des monstres grotesques qui bouffent des Trolls pour ressentir un peu de bonheur, les Trolls sont des caricatures sur pattes de bisounours sous amphet avec des personnages carrément improbables parmi eux - une chenille qui ne sait pas parler, une espèce de...créature au long cou en miniature qui défèque des cupcakes, un Trolls boule à facettes qui crache des paillettes...Mais quest-ce que c'est que ce film ? En plus d'une histoire tirée par les cheveux - c'est le cas de le dire - Trolls affiche fièrement un tas de personnages improbables qu'on dirait inspirés d'un univers à la Pratchett...et ça tombe bien puisque les réalisateurs avouent s'en être inspiré avec Le Grand Livre des Gnomes. On comprend mieux pourquoi l'on obtient un résultat aussi étrange et farfelu.
Certes le cheminement du film ne sera pas extraordinairement original mais il compte un sacré paquet de séquences hallucinogènes et d'idées excellentes. A commencer par Branche, le Troll en noir et blanc qui n'aime personne ou, mieux, le petit roi Bergen et sa servante follement amoureuse de lui. Deux mochetés hyper-attachantes et complètement inattendues. Les réalisateurs, conscients surement de l'improbabilité totale de leur scénario, s'en donnent à cœur joie. On arrive donc rapidement à une histoire fun, drôle et jouant constamment sur un côté WTF qui fait plaisir. Des délires comme un nuage avec des bras et des jambes...et qui parle ou une séquence de relooking à la Cendrillon de la servante Bergen. C'est cependant encore ailleurs que Trolls tire son épingle du jeu : Trolls est un film d'animation ET une comédie musicale en même temps.
Rythmé par des chansons modernes, le métrage aurait pu devenir une parodie populaire d'un Disney d'antan. Mais ce n'est jamais le cas car les multiples chansons choisies s'incluent avec bonheur dans l'histoire. Il suffit de voir The Sound of Darkness remixé pour plaire à Branche pour s'en convaincre. Cette utilisation malicieuse donne au film encore plus d'humour et même de profondeur émotionnelle. On parle ici bien évidemment de la magnifique séquence dans la marmite où les Trolls réinterprètent la chanson True Colors. A ce moment-là, le film arrive à toucher son public. En somme, si Trolls fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il ne se prend jamais au sérieux, s'amuse avec son postulat pour faire à peu près n'importe quoi dès qu'il le peut tout en laissant des prises plus classiques au spectateur...et parce qu'il est diablement beau. L'animation est en effet irréprochable et se permet quelques fantaisies comme les scènes en scrapbooking imaginées par Poppy. Décidément, Trolls regorge de surprises.
Voila. Encore une fois, un projet complètement...grotesque...se transforme en un film d'animation sympathique, drôle, attachant et souvent complètement jeté.
En tentant quelques petites choses délicieusement improbables, Trolls transcende son aspect banal pour devenir un divertissement fun utilisant la musique avec élégance et humour. Une bonne surprise qui vous laissera un grand sourire au lèvres et quelques notes sur la langue.
A voir ABSOLUMENT en VO par contre... le doublage français des chansons étant une catastrophe intégrale.Note : 7/10
Meilleure scène : La séquence True ColorsSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 6 Octobre 2016 à 18:45
Very Bad Guns
Connu pour sa trilogie Hangover ( Very Bad Trip en français...), l'américain Todd Philips n'avait pas particulièrement brillé après un premier volet fun et rafraîchissant. En tentant de changer de formule dans le dernier épisode en date, le réalisateur s'était pourtant un tantinet perdu, incapable de dépasser un schéma narratif bancal finissant par ennuyer poliment son spectateur. Il continue cependant dans la veine comédie avec War Dogs, un biopic sur deux marchands d'armes amateurs qui avait, sur le papier, beaucoup d'arguments pour séduire. A commencer par un beau casting rassemblant Miles "Whiplash" Teller, Jonah Hill et Bradley Cooper. Le problème, c'est bien de savoir si Todd Philips est capable de sortir de sa routine narrative comme il l'avait fait dans Very Bad Trip 3...tout en gardant un rythme et un sujet intéressant pour le public.
De quoi parle War Dogs ? De l'histoire authentique de deux jeunes américains, Efraïm Diveroli et David Packouz, qui s'en sont mis plein les poches durant la guerre d'Irak grâce à une astucieuse entreprise qui profitait des appels d'offres d'armes de l'armée américaine dont personne ne voulait. Les miettes en somme. Mais des miettes qui valaient un sacré pesant de cacahuètes pour monsieur tout le monde. C'est ainsi qu'en flouant la Défense, ces deux marchands d'armes ont réussi à décrocher un faramineux contrat qui finit par les perdre. War Dogs est donc une sorte de biopic vendu comme une comédie. C'est d'ailleurs là que le bât blesse.
De la comédie dans mon drame ?
Le problème, c'est que War Dogs n'est pas véritablement un film comique. Evidemment, les deux personnages principaux sont des gentils losers (enfin presque), qui n'iront jamais très loin. Jonah Hill s'en sort très bien dans un rôle tout de même assez ingrat en interprétant un Efraïm Diveroli jouissif mais dont le seul gag consiste en un ricanement qui finit par agaçer. En face, Miles Teller écope d'un personnage assez vu et revu, le brave gars qui se retrouve piégé dans une entreprise louche dans le but d'offrir ce qu'il se fait de mieux à sa femme et son enfant. Globalement pourtant, War Dogs n'est pas une franche comédie. Quelques gags font sourire le spectateur mais ça s'arrête là. Todd Philips mise en réalité sur un domaine plus délicat: le drame. En construisant son récit comme une histoire sérieuse, le cinéaste fait dans la redites. Il se confronte par la même à un poids lourd du genre : Lord of War d'Andrew Niccol.
Une fois cette notion en tête, on s'aperçoit très vite des similitudes entres les deux métrages. La lente montée en puissance de David, son envie d'impressionner sa femme et de vivre bien au-delà de ses moyens, ses entreprises de plus en plus dangereuses et embarrassantes d'un point de vue moral...et la chute, inévitable. Sauf que War Dogs n'arrive jamais à la cheville de ce maître-étalon. Todd Philips n'y peut rien, son film parait insignifiant. Il aborde un thème très fort, la vente d'armes, en ouvrant les portes sur un sous-texte contestataire important avec le rôle joué par les Etats-Unis...sauf qu'il n'en fait rien. Du tout. War Dogs reste du pur entertainement et n'a en réalité aucune épaisseur. Malgré son pompeux découpage en chapitres (qui ne sert à rien), le long-métrage ne sait pas où se placer ce qui finit par le ranger dans la catégorie : "vite vu, vite oublié".
Tir manqué
War Dogs n'a rien de désagréable à la vision. Il montre que Todd Philips cherche à se renouveler en explorant des domaines autres que celui de la pure comédie. Malgré cette bonne volonté, l'américain ne sait pas positionner son film et se décider sur la façon de traiter son sujet accouchant ainsi d'un objet filmique inoffensif. Quitte à choisir, revisionnez Lord of War.Note : 6/10
Meilleure scène : La traversée du triangle de la mortSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 25 Septembre 2016 à 23:10

Grand Prix Cannes 2016
Meilleur réalisateur pour Xavier Dolan Césars 2017
Meilleur acteur Gaspard Ulliel Césars 2017Enfant chéri de la critique cannoise, le canadien Xavier Dolan a encore frappé cette année sur la Croisette. Après le prix du Jury pour son merveilleux Mommy en 2014, il remporte cette fois le Grand Prix pour Juste la fin du monde. Dans un palmarès très contesté, le jeune cinéaste n’a pourtant pas été épargné par la critique. Premier film avec un casting français de prestige, Juste la fin du monde joue la carte de l’adaptation de la pièce de théâtre, en l’occurrence ici celle de Jean-Luc Lagarce. Clivant largement le public lors de sa diffusion, le métrage a-t-il vraiment mérité sa récompense ou Cannes a-t-il encore commis un délit de copinage de plus ?
Sur un thème relativement simple – mais très dur à traiter -, celui de l’annonce d’une mort prochaine, Juste la fin du monde s’enferme dans la maison familiale où tous les drames du passé sont restés piéger dans l’ambre, où les rancœurs sont encore chaudes et où les esprits un brin revanchards. Car Louis, personnage central de l’intrigue, revient après 12 ans passés à l’étranger et après avoir littéralement abandonné sa sœur, son frère et sa mère. On devine très vite que Louis vient dire une chose terrible à cette famille qu’il regrette mais qu’il ne sait absolument pas comment leur parler.
« J’ai peur d’eux » répète Louis durant ce huit-clos familial. Et l’on comprend rapidement pourquoi. On pénètre dans une sorte de cocotte-minute, où les émotions sont prêtes à péter, où l’on sent constamment la tension qui monte. Le style Dolan est toujours présent, le réalisateur choisissant de nouvelles expérimentations – encore plus radicales – en filmant presque constamment en plans serrés ou en gros plans ses personnages. On est donc capturés par les émotions ainsi qu’asphyxiés dans le même temps. Ce choix artistique s’avère vite à double tranchant. En enfermant son intrigue dans un lieu unique, le canadien redouble l’effet claustrophobe de son film en le conjuguant avec son choix de mise en scène. Le problème majeur qui se pose, et c’est une première pour un film de Xavier Dolan, c’est que le métrage tombe dans l’hystérie la plus totale ainsi que dans la logorrhée chronique de ses personnages.
Forcément, avec tant de ressentiment contre Louis, on sait dès le départ que les choses avec Antoine, son frère irascible, Suzanne, sa sœur perdue et Martine, la mère excentrique style Diane de Mommy, vont être compliquées et explosives. C’est ici que Juste la fin du monde perd son public. Les acteurs passent leur temps à crier, à s’engueuler, à s’emballer. Les longs tunnels de dialogues en tête-à-tête (le film fonctionne par confrontation entre Louis et un autre membre de la famille présente) se révèlent douloureux au possible. La palme revenant à l’entretien entre Louis et Suzanne, juste exécrable et inutile. Le film fatigue par ce mécanisme d’hystérie perpétuelle. Le spectateur se sent écrasé par les disputes et les cris, d’autant plus que tout se filme en gros plan. On est piégés et, franchement, c’est très désagréable à la longue.
On n’arrive en réalité bien vite à comprendre ce qu’a voulu tenter Xavier Dolan. Dresser le portrait douloureux d’un homme confronté à ses erreurs passées, à ses manques. Gaspard Ulliel, magnifique, erre de pièce en pièce chassant les vieux fantômes de sa mémoire. Dans ces instants de flash-backs stylisés, Dolan redevient égal à lui-même, c’est clinquant mais c’est outrageusement beau. Sauf que cela ne se produit que par fugaces instants mélancoliques. On regrette amèrement que le cinéaste se prenne les pieds dans le tapis tant on sent le potentiel d’émotion derrière. Un potentiel palpable lors de l’entrevue entre Nathalie Baye, la mère, et Ulliel dans un cabanon. Dolan excelle à filmer avec sincérité la relation mère-fils, cette fois encore. Ou surtout dans ce crescendo final où Cassel brille d’un coup dans cette colère foudroyante mais…qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Il manque la narration logique et charmeuse d’un Mommy. Il manque même l’extravagante musique des précédents films avec des morceaux qui sonnent faux ! Une première ! Une chanson de Moby très mal placée, une autre de Blink 182 qui n’a rien à faire là…bref, que se passe-t-il à l’école Dolan ?Il avait pourtant bien des cartes en mains pour briller. A commencer par un casting de stars-égéries qui font tout ce qu’elles peuvent pour être à la hauteur. Cassel est excellent, Ulliel aussi, Nathalie Baye se Dolanise de la meilleure des façons possibles, Léa Seydoux n’est pas insupportable…Et Marion Cotillard interprète le rôle le plus intéressant et le plus nuancé du métrage. C’est son personnage qui aurait mérité plus d’approfondissement encore, surtout qu’il est à la fois extérieur et intérieur à la cellule familial. Mais non, Xavier Dolan, patauge, ne retrouve que quelques éclats de sa grandeur bien connue et ne peut sublimer son sujet comme il sait pourtant si bien le faire…
Juste la fin du monde est le premier échec de la carrière du jeune Xavier Dolan. On voudrait aimer ce film plein d’émotions brutes, on voudrait vraiment mais c’est trop. Trop hystérique, trop asphyxiant, trop mal raconté,trop mal dosé…Le réalisateur passe à côté de son sujet. Du coup, on se demande avec un tel Grand Prix ce que nous réserve la Palme d’Or…Note : 4/10
Meilleure scène : Louis et Antoine plus jeunes en train de jouer - Louis et Martine dans le cabanon - La colère d'Antoine
Meilleure réplique : "J'ai peur d'eux"Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2016 à 18:29
Oscar 1961 du meilleur second rôle pour Peter Ustinov
En 1960, Stanley Kubrick entre à Hollywood par la grande porte. Son dernier film, Les Sentiers de la gloire, lui a permis d'attirer l'attention des majors et de gagner à sa cause un certain Kirk Douglas. Véritable pilier de l'industrie Hollywoodienne à cette époque, Kirk Douglas se met en tête d'adapter le roman d'Howard Fast sur grand écran. Narrant la fameuse rébellion de Spartacus à l'époque de l'empire romain, l'histoire présente un énorme potentiel commercial et artistique, d'autant plus que le péplum est alors un genre en vogue. Seulement voilà, Douglas doit d'abord composer avec la commission des activités anti-américaines qui a blacklisté Howard Fast mais également le génial Dalton Trumbo, soupçonnés tous deux d'être des agents communistes. Trumbo va tout de même finir par être crédité avec l'appui acharné de Kirk Douglas. Autre problème, peut-être encore plus important, le réalisateur de Spartacus ne convient pas à Kirk Douglas. David Lean ayant refusé, c'est Anthony Mann qui prend le relais mais celui-ci est viré au bout de 2 semaines de tournage pour être remplacé par Stanley Kubrick lui-même. Un pari risqué, à la fois pour l'acteur Hollywoodien et pour le réalisateur alors en pleine ascension.
Souvent décrit par Kubrick comme son film le plus impersonnel, Spartacus n'en reste pas moins un énorme blockbuster à l'ambition dévorante ainsi que le témoin de toute une époque. Il faut tout de suite clarifier les choses quand à la parenté du métrage. Stanley Kubrick garde ici son sens de la mise en scène (les scènes de bataille et l'icônisation des personnages) et donne une authentique patte visuelle au film. Le problème, c'est qu'en effet, Spartacus n'a presque rien de Kubrickien. Si l'on excepte une ambiance de fin du monde lorsque l'on sait Spartacus voué à la défaite et la description particulièrement sanglante (pour l'époque) qui en est fait, les thèmes récurrents du réalisateur américain n'apparaissent simplement pas. La raison en est assez simple : Spartacus est un film de Kirk Douglas et Dalton Trumbo avant toute chose. Se faisant, le résultat peut laisser perplexe dans la filmographie du cinéaste qui semble ici perdre l'âme de son cinéma pour mettre son talent de metteur en scène au service d'un divertissement de haute volée. Voilà pourquoi Spartacus apparaît à la fois comme une mauvaise et une bonne chose dans le parcours de Kubrick.
Spartacus raconte l'histoire archi-connue de l'esclave du même nom qui se révolta contre l'Empire Romain. Histoire aussi héroïque que tragique, la légende de Spartacus devient une fresque impressionnante entre les mains de Kubrick, Douglas et Trumbo. Le film profite d'une distribution royale, d'un budget colossal qui se ressent constamment à l'écran (notamment la dernière scène de bataille hallucinante par son ampleur) et de fils narratifs ambitieux, même si imparfaits. On retrouve dans Spartacus tout ce qu'affectionne le grand Hollywood : un héros magnifique, une histoire d'amour passionnée et tragique, un combat pour la liberté et des sous-intrigues politiques passionnantes pleines de coups bas. A première vue, Spartacus est l'archétype du film Hollywoodien. Sauf que.
Sauf que derrière cette histoire se trouve un certain Dalton Trumbo et qu'en y regardant de plus près, il transforme l'histoire de Spartacus (avec entorses historiques et anachronismes tout du long) en une charge anti-américaine et, plus généralement, anti-capitaliste, incroyablement audacieuse. Si l'on prend le film au premier degré, on se retrouve devant un homme se battant pour la liberté et la libération du joug d'un empire tyrannique, célébrant ainsi certaines valeurs américaines traditionnelles. Mais si l'on creuse et qu'on regarde de plus près, le message s'inverse. Spartacus incarne en réalité l'homme pré-communiste et devient en cours de route le porte-étendard d'une conception communiste de la société où l'esclave (le prolétaire) se libère des chaînes de l'exploitation d'un empire où le riche écrase le pauvre et où la corruption gangrène tout (l'Empire Romain/Américain). En assumant de ce fait que l'Empire Romain soit une métaphore de l'Empire américain, et Spartacus le porte-étendard de la révolution des pauvres et des exploités, le sénat présenté dans le film se divise entre Démocrates (Gracchus) et Républicains (Crassus). Là où Trumbo va encore plus loin c'est lorsqu'il présente la mort de Spartacus, héros communiste naturellement adulé par le public, comme un écho du Christ sur la croix. En somme, le peuple américain, aveuglé par ses dirigeants, crucifie son propre sauveur. Trumbo accomplit là un tour de force scénaristique incroyable, parfaitement retranscrit par le jeu d'un Kirk Douglas toujours impeccable et qui porte littéralement le film sur ses épaules. On pourra même s'amuser (dans la version longue) à débusquer la scène aux connotations homosexuelles insérée par Trumbo entre Antoninus et Crassus.
Derrière ce scénario d'une redoutable intelligence, on trouve également un divertissement de haute volée qui préfigure largement des films comme Gladiator de Ridley Scott bien des décennies plus tard. L'intrication des fils politiques, historiques et amoureux forcent le respect et permet de capter l'attention du spectateur sur la colossale durée de 3h17 (!!). Ne reniant pas quelques doses d'humour bien senties grâce au truculent personnage de Peter Uslinov, aka Batiatus, Spartacus n'ennuie jamais. Au contraire, il passionne et offre tout ce que l'on recherche dans un blockbuster d'honnête facture, voir même bien plus en y regardant à deux fois. Ne reste alors qu'à déplorer un certain manque d'ambition visuelle. Loin des travellings des Sentiers de la Gloire, Spartacus semble rendre Kubrick plus sage, plus prévisible. On reconnait encore de-ci de-là l'élégance du réalisateur, mais rien de comparable à ce qu'il donnera par la suite.
Ce détour Hollywoodien laissera un gout amer dans la bouche de Stanley Kubrick qui reprend de ce fait les chemins d'un cinéma plus personnel et moins clinquant. Spartacus restera cependant un classique intemporel qui continue de fasciner à l'heure actuelle. Certainement l'un des péplums les importants de l'histoire du cinéma.Note : 8.5/10
Meilleures scènes : La bataille - Spartacus sauvé par ses hommes après la défaiteSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 3 Septembre 2016 à 13:03
Ils sont sept jeunes français, de toute origine, de tout horizon.
Rien ne devrait les réunir. Du moins rien en apparence. Ces sept jeunes vont pourtant commettre un attentat au cœur de Paris en combinant leurs efforts. Un coup de semonce contre la société capitaliste qui les a oublié et qu'ils ne supportent plus.
Minutes après minutes, les choses se mettent en place, l'inéluctable s'annonce avec force. Pour échapper au châtiment policier, ils s'enferment alors dans un grand centre commercial au cœur de la capitale. Et là...les choses changent, les révolutionnaires tombent le masque.
Bertrand Bonello s'était déjà fait fortement remarqué avec L'Apollonide et, davantage encore, avec Saint-Laurent. Acclamé pour sa mise en scène, le réalisateur français s'attaque cette fois à tout autre chose. Un sujet brûlant et délicat. Il choisit en effet de filmer des attentats au cœur de Paris, sombre réminiscence du Bataclan pour nombre de spectateurs. Inspiré très librement par le Glamorama de Brest Eastin Ellis, Nocturama nous entraîne dans notre monde au travers des yeux de plusieurs jeunes désenchantés. La violence de son sujet ne doit pourtant pas faire perdre de vue que Bonello ne se résume pas à un cinéma d'apparat. Pas de vide dans Nocturama mais une densité narrative qui sait gérer le silence et mettre en exergue les contradictions.
Le métrage se divise en deux.
D'abord, on suit les actions de plusieurs jeunes au cœur de Paris que rien ne semble lier de prime abord. Dans le plus grand silence, avec quelques lignes de dialogues discrètes au possible, Bonello filme la préparation d'un attentat. Dans des lieux à la banalité surprenante, dans un métro, dans un hôtel, dans la rue en fait. Sa caméra colle ses personnages, abuse du plan-séquence et des travellings pour figurer un labyrinthe urbain où le spectateur finit par se perdre. Dans ce monde très froid, le réalisateur met en scène un ballet mortel, un ballet où les humains deviennent des bombes en puissance, des tueurs de sang-froid, des êtres prêts à tout pour faire basculer le monde autour d'eux.
Dans cette première partie, Bonello ne dissémine que peu de sous-texte politique. C'est à peine s'il montre quelques coupures de presses sur la suppression d'emplois ou les ravages du capitalisme moderne. A peine s'il explique pourquoi ces jeunes ont décidé de tout faire péter. Et il a raison. La seule séquence du déjeuner aurait même pu suffire, quand deux jeunes de Sciences-Po expliquent une dissertation sur les régimes totalitaires et dressent, sans le dire, le plan du film dans son entièreté. Bonello est malin, il n'a pas besoin d'assommantes lignes de dialogues pour démontrer son théorème. Il postule qu'au fond, le spectateur sait.
Et oui, le spectateur sait.
Tout comme saura aussi cette étrange inconnue sur une place déserte qui dit à David que "ça devait arriver, c'était obligé". Cela semble inévitable, évident même, et pas besoin de l'expliciter pendant des heures. Le premier tour de force de Bonello, c'est de faire montrer cette évidence révolutionnaire, cette nécessité de révolte. Du coup, on pourrait croire que Nocturama serait un autre film incitant à la révolution. Sauf qu'il change du tout au tout dans sa seconde partie filmée en huit-clos dans un centre-commercial. A ce moment-là, Bertrand Bonello nous fait pénétrer dans l'intimité de ces personnages-fantômes qu'il nous a fait suivre auparavant. On pourrait alors s'attendre à de grands discours, à des envolées révolutionnaires.
Mais non.
Tout ce beau monde, qui semblait vouloir tant et pouvoir tant, ne fait rien. Nos jeunes révolutionnaires redeviennent des gosses ne se préoccupant en réalité que de jeux vidéos, de karting, de vêtements et d'autres choses triviales. Pire, ils deviennent dans cette partie tout ce qu'ils détestent : des consommateurs. Nocturama prend des allures de film désabusé, non seulement sur la société capitaliste qui broie l'humain, mais aussi et surtout sur l'inanité des révolutions. A quoi sert-il de se rebeller si ce n'est pour être que...ça. Cependant, soyons justes, Bonello ne nous dresse pas un portrait au vitriol de ses personnages, il ne cherche pas à les avilir. Il cherche à nous faire voir en quoi ils se révèlent d'une banalité tragique. Alors qu'au dehors on parle d'ennemis d'état, de terroristes sanguinaires...le spectateur voit des gamins. De simples gamins à la médiocrité banale, qui tentent de se rebeller, de s'affirmer mais ne poussent pas la chose comme il faut, qui sont piégés dans une société de consommation qu'ils haïssent pourtant. Le contraste entre intérieur/extérieur s'avère d'ailleurs saisissant. Dans le magasin, on pourrait presque croire que la vie quotidienne continue, le silence règne. A l'extérieur, Paris est une ville-morte arpentée par les sirènes, sorte de fresque apocalyptique en noir et blanc.
Reste alors la fin, brutale et sans concession, qui apporte encore davantage de questions au sujet exploré par Bonello. Y-a-t-il vraiment une issue ? Quand on tue des gamins sans se poser de questions ? Quand, justement, on ne se pose plus de questions. Nocturama laisse un goût de cendres, le cinéaste français ne transigeant pas avec son matériel politique et nous refilant une bombe à méditer. Un film d'autant plus atypique qu'il fait entrer en collision la fougue de la jeunesse et le regard désabusé des vieux de la vieille qui ont vu tant de révolutions échouées dans la médiocrité de ses instigateurs.
Nocturama mérite franchement toute votre attention.
Note : 9/10
Meilleure scène : La discussion du café - L'assaut vu par les caméras
Meilleure réplique : C'est facebook qu'on aurait du faire péter.Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 24 Août 2016 à 13:04
Convaincu par The Killing, MGM offre un budget confortable à Stanley Kubrick pour réaliser son prochain film. Le problème, c’est que le jeune cinéaste désire faire un film anti-militariste se déroulant durant la Première Guerre Mondiale. La MGM n’étant alors pas intéressé par un film de guerre, et encore moins par un film anti-guerre, le projet semble vouer à l’échec. Jusqu’à ce qu’un certain Kirk Douglas reçoive le script de Stanley Kubrick et se mette à soutenir le projet même si, selon lui, le film ne marchera pas en termes de recettes. Fort de ce soutien de poids, Kubrick entame donc le tournage des Sentiers de la gloire qui sort finalement dans les salles américaines en 1957.
Inspiré par des faits historiques, l’affaire des caporaux de Souain de mars 1915, Les Sentiers de la Gloire permet à Stanley Kubrick de revenir dans un domaine qu’il affectionne tout particulièrement : le film de guerre. Ce genre, qu’il n’avait pas approché depuis son Fear and Desire, lui permet de discourir sur des thèmes qui lui sont chers. Pour ce long-métrage, il nous raconte l’histoire du colonel Dax et de ses hommes du 701ième Régiment contraint par ordre de leur supérieur, le général Mireau, d’attaquer une position allemande réputée imprenable : Anthill. Malgré les réticences de Dax, celui-ci lance ses hommes à l’assaut et, évidemment, la forte résistance allemande cueille ses troupes en plein no man’s land. Le massacre est telle que la compagnie B, chargée de soutenir l’attaque, refuse de monter à l’assaut. Fou de rage, le général Mireau demande à ses propres batteries d’artillerie d’ouvrir le feu sur la compagnie B, indiquant qu’il s’agit de réprimer un acte de couardise et de traitrise. Le chef d’artillerie refuse et, devant l’échec de l’attaque, Mireau demande des sanctions à son supérieur, le général Broulard. Pour l’exemple, il faut fusiller 100 hommes du 701ième. Après maintes protestations, Dax arrive à faire réduire ce nombre à trois. Le caporal Paris, le soldat Ferol et le soldat Arnaud sont alors désignés pour être fusillés.
Ce sujet en or massif pour Stanley Kubrik lui permet enfin de révéler la pleine mesure de son talent. Fasciné par la guerre et par la folie humaine, Kubrick capture celle-ci avec une brillante acuité. Les Sentiers de la Gloire illustre la folie du général Mireau et, plus généralement, de la chaîne de commandement et de l’armée. Impossible de prendre Anthill, à moins d’être prêt à mourir comme un chien dans le no man’s land. Ce que les hommes de la compagnie B n’ont pas l’intention de faire, naturellement. En face, le général Mireau (et l’armée qu’il symbolise), est totalement en dehors des réalités. Pour tout dire, il est fou, aveugle et ne comprend pas ce qui se déroule devant ses yeux. Avec brio, Kubrik montre la folie totale de l’armée. On pourrait voir dans le métrage un plaidoyer contre la guerre, mais le cinéaste est plus fin. Il se sert des horreurs de la guerre, notamment à travers l’impressionnante séquence de charge dans le no man’s land par le Colonel Dax - où Kubrick utilise plusieurs caméras pour capturer tous les angles possibles - pour dénoncer la folie de la hiérarchie militaire et des puissants.
Profondément manichéen, Les Sentiers de la gloire ne souffre pourtant aucunement de ce manque de nuance. Tout simplement car il ne peut y en avoir vu les faits largement authentiques rapportés, mais aussi parce ce manichéisme illustre à merveille le propos anti-militariste du film. Il permet aussi à Kubrick de mettre en place des doubles, l’une de ses obsessions les plus profondes, avec le Colonel Dax et le Général Mireau. Le premier est aussi droit, moral et honorable que l’autre est vil, opportuniste et sans pitié. Si les deux hommes sont amenés à tant se détester au cours de l’histoire, c’est aussi parce qu’il se tende un miroir déformant l’un à l’autre symbolisant tout ce qu’ils détestent.
Cette charge anti-militariste s’accompagne d’une mise en scène prodigieuse. Très tôt dans le film, Kubrick étale son savoir-faire. Il suit d’abord le général Mireau en visite dans les tranchées, bien avant l’invention de la steady-cam, et nous convie dans un labyrinthe de boue, de sang et de folie. En quelques instants seulement, Kubrick capture toute l’essence de cette guerre de tranchées en faisant se balader un général propret et patriotique dans un enfer creusé par des hommes éreintés, épuisés et, pour tout dire, prisonniers. Pour peu, on se croirait à la fin du monde, dans les tranchées de l’Armageddon. Avec la maturité, Kubrick a appris à utiliser plus parcimonieusement les plans serrés sur ses acteurs. Lorsqu’il filme les trois soldats condamnés à mort, qu’il capture leur visage plein de peur, de larmes et de colère, cette fois, on est renversé. Renversé par le malheur de ces hommes, brillamment interprétés par Timothy Carey, Joe Turkel et Ralph Meeker. Chacun incarnant une réaction différente face à l’injustice : la peur, la colère, la résignation. La séquence de leur exécution restera l’un des points d’orgue du film.
Mais les Sentiers de la Gloire doit aussi beaucoup aux qualités de Kubrick en tant que directeur d’acteur. Kirk Douglas, déjà formidable à l’origine, y est parfaitement dirigé composant un colonel Dax inoubliable tant Kubrick l’immortalise sur pellicule comme une figure héroïque mais humble. Un homme capable de tout risquer pour sauver la vie de ses hommes et qui porte sur ces gueules cassées un regard attendri lors d’une scène finale carrément poignante. A cet instant, Kubrick réunit toutes ses qualités pour délivrer un message somme. Il nous montre des hommes aux instincts primaires beuglant dans un café, abrutis par la guerre et l’injustice, mais qui redeviennent humains par la chanson d’une allemande prisonnière, seule femme du film. Il capture alors les visages de ces anonymes qui ont fait la guerre et connaîtront pour beaucoup une mort inutile. Dax dévisage avec compassion ces types-là, avec plus d’humanité que tout le métrage n’en aura montré jusque-là.
Les Sentiers de la gloire représente la première consécration pour Stanley Kubrick.
Le film est si brillamment dérangeant qu’il sera interdit en France jusqu’en 1975 (soit pendant près de dix-huit ans !), en Suisse jusque 1970 et en Espagne jusqu’en 1986. Véritable charge anti-militariste, Les Sentiers de la gloire permet non seulement à Kubrick d’éclabousser de son talent le monde du cinéma mais également de lui ouvrir les portes d’Hollywood par l’intermédiaire de Kirk Douglas.
Pour le meilleur…et pour le pire.Note : 9.5/10
Meilleures scènes : L’exécution - La charge dans le no man's land - le caféSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Nicolas Winter le 21 Août 2016 à 18:59
Premier film de Stanley Kubrick avec une équipe professionnelle et un véritable budget, The Killing (connu en France comme L'Utime Razzia) sort en salles en 1956, soit un an après Killer's Kiss. C'est grâce à la rencontre avec le producteur James B. Harris que le jeune cinéaste fonde sa première société de production dans le but de racheter les droits du roman Clean Break de Lionel White. Entouré par le scénariste Jim Thompson et par le vétéran Lucien Ballard à la photographie, Kubrick se lance dans sa première réalisation d'envergure. Influence avouée des dizaines d'années plus tard par Quentin Tarantino pour son Reservoir Dogs, The Killing raconte le braquage d'un champ de courses avec une efficacité narrative redoutable. Pourtant, c'est peut-être l'un des films les moins Kubrickiens qui soit.
The Killing amène Kubrick dans un genre qu'on attendait pas forcément : le film de braquage. Supporté par une véritable équipe technique et, surtout, de véritables acteurs, le long-métrage s'avère d'emblée plus impressionnant que les deux précédents. En fait, on peut voir The Killing comme une démonstration du jeune cinéaste américain lui permettant enfin d'accéder à la notoriété. Ce qui entraîne plusieurs choses. D'abord, on ne trouve pratiquement aucune des obsessions de Kubrick dans l'histoire - exceptée peut-être la folie de George Patty en fin de métrage. Ensuite, The Killing se révèle le film le plus lisse et le plus propre jusqu'ici de l'oeuvre de Kubrick. On sent que tout y est calibré et millimétré pour montrer la maîtrise du réalisateur sur le plan technique et narratif. Il n'y aura pas cette fois d'affrontement dans un entrepôt de mannequins ou de questions existentielles sur la mort et la culpabilité.
En lieu et place, Stanley Kubrick construit une histoire de braquage dont le déroulement narratif force le respect. En employant le flash-back à bon escient et, surtout, en exploitant les divers points de vues des participants au dit braquage, le réalisateur arrive à tenir son spectateur en haleine de bout en bout. Sorti du travelling d'entrée, la réalisation se fait efficace et fonctionnelle, oubliant les tâtonnements d'un Fear and Desire ou la course-poursuite d'un Killer's Kiss. Les personnages restent assez caricaturaux mais servent à merveille l'histoire, faisant de The Killing une vraie réussite sur le plan du divertissement pur. Au-delà de celui-ci, et malgré la maîtrise évidente de l'ensemble, difficile de trouver le métrage exceptionnel. C'est certainement là le revers de la médaille pour l'entreprise de Kubrick et Harris.
L’enchevêtrement des fils narratifs a cependant pour l'époque quelque chose d'impressionnant. La multitude de points de vues permet à Kubrick se s'amuser à reconstituer un fait unique, le braquage, avec plusieurs angles d'attaques. On pourrait presque parler de film choral à certains moments. La fin, quant à elle, a quelque chose de délicieusement ironique avec cette conclusion toute simple de Johnny "What's the difference ?". The Killing n'a donc qu'un intérêt mineur dans la filmographie du réalisateur américain en terme de cinéma pur. Il reste cependant son film le plus important du point de vue de la reconnaissance artistique. Il fait en effet forte impression sur la critique de l'époque ainsi que sur la MGM. C’est le début de la grande aventure pour Kubrick attendu sur les sentiers de la gloire.
Film mineur au retentissement majeur pour Stanley Kubrick, The Killing n'en reste pas moins un excellent film de braquage, conventionnel d'autant plus à l'heure actuelle mais maîtrisé de bout en bout et d'une efficacité narrative redoutable.Note : 6.5/10
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 15 Août 2016 à 11:52
![[Critique] Killer's Kiss (Le Baiser du tueur)](http://ekladata.com/10-8vqaQSYtSG_abmyZcEQzpnXU@555x847.jpg)
En 1995, Stanley Kubrick a 26 ans. Franchement déçu par son Fear and Desire, il décide d’emprunter la coquette somme de 40.000 dollars à son oncle pour financer son deuxième film. Si cela fait de Killer’s Kiss un métrage quatre fois plus cher que le précédent, il reste un (très) petit budget. Désireux de tout contrôler, Kubrick enfile la casquette de réalisateur, de monteur, de co-scénariste, de producteur et de directeur de la photographie. Ironie de la démarche, ce sera tout de même United Artist qui disposera du final cut et imposera une happy-end. Considéré par le cinéaste comme sa vraie première réalisation, Killer’s Kiss s’avère un film personnel…et classique à la fois.
Stanley Kubrick quitte l’univers de la guerre pour revenir dans un New-York des années 50 où un boxeur du nom de Davey Gordon fait la rencontre de sa belle voisine danseuse : Gloria. Les deux jeunes gens tombent rapidement amoureux au grand dam de l’employeur de Gloria, le gangster Rapallo. Ce dernier décide de tout mettre en œuvre pour empêcher le départ de la femme qu’il aime. Ce postulat archi-convenu renvoie évidemment aux films noirs de l’époque et n’offre malheureusement pas beaucoup plus que ce qu’il laisse entrevoir de prime abord.
Stanley Kubrick reprend Frank Silvera pour interpréter Rapallo – on l’avait déjà aperçu dans Fear and Desire sous les traits du sergent Mac – et offre le rôle féminin à Irene Kane. On s’aperçoit immédiatement que ce second film corrige les nombreux défauts de son prédécesseur. Kubrick dirige mieux ses acteurs, apprend à gérer ses plans et son cadre…bref, l’américain prend ses marques. Film noir classique et, pour tout dire, assez cliché, Killer’s Kiss n’explore que de loin les thèmes chers à Kubrick. Cependant, il permet à celui-ci de filmer un sport qu’il affectionne tout particulièrement : la boxe. En un sens, il reste toujours un peu de Kubrick dans l’histoire.
Côté réalisation, tout s’améliore grandement. Si Kubrick n’est pas un scénariste à la hauteur (il ne le sera plus jamais par la suite), il offre cependant une remarquable scène en fin de métrage : la poursuite entre Rapallo et Davey. Celle-ci utilise au mieux l’espace des ruelles New-Yorkaises puis s’envole vers les toits des immeubles avant de terminer dans une usine de fabrications de mannequins. L’atmosphère qui se dégage de la scène se révèle très particulière. Pour dire vrai, et pour la première fois, on sent un peu la patte du cinéaste américain. Dans cet affrontement, les corps artificiels sont massacrés, lancés, piétinés, écrasés. Comme autant de victimes collatérales innocentes et muettes. Il est d’ailleurs assez cocasse de constater que Kubrick semble parfois plus occupé à filmer ces mannequins de plastique anonymes broyés à la hache que les combattants eux-mêmes. C’est véritablement cette séquence qui tire le film vers le haut et permet de l'extirper de l’anonymat total.
Il faudra pourtant attendre encore, car, malgré toute la bonne volonté du jeune Stanley Kubrick, Killer’s Kiss reste un film noir banal, bien filmé et agréable à suivre mais dépourvu de l’ambiance narrative de son prédécesseur. Anecdotique en somme.Note : 5.5/10
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 14 Août 2016 à 12:39
Longtemps introuvable sur le marché, Fear and Desire est le premier film d’un certain Stanley Kubrick. Tourné en 1953 avec un budget ridicule (pour ne pas dire inexistant) de 10 000 dollars, le long-métrage deviendra une source d’embarras pour celui qui sera appelé par la suite à devenir l’un des plus grands cinéastes du XXème siècle. Qualifiant lui-même ce premier film d’amateur, Kubrick a vainement tenté d’en détruire les copies en circulation. C’est en 2012 que le film ressort sur le marché et permet de se pencher sur l’œuvre de jeunesse d’un illustre inconnu à cette époque.
Très court, une heure au total, Fear and Desire n’est pas si dénué d’intérêt qu’on le clame souvent. Monté, joué et filmé en amateur il est vrai, le long-métrage s’intéresse à une troupe de militaires perdue en territoire ennemi. Accompagné d’une voix-off pesante, l’histoire prend place dans un lieu et une époque indéterminés, les soldats appartenant à des belligérants non identifiés. L’histoire reste assez simpliste puisqu’elle nous propose de suivre l’échappée des quatre hommes. On assiste à plusieurs rebondissements, notamment la rencontre avec une jeune femme et la découverte d’un quartier général non loin de la rivière.
Ecrit par un ami de Kubrick, Howard Sackler, Fear and Desire reste cependant intéressant dans la filmographie du réalisateur. Maladroit, le film l’est sans aucun doute. On relève un certain nombre de faux raccords, une tendance aux gros plans ennuyeuse et un montage hasardeux…mais qui tente quelques petites choses. En réalité, Fear and Desire porte en lui les germes d’un réalisateur qui se cherche. On sent que Kubrick tente de dégager des idées, notamment en saisissant dès que possible ses personnages en plan serré, comme pour capter leurs pensées, leurs démons intérieurs. De même, son cadrage étonne par son efficacité. De fait, même si Fear and Desire n’a rien d’extraordinaire, il présente déjà quelques marottes de l’américain.
On retrouve en effet un récit de guerre qui évoque déjà la noirceur d’un Full Metal Jacket, une fascination pour la folie qui s’incarne dans le jeune soldat chargé de garder la femme capturée ou encore un propos sur la violence prépondérant. En ajoutant l’idée simple de faire jouer les soldats ennemis par les mêmes acteurs que les personnages principaux, Kubrick affirme déjà une tendance à brouiller les pistes, à questionner le sens de la réalité ainsi que de la culpabilité. Ainsi, malgré la faiblesse générale de cette première œuvre, Fear and Desire apporte un propos noir quasiment poétique par moments (la voix-off du sergent sur le radeau ou celle du général se questionnant sur le lieu de sa mort) que l’on retrouvera bien plus tard dans la filmographie du cinéaste.
Amateur, Fear and Desire n’est pas en soi un film marquant, loin de là même. Il intéressera avant tout les spectateurs curieux des débuts d’un cinéaste hors pair. Au-delà des faiblesses du long-métrage, on y décèlera pourtant un propos pas si innocent et bien plus captivant qu’il n’y parait.Note : 4.5/10
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 11 Août 2016 à 21:10
Il arrive des jours comme ça où le temps est beau, les oiseaux chantent, les marmottes font leur toilette.
Des jours où tout semble aller bien dans le meilleur des mondes.
Innocents, insouciants, on va se faire un petit film au cinéma du coin. Titillé par la nostalgie des années 90, on prend un ticket pour la suite d'Independence Day, ce métrage signé Roland Emmerich sorti en 1996.
Alors, oui, il faut être d'une grande naïveté pour croire que l'homme qui a commis 2012 pouvait encore sortir un divertissement coupable et décomplexé correct avec des aliens et des grosses explosions. Mais on se dit que la vie peut être surprenante, qu'un jour Luc Besson finira par faire un bon film par erreur, que David Guetta prendra sa retraite, que Marc Levy se fera mordre par un castor enragé...bref, la réalité, c'est que la vie est une pute.
Nous sommes bien des années plus tard après le premier film. La Terre, grâce à l'invasion extra-terrestre déjouée par Will Smith et Jeff Goldblum - ainsi qu'un virus informatique révélant que les E.T tournaient sous Windows (c'est quand même con un alien) - a tiré les leçons de ses échecs. Unit dans un même objectif, et grâce aux épaves récupérées, la technologie humaine a fait un bon sidérant. Sauf que, manque de bol (et aussi parce qu'il fallait une raison à cette suite autre que "je dois me payer un nouveau jacuzzi"), les bestioles de l'espace reviennent. Avec un plus gros vaisseau, une plus grosse armée et une reine dirigeante mal lunée. David Levinson avertit encore une fois du danger tout comme l'ancien président devenu à moitié sénile et boiteux, Thomas Whitmore. Heureusement, des héros se lèvent à nouveau pour combattre l'ennemi en ce 4 juillet, jour emblématique (et pourri quand même) de cette uchronie.En effet, Independence Day : Resurgence est une uchronie. Le film part du postulat que les humains ont évolué bien plus rapidement que nous dans cette Terre alternative du fait de la technologie extra-terrestre laissée sur place après la grande défaite du 4 juillet. De ce fait, l'armée humaine dispose d'une base lunaire, d'un réseau de défense orbital et d'avions armés de laser qui font piou piou piou (Tu fais très bien le laser ! Merci ! Non mais vraiment je le pense). C'est certainement la seule et unique bonne idée du film. Le reste...comment décrire le reste...il faut être technique et pas vulgaire à la fois.
Certes, Independence Day premier du nom était un film bas du front, une ode à l'american way of life et à la suprématie US. C'était bourrin, très con parfois, mais c'était cool, attachant et souvent diablement épique.
Là...c'est autre chose.
Tout commence déjà avec les personnages. Concentré à 200% sur son fan service, le film offre à peu près toute la brochette des acteurs du précédent, à commencer par Jeff Goldblum et Bill Pullman. Mais pas Will Smith, qui n'était pas assez désespéré pour tenter l'aventure. Du coup, Roland Emmerich l'a remplacé par un acteur noir leader price (car il faut savoir que l'acteur noir est interchangeable) sans l'ombre du quart du centième de la classe d'un Will Smith. Ce Willus Smith va même avoir un pote avec qui il est fâché (ça met du piment à l'intrigue) en la personne de Jake Morrison interprété par Liam Hemsworth qui avait déjà joué auparavant dans Hunger Games (du lourd). Entre deux, la traditionnelle petite amie dont on ne souvient jamais du nom, un deuxième noir plus gros avec des machettes, parce que le quota de noirs dans les films Hollywoodien a augmenté depuis 1996, et Charlotte Gainsbourg. On ne sait pas ce qu'elle est venue faire là, elle non plus à priori vu son jeu d'actrice au cours de l'aventure, mais quelque chose nous dit qu'elle va vite regretter Lars.
Passé le casting aussi excitant que l'on avait pas osé l'imaginer, il y a une histoire. Enfin, une histoire... Un timbre poste. Les aliens reviennent pour détruire la Terre, ils sont encore plus méchants, ils font les mêmes choses ou presque que dans le précédent film, et voila. Bon. Sauf que le côté découverte du premier n'est forcément plus présent, on sait exactement de quoi il retourne. Roland Emmerich va aussi à cent à l'heure, ne laissant plus du tout son aventure se poser pour créer un suspense digne de ce nom. Et puis l'évolution technologique annihile le côté guerrier épique du premier (on se souvient tous des "Eagle Un, Fox deux" quand les avions tiraient des missiles) remplaçant tout ça par une bouillie de pixels avec lasers intégrés. Independence Day : Resurgence n'a plus aucun moment palpitant à offrir, ni même héroïque à l'américaine comme dans son prédécesseur. Tout s’enchaîne si vite avec si peu de conviction que rien ne prend, même pas la première offensive aérienne ou le final pourtant pensé pour être une apothéose. Dans tout cela, le pire reste que le film tente constamment de renouer avec les éléments qui avaient fait le succès du film de 1996...en utilisant des clichés aussi énormes qu'un François Hollande pré-électoral.
On pourrait pleurer devant un tel spectacle, ou rire de bien des scènes contenues dans le métrage, mais on est juste fasciné par autant de bêtises. Pour illustrer plus clairement l'échec total du film, prenons une scène symptomatique de ce ratage. Le scientifique de la zone 51 du premier film et son comparse scientifique vont se réfugier dans la salle d'isolation pendant que des aliens les attaquent. L'un des deux meurent et l'on assiste alors à la traditionnelle scène "Je prends l'agonisant dans mes bras pour échanger quelques belles paroles." Sauf que là, cela concerne un personnage que l'on a vu que 35 secondes à l'écran auparavant, dont on a clairement rien à foutre, qui est ridicule de surcroît et qui se révèle être gay. Surprise. Alors on sent qu'il y a forcément du second degré la-dedans (on l'espère en fait, sinon c'est un vrai chef d'oeuvre de nanardise) mais cela illustre toute la médiocrité du film. Un enchaînement d'événements trop rapides pour qu'on les assimile sur des personnages clichés et inconsistants, pour des enjeux vus et revus, et surtout...on ne sait absolument pas si c'est de l'humour intentionnel ou non. Un drame.
On ne parlera volontairement pas de la sphère blanche Apple qui se révèle un allié dans la lutte que livrent les humains (une des nombreuses idées WTF du film) ni de la cruauté de voir un Willus Smith sans copine pour le retrouver à la fin (mais c'est pas Will Smith, donc la nana forcément, il peut rêver !) ou encore du périple des enfants et du père de David (qui ne sert à rien, ne fait pas rire...on ne sait même pas ce qu'il fait encore là en fait !).
Pour conclure au sujet d'Independence Day : Resurgence... la vie est une pute mais qui a le sens de l'humour.Note : 0.5/10
Meilleure scène : Le scientifique qui meurt dans les bras de son pote et à qui il n'a pas tricoté le pull qu'il voulait, juste une écharpe. (Non mais, c'est vrai en plus!)
Meilleure réplique : "Il n'y aura plus jamais de paix possible" (prononcé par la présidente avant de mourir des mains des aliens, alors que ceux-ci viennent de détruire la planète pour la deuxième fois. On s'attendait clairement à un pique-nique après ça, c'est certain.)
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Nicolas Winter le 3 Août 2016 à 00:38
Alors soyons clairs.
On bout d'impatience pour Suicide Squad depuis le premier trailer dévoilé par Warner. A l'époque, c'était lui qui avait volé la vedette à Civil War et Batman vs Superman. Devenu depuis le film de super-héros le plus attendu de l'année (notamment depuis le plan marketing autour de Leto et son interprétation du Joker), Suicide Squad était attendu au tournant.
Aux commandes, un réalisateur inégal, capable du meilleur (Fury) comme du pire (Sabotage) mais avant tout un réalisateur abonné aux films d'actions qui correspondait donc plutôt bien au ton général du métrage.
En n'oubliant pas que derrière, le projet est chapeauté par Zack Snyder himself et que la fameuse Task Force X doit permettre l'envolée du DC Universe dont elle cumule un bon nombre de super-vilains.
L'idée géniale : faire des méchants les héros du films. Le plus gros danger : une overdose de personnages et un scénario trop simpliste.
Résultat ?
Une sacrée claque super-héroïque....mais pas forcément cinématographique.
Explications.
Suicide Squad, si vous viviez dans une grotte ces six derniers mois, c'est l'histoire d'une équipe de super-vilains sensément sacrifiable devant une menace méta-humaine. Dedans, la crème des méchants DC avec Deadshot, Killer Croc, Harley Quinn, Captain Boomerang ou encore Enchantress. Il parait même que le Joker passerait par là. Après le recrutement de la team, une menace s'abat sur Midway City et par un artifice vieux comme New-York 1997, les super-vilains sont contraint de se battre contre ce qui ravage la ville sous les ordres du Navy Seal Rick Flag et de l'impitoyable Amanda Waller.
De ce pitch prometteur, Ayer tire un film électrique de deux heures qui permet une chose jusqu'ici totalement inédite : faire une vraie adaptation de comic book sur grand écran.
Ce qui manquait à tous les précédents films de super-héros, c'était cet aspect joyeux et décomplexé émanant du comic mainstream et qui signait pour nombre de ses lecteurs la personnalité du média lui-même. Avec Suicide Squad, Ayer trouve exactement ce ton et offre le juste milieu entre la noirceur et le réalisme d'un Batman vs Superman ,et le fun d'un Gardiens de la Galaxie. Mieux encore, Suicide Squad s'affirme d'emblée comme le prolongement direct de Batman vs Superman, de façon bien plus évidente et intelligente que tous les Marvels l'ont fait auparavant. Ce sont les conséquences de la mort de Superman ainsi que de la polémique qui l'entoure qui fait naître l'équipe de Waller. Et tout comme son prédécesseur, le film d'Ayer aime lancer des clin d’œils complice au spectateur sur le parallèle avec le réel (Guantanamo/Les marais de Louisiane, le terrorisme, la délimitation bien/mal par le gouvernement...) tout en restant assez jouissif et fun pour ne jamais lasser le spectateur. C'est là le point le plus notable de Suicide Squad qui le différencie grandement du film de Snyder : il est ludique et amusant...dans son style.
Ce qui rapproche par contre Suicide Squad de Batman vs Superman, c'est sa mise en scène. On sent qu'il y a un véritable réalisateur avec du caractère derrière. Les scènes d'actions sont toujours iconiques et jouissives au possible, l'univers a de la gueule, les personnages un cachet et un charme beaucoup plus "adulte" que les productions Marvel tout en trouvant leur propre ton décalé par moment. De ce côté, on pourrait presque croire que Suicide Squad est le Gardiens de la galaxie de DC Comics. Sauf que la noirceur de ce qui se passe derrière différencie carrément les deux, on retrouve la touche réaliste et le côté sombre inhérents aux oeuvres DC, sans la chape de plomb narrative dont souffrait Batman vs Superman. Ayer gère sa présentation de personnages comme un chef, la chose s’avérant aussi ludique que stylée...faisant totalement oublier le didactisme obligé qui se cache derrière. Parmi les membres de l'équipe, ce seront évidemment Harley Quinn et Deadshot qui seront les plus mis en avant. Margot Robbie et Wil Smith imposant avec une facilité étonnante leur visage sur ces deux figures pourtant bien connus. Pour être plus précis, ils sont parfaits de bout en bout, touchant même à un côté émotionnel relativement inattendu.
Il reste évidemment des défauts à Suicide Squad. A savoir une dernière partie franchement prévisible à deux/trois détails près, et (forcément) des super-vilains sous-exploités, une chose qui semble logique du fait de la durée du film et de la volonté manifeste d'introduire le Joker en parallèle. Ce dernier avait beaucoup fait parler de lui ces dernier temps d'ailleurs. Même s'il est finalement assez peu présent, son inclusion dans Suicide Squad n'a rien à voir avec Wonder Woman dans Batman vs Superman : ici tout fonctionne sacrément bien. Ayer et Snyder se débrouillent pour nous dresser le portrait d'un joker radicalement différent de celui incarné par Ledger. On pense tout du long à celui de Brian Azzarello dans le comics Joker, et l'on est surtout impatient de voir Jared Leto revenir à ce personnage tant sa prestation est un sans-faute total. Le Joker version Ayer est un Joker gangsta/roi du crime, à la fois inquiétant et imposant mais sans le caractère psychopathe jusqu'au boutiste de Nolan. Cette vision préliminaire (au prochain Batman ?) promet énormément. Sa relation avec Harley Quinn ne dépareille pas. Elle est troublante, touchante et recèle même lors d'une certaine séquence une poésie creepy du plus bel effet (Killing Joke inside).
Si le grand méchant de cet épisode surprend sans pour autant convaincre totalement, c'est finalement le remarquable sens du rythme du long-métrage et sa volonté de ne laisser aucun temps mort qui en fait une des adaptations de comics les plus réussies qui soit. Bien davantage que Batman vs Superman, Suicide Squad marque le début du DC Universe au cinéma. On sent que Snyder a des idées, qu'il dissémine ses indices au fan (la mention co-assassin de Robin dans la présentation d'Harley !) et qu'Ayer jouit totalement des possibilités offertes en terme d'action et de mise en scène. De même, la bande originale du film par Steven Price se révèle une monumentale réussite, toutes les chansons choisies ici apportent quelque chose au long-métrage, une dose de folie-pop entraînante dont on se délecte constamment. C'est là la plus grande réussite de Suicide Squad : proposer un blockbuster malin où la mise en scène et la musique épousent totalement le propos pour accoucher d'une montagne russe d'action au caractère visuel bien trempé.
David Ayer réussit à tenir toutes les promesses de ses bande-annonces. Voir davantage. On peut évidemment regretter la prévisibilité de sa dernière partie mais ce serait vraiment être aveugle en face de l'efficacité narrative globale. Casting parfait, mise en scène stylisée et rythme dantesque font de Suicide Squad un bon film de super-héros super-vilains. Tout simplement.
On est impatient de voir la suite !Note : 8.5/10
Meilleure scène : Deadshot qui arrête la vague ennemie à lui seul
Meilleure réplique : "No, too easy. Can you...live for me?"Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 2 Août 2016 à 13:00
Entre les ténors de l'animation occidentale tels que Pixar, Blue Sky et Dreamworks, un petit studio tente de se faire une place : Illumination Entertainement. Déjà à l'origine de la franchise Moi, moche et méchant et du Lorax, les créateurs des Minions nous offrent pas moins de deux nouveaux films d'animation cette année. Si Tous en scène ne sortira que bien plus tard, c'est déjà l'heure pour The Secret Life of Pets (renommé Comme des bêtes pour le territoire français, car le français moyen aime les titres débiles semble-t-il...) de jouer dans la cour des grands. Entre L'Âge de glace 5, Le Monde de Dory et La Tortue Rouge, on peut dire que la concurrence sera rude. Heureusement, Comme des bêtes a quelques atouts dans sa manche, à commencer par un character design attachant et une thématique qui laisse entrevoir de grandes possibilités. Un pari réussi ?
En réalité...pas vraiment.
Comme des bêtes entraîne le spectateur dans la vie des chiens, chats, oiseaux et autres rongeurs qui nous servent d'animaux de compagnie...une fois que nous les laissons seuls. Première mauvaise surprise, la bande-annonce initiale a tout montré des cinq premières minutes du film. Du coup, aucun éclat de rire ou sourire. Deuxième mauvaise surprise, et malgré ce que semblait affirmer la campagne marketing autour du film, Comme des bêtes reste un film à l'ancienne. Une fois la porte refermée, Chris Renaud et Yarrow Cheney nous entraînent dans l'histoire de Max et Duke, deux chiens qui vont devoir cohabiter ensemble et qui, forcément, n'en ont aucune envie. Autour d'eux gravitent un tas de second rôle, de Chloé à Pops en passant par Gidget. Jusque là, rien de mauvais, beaucoup de divertissement et une aventure joyeuse et relativement rythmée.
Sauf que les choses n'iront jamais plus loin.
Il faut bien comprendre que Comme des Bêtes n'est pas un mauvais film d'animation. Aucun aspect du long-métrage n'est mauvais en soi, on peut même dire que l'animation en elle-même est une pure réussite. C'est juste qu'il semble relever d'une autre époque. Au-delà de son aventure principale et de quelques fils secondaires (notamment la quête de Gidget et des autres), il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune émotion profonde dans Comme des Bêtes. On se retrouve devant un film d'animation agréable mais dénué de tout fond. Ou tout du moins, qui ne fait qu'effleurer très rapidement ce qui aurait pu constituer des thématiques fortes tels que l'abandon, le temps qui passe, le lien maître-animaux...Tout est survolé, jamais exploité. On éclate parfois de rire devant les répliques de Kevin, le lapin déglingué vivant dans les égouts avec sa bande, mais on ne retrouve jamais le dimension supplémentaire apportée par les films Pixar ou l'immense intelligence d'une Tortue Rouge.
A côté de ça, les réalisateurs nous offrent tout de même un agréable moment de détente avec quelques trouvailles vraiment amusantes, du lapin dont on parlait plus haut au running-gag du hamster. Les personnages sont attachants, l'histoire ne laisse pas beaucoup de temps morts. Bref, Comme des bêtes peut s'apprécier comme un dessin-animé occidental à l'ancienne, sans sous-texte, sans double lecture. Au vu des possibilités qu'il renferme, le film ne peut pourtant que décevoir tant ses créateurs peinent à faire jaillir la moindre émotion. Ils n'arrivent jamais à atteindre la tendresse qui se tissait entre Gru et les enfants dans le premier Moi, moche et méchant, restant constamment un large cran en-dessous de ce dernier. Le résultat s'avère frustrant.
Loin de la poésie de La Tortue Rouge ou de l'émotion latente du Monde de Dory, Comme des bêtes assure le minimum et se repose sur une formule un tantinet dépassée. On espère que Tous en scène parviendra à rectifier le tir.
Amusant mais rapidement oublié.Note : 7/10
Meilleure scène : L'arrivée du lapin et de son gang
Meilleure réplique : Ricky, on pense à toi !Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 26 Juillet 2016 à 19:21
Immense succès lors de sa sortie en 2003, Le Monde de Némo était l'oeuvre de deux hommes : Lee Unkrich et Andrew Stanton. Ce dernier revient, seul, aux commandes du Monde de Dory, suite située un an après les événements du premier volet. Malheureux depuis le cuisant échec de son John Carter, Andrew Stanton retrouve un univers qui lui est familier et centre cette fois-ci l'aventure sur le personnage secondaire le plus truculent du Monde de Némo : Dory. Victime de Troubles de la Mémoire Immédiate, elle apportait une fraîcheur et un zeste de folie à la quête de Marin. Cependant, comme on l'on a pu s'en rendre compte avec le désastreux Monstres Academy, Pixar n'est jamais aussi bon que lorsqu'il génère de nouvelles idées (Vice-Versa en fut la démonstration éclatante l'année passée). De ce fait, voir débarquer une nouvelle suite dans la filmographie du studio a de quoi laisser le spectateur dubitatif. D'autant plus que l'aventure semble se calquer sur une redite du Monde de Némo... Dory peut-elle être à la hauteur ?
Le plus gros défaut de ce Monde de Dory, c'est évidemment son postulat : Dory se lance dans une folle aventure pour retrouver ses parents. Un petit air de déjà-vu puisque l'on remplace un disparu par un autre. On sait donc d'emblée que le film ne sera certainement pas à la hauteur de son prédécesseur puisqu'il perd forcément en fraîcheur et en originalité. Cependant, Stanton ne fait pas les deux erreurs capitales qu'avait commis Monstres Academy. Tout d'abord, Le Monde de Dory capitalise sur ce qui était peut-être le meilleur personnage du précédent opus. Dory reste toujours ce feu-follet au cœur tendre que l'on a connu par le passé ,et Stanton lui ajoute une profondeur bienvenue, même si un peu simpliste. Ensuite, Le Monde de Dory est une suite, non une préquelle, les choses ne sont pas figées dans le temps, évitant ainsi de révéler à l'avance la fin de son intrigue (cela même si celle-ci n'a rien de bien originale dans son dénouement).
Dory s'impose naturellement comme une héroïne ultra-attachante pour le spectateur. En explorant son Trouble de la Mémoire Immédiate, Stanton tient évidemment quelque chose de très fort, transposant ici un thème qu'on aurait plutôt l'habitude de voir dans une autre tranche d'âge (Alzheimer) pour lui donner une dimension plus cruelle encore. Si l'on peut reprocher au réalisateur de n'utiliser que de façon très opportune cette problématique (Dory a tendance a oublier les choses quand cela apporte quelque chose au scénario ou pour un effet comique), elle mène tout de même à une authentique touche émotionnelle lorsque le handicap dresse une barrière entre Dory et le monde qui l'entoure. Le film est d'ailleurs d'autant plus efficace et poignant quand il met en scène Dory bébé avec ses parents. Son apprentissage et son désespoir quand elle se perd auraient pu constituer une histoire superbe à bien des égards. Ce n'est malheureusement que partiellement exploité. Qu'à cela ne tienne, Stanton tente de combler ce manque de profondeur émotionnelle en ajoutant un excellent personnage secondaire en la personne de Hank, une pieuvre un tantinet asociale et dont la relation avec Dory finira par émouvoir (Cf la séquence où Hank relâche Dory en lui disant qu'il ne l'oubliera pas).
En fait, c'est d'ailleurs dans sa galerie de personnages secondaires farfelus que Le monde de Dory trouve un second souffle. Outre Hank, on citera Becky, Destinée, Bailey...ou l'impayable Gérard, qui concourent tous à la dimension comique, et parfois absurde, de l'histoire. On ne peut pas forcément en dire autant de Némo et Marin qui font vraiment rajouts à cette histoire concernant avant toute chose Dory. C'est un peu le même défaut qui gangrène les suites Pixar, le fait que la firme à la lampe n'est jamais aussi éblouissante que quand elle introduit de nouveaux personnages ou quand elle donne une véritable raison d'être à la présence d'anciens héros (comme pour les Toy Story). Ici, tout se passe comme si Némo et Marin se devaient d'être là. Une sorte de fan-service un peu opportuniste en somme. Car dès que l'on reste sur Dory, les choses se passent beaucoup mieux. Sans jamais arriver à la cheville émotionnelle d'un Vice-Versa, Le Monde de Dory donne encore quelques beaux moments (les retrouvailles et la plupart des flash-backs). Reste alors un aspect technique forcément éblouissant qui, lui, mettra tout le monde d'accord : visuellement parlant, le film est une pure réussite.
Tout comme le court-métrage qui le précède d'ailleurs, Piper, un petit bijou technique doublé d'une très jolie histoire muette.
Si Le Monde de Dory fait bien mieux que Monstres Academy, il ne constitue pas non plus un Pixar majeur. Il s'agit juste en l'état d'un film d'animation visuellement magnifique avec des personnages attachants et une thématique relativement originale...mais qui aurait mérité des choix plus audacieux sur le plan scénaristique. Dommage que Pixar semble s'entêter à reprendre ses franchises-phares plutôt que d'investir dans des histoires originales.Note : 7.5/10
Meilleure scène : Les lions de mer et Gérard
Meilleure réplique : Tu prends la confiance Gérard ! - Nage droit d'vant toi !Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 23 Juillet 2016 à 18:33
![[Critique] La Tortue rouge](http://ekladata.com/usbE30EqwJhOpUuTj0LoG8mtwP8@555x745.jpg)
Prix Spécial du jury Un Certain Regard, Cannes 2016Entre Le monde de Dory, Comme des Bêtes et L’âge de glace 5, un curieux (et discret) long-métrage d’animation s’est glissé.
Tout en 2D pour le coup, La Tortue rouge est la rencontre de deux mondes : celui des japonais du studios Ghibli (le film est produit par le célèbre studio et notamment par un certain Isao Takahata) et celui du néerlandais Michaël Dudok De Wit.
Si ce nom ne vous dit rien, c’est assez normal puisqu’il s’agit de son premier long-métrage. Pourtant, le monsieur a déjà remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation avec Père et Fille en 2000 ainsi que le grand Prix du festival d’Annecy…rien que ça. En 1994 d’ailleurs, son court Le Moine et le Poisson lui avait déjà valu un César.
Il était donc plus que temps pour lui de porter son talent sur grand écran.La Tortue rouge n’est pas seulement la révélation de Michaël Dudok De Wit à un plus large public, c’est aussi une œuvre audacieuse, poétique de la première à la dernière seconde et simplement magistrale.
Dans une 2D magnifique, La Tortue rouge raconte le naufrage d’un homme, dont le nom restera un mystère tout du long, sur une petite île déserte au milieu de l’océan. Cette histoire minimaliste à souhait réserve un nombre de surprises assez hallucinantes et, avant toute autre chose, une prise de risques certaine. Alors qu’à l’heure actuelle les productions cinématographiques, et à plus forte raison les œuvres pour enfants, ont une peur évidente du silence, ne pouvant s’empêcher de remplir l’histoire par toutes sortes de dialogues parfois ineptes, La Tortue rouge opte pour un silence quasi-complet.
A peine percé par quelques cris ou rires, le film de De Wit s’avère une œuvre intégralement muette.
Ce pari d’une extrême audace paye pourtant rapidement car le néerlandais fait passer toute l’émotion et la poésie de ce qu’il raconte par le visuel et la musique. Cette dernière, composée par Laurent Perez Del Mar, est un ravissement de tous les instants et convoque les meilleures partitions des films des studios Ghibli. C’est à ce moment qu’il faut préciser que l’influence de l’œuvre de Miyazaki et Takahata est omniprésente dans La Tortue rouge. Non content de raconter une histoire humaine forte et universelle, celle de la solitude, le film peut s’appréhender comme une ode à l’écologie, un plaidoyer vibrant pour un retour à la nature. Avec ses tempêtes destructrices et ses injustices mais aussi avec sa beauté d’une simplicité désarmante qui ramène aux fondamentaux de l’existence.
A cette dimension, il faut ajouter l’indubitable aspect émotionnelle que façonne le réalisateur néerlandais à travers des séquences simples mais maîtrisées à la perfection. Sans aucune parole (et c’est vraiment bluffant), il nous fait ressentir la tristesse, la culpabilité, la joie, l’émerveillement et la mélancolie. Il prend le pari fou de décrire le cycle de la vie sur une île déserte avec trois personnages et des crabes. L’amour, la mort, l’émancipation, l’enfantement, l’apprentissage, tout cela n’aura jamais été aussi bien filmé dans une œuvre animée. Dudok De Wit s’avère un magicien à bien des niveaux mais il excelle dès lors qu’il s’agit de distiller des existentielles tout en ne reniant jamais la dimension humaine, et donc cruelle, de la chose.
Car tout a une fin, même (ou surtout en fait) dans La Tortue rouge. La beauté intense qui irradie du film tend vers une mélancolie lancinante qui utilise la musique et les images pour transpercer le cœur du spectateur. Du coup, si les enfants y verront surtout l’aventure rocambolesque et semée d’embuches d’un homme perdu au milieu de nulle part trouvant l’amour de façon improbable, les adultes, eux, pourront en tirer une fabuleuse métaphore sur la vie en général et un vibrant plaidoyer écologique. Cette double lecture, marque des grands films, achève de convaincre de l’infinie talent de Michaël Dudok De Wit.
Surprise audacieuse et poétique, la Tortue Rouge s’impose comme un chef d’œuvre d’intelligence. Sa délicatesse en fait un film d’une beauté sidérante qui ne cesse de hanter le cœur de son spectateur par la suite.
Certainement l’un des plus grands dessins animés de ces dernières années !
Note : 10/10
Meilleure scène : La culpabilité du naufragé face à la TortueSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Nicolas Winter le 24 Juin 2016 à 14:33
Ceux et celles qui ont découvert le cinéaste danois Nicolas Winding Refn grâce à Drive en 2011 risquent d'être une nouvelle fois surpris. En effet, alors qu'Only God Forgives avait déjà passablement remis les pendules à l'heure en retrouvant l'expérimentation cinématographique si chère au réalisateur, The Neon Demon n'emprunte pas seulement la même voie mais va beaucoup, beaucoup plus loin. Annoncé au départ comme le film "horrifique" selon Refn, le long-métrage déroute dès les premières minutes. Après avoir clivé une partie de la critique à Cannes cette année, The Neon Demon débarque sur les écrans pour prouver une nouvelle fois à ceux qui en doutaient que Nicolas Winding Refn a encore bien des choses à dire.
Pour cela, il embauche la jeune et virginale Elle Fanning pour jouer l'ambitieuse mais niaise Jesse, fraîchement débarquée à Los Angeles pour accomplir son rêve : devenir mannequin. Elle ne s'attend certainement pas à vivre dans un motel miteux tout en s'élevant dans les strates d'un milieu très fermé où la jalousie et la compétition sont deux valeurs fondamentales. Elle découvre bien vite que personne ne lui fera de cadeau. Seule sa beauté pure et inestimable lui permet de laisser tout le monde sur le carreau. Plus dur sera la chute... Nicolas Winding Refn pose donc sa caméra dans le monde de la mode pour capturer le parcours terrifiant et hypnotisant de Jesse. Si The Neon Demon a été vendu au départ comme un film d'horreur, c'est certainement du fait du ton adopté par Refn pour filmer son histoire. Seulement voilà, difficile d'apposer une étiquette véritable sur le métrage.
Fidèle à ses habitudes, Refn ne fait pas les choses à moitié. The Neon Demon suivant Jesse dans l'univers de la mode, le film se doit d'être à l'image du dit-univers. Dès l'écran titre, le spectateur voit apparaître les initiales NWR dignes d'une pub pour un parfum. Adoptant une esthétique extrêmement travaillée, The Neon Demon transpose l'artificialité du milieu visité jusque dans sa mise en scène. Ainsi, le danois lâche la bride à son goût pour l'esthétisation parfois outrancière (souvenez-vous de Only God Forgive ou Bronson) et ouvre son long-métrage sur un très long plan fixe en travelling avant où Jesse pose couverte de sang pour un photo-shoot morbide. Accompagné de la musique géniale de Cliff Martinez (devenu une vraie marque de fabrique pour le réalisateur), on comprend d'emblée que The Neon Demon ne sera pas un film accessible. Pourtant, soyons clairs, aucun autre métrage dans l'année n'a fait montre d'une maîtrise formelle plus impressionnante. Jusqu'au bout des ongles, The Neon Demon consacre sa mise en scène à son sujet de fond : la beauté.
"Beauty is everything" dira Jesse à son petit-ami jetable en milieu de film. The Neon Demon prend la chose au pied de la lettre en montrant au spectateur que le message du métrage se confond totalement avec son apparence. On assiste alors à des séquences hallucinantes et hallucinées : La boîte de nuit éclairée par des flashs de lumière blanche où un corps torturé se contorsionne sur scène, une scène de défilé où Jesse tombe amoureuse de sa propre image ou encore un viol vécu par l'autre côté du mur. Tout est à tomber, la maîtrise technique de Refn est ici absolue.Cependant, The Neon Demon ne peut simplement se résumer à sa formidable mise en scène. En bon trublion, Nicoals Winding Refn dépeint l'univers de la mode avec un ton horrifique délicieux. La chair se transforme, devient une matière première, pure ou modifiée, malléable ou peinte. Dans ce monde d'artifices, la moindre petite chose devient terrifiante, le moindre défilé plonge dans une horreur sourde et malicieuse qui met mal à l'aise. Jesse, incarnation de la jeunesse naïve et prétentieuse par excellence, ne se rend pas compte qu'elle évolue au milieu d'un peuple de loups prêt à la bouffer au moindre faux-pas. En mélangeant sexe (lesbien ou pas), en pervertissant les codes du conte traditionnel (le petit-ami qui a tout d'un prince charmant se fait éconduire par sa belle qui ne voit que la beauté et rien d'autre) ou le château abandonné où règne une méchante sorcière travestie en marraine attentionnée et avide de sexe.
Rapidement, The Neon Demon donne des sueurs froides. Les remarques des compétitrices se font de plus en plus voraces, les personnages qui gravitent autour de Jesse de plus en plus inquiétant. Filmant la mode en mélangeant sensualité, sexe, attirance morbide voir nécrophile et cannibalisme, Nicolas Winding Refn redéfinit un univers clinquant pour en faire un lieu de débauche malsain où l'arrivée du fantastique n'a en fait plus rien de surprenant. Transformant son récit en histoire quasiment mystique, Nicolas Winding Refn ne recule devant rien, immisçant de plus en plus franchement l'horreur et le sang dans l'histoire de Jesse. Pour autant, il ne cède jamais aux facilités actuelles du genre, préférant adopter un point de vue à mi-chemin entre la fascination et la répulsion pour mieux perdre le spectateur. La vorace Jena Malone incarnant à merveille cette dualité. Si l'on a beaucoup parlé de belle coquille vide pour décrire The Neon Demon à Cannes, inutile de dire qu'une nouvelle fois une bonne partie de la critique est passée à côté du génie de Refn. Après tout, Mad Max : Fury Road avait de toute façon reçu le même genre de critiques l'année dernière. En l'état, The Neon Démon se clôt comme il s’est ouvert, avec un aspect de clip pour parfum ironique où semble retentir le rire carnassier du danois.
Certainement son oeuvre la plus expérimentale à ce jour, The Neon Demon n'est pas un film grand public. Épousant son sujet jusque dans les moindres détails de sa mise en scène, le métrage de Nicolas Winding Refn hypnotise par sa mise en scène incroyable tout en immisçant l'horreur et le fantastique dans un univers de la mode froid et morbide.
En définitive, un très grand film !
Note : 9.5/10
Meilleure scène : Le défiléSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 14 Juin 2016 à 15:46
Alors qu'elle rentre de son travail, la créatrice-star Tsukiko Sagi est attaquée par un mystérieux enfant portant des rollers dorés, une casquette et une batte de base-ball. Forcément très exposée dans les médias depuis que sa peluche kawaii, Maromi, est devenue un phénomène de société, Tsukiko cache pourtant quelques secrets. Dont le fait qu'elle se sent piégée par le succès remporté par sa dernière création et que, depuis, l'inspiration lui fait défaut. Ce triste événement va pourtant vite prendre une toute autre dimension. Bientôt, celui que l'on surnomme Le Gamin à la batte (shônen bat en VO) s'en prend à d'autres personnes : deux écoliers que tout oppose, une jeune femme aux activités nocturnes peu recommandables, un journaliste et même un policier. L'affaire enfle rapidement pour prendre des proportions nationales et la paranoïa se répand plus vite qu'un feu de forêt. L'enquête de l'inspecteur Ikari et de son jeune collègue Maniwa va pourtant connaître des obstacles inattendus. A commencer par l'amnésie des victimes et leur fragilité psychologique... Qui donc est ce Gamin à la batte et que veut-il réellement ?
Aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands génies de l'animation japonaise, Satoshi Kon n'a livré qu'une unique série anime au cours de sa (trop) courte carrière. Après son Tokyo Godfathers, le réalisateur se tourne vers un nouvel univers qui, finalement, porte en lui tous les germes de son futur chef d'oeuvre et film-testament, le fameux Paprika. Épaulé par Seishi Minakami, il conçoit une série de treize épisodes de 24 minutes chacun en partant d'un postulat minimaliste et, apparemment, banal. Seulement voilà, et ceux qui connaissent Satoshi Kon s'en doutent bien, Paranoia Agent va beaucoup plus loin qu'une simple enquête policière. En voulant ausculter la société japonaise moderne et ce qui représente peut-être son mal le plus caractéristique, à savoir le mal-être psychologique qui la gangrène, le cinéaste nous plonge dans un récit aux multiples facettes recelant autant de mystères que de pistes de réflexion. Dans Paranoia Agent, tout est pensé et repensé minutieusement retrouvant ainsi la profondeur sociétale et psychologique de l'oeuvre de Satoshi Kon au cinéma.
On peut, de façon tout à fait artificielle, scinder Paranoia Agent en trois parties. La première, entre les épisodes 1 à 7, suit l'enquête d'Ikari et Maniwa en introduisant graduellement de nouveaux personnages, étoffant ainsi l'intrigue et dévoilant au spectateur l'identité des différents individus qui défilent dans le générique d'ouverture. La seconde marque une pause dans la série en relayant Le Gamin à la batte au second plan pour livrer trois épisodes qui pourraient se concevoir comme des loners : Planning Familial (Episode 8), ETC (épisode 9) et Mellow Maromi (épisode 10). Enfin, la dernière partie boucle les différents fils narratifs et permet à Satoshi Kon de s'amuser avec le spectateur sur les différents niveaux de réalité comme il le fera si bien dans Paprika deux ans plus tard. Après un pilote qui pose les bases et introduit les personnages les plus importants, à savoir Tsukiko, Ikari et Maniwa ainsi que le duo Maromi/Gamin à la Batte, Satoshi introduit à peu près un nouveau personnage par épisode pour étoffer son intrigue, l'élargir et tisser un suspense qui frôle parfois l'incompréhension. Flirtant toujours avec l'hermétisme, le japonais arrive toutefois toujours à maintenir le spectateur la tête hors de l'eau et ébauche une histoire passionnante et aux multiples facettes.
Partant d'une enquête policière tout ce qu'il y a de plus banale, Satoshi Kon va s'amuser à plonger dans le mal-être sociétal qui ronge la société japonaise et cela par plusieurs abords. Le premier par les répercussions de l'attaque de Tsukiko sur deux collégiens, Yuichi et Ushiyama, mettant en évidence de façon malicieuse la pression qui repose sur les épaules des jeunes japonais, les effets pervers de leur compétition et de leur soif d'excellence ainsi que le phénomène d'harcèlement à l'école. On comprend alors très rapidement que Satoshi tente de croquer les différents malaises qui rongent ses concitoyens à chaque personnage qu'il introduit : Chouno Harumi représente la dichotomie sexualité/pudeur chez les japonais, véritable schizophrénie sociétale, Masami Hirukawa oppose la justice et la corruption, Makoto Kozuka permet de parler de la fascination des japonais pour les mondes imaginaires et l'échappée de la vie quotidienne qu'ils permettent...Même Maniwa, plus tard, opposera traditionalisme et modernité au sein du Japon actuel. Cette dualité se retrouve de toute façon dans tous les aspects de Paranoia Agent. Elle permet, de manière insidieuse mais diablement bien pensée, d'en venir vers un thème dont raffole Satoshi Kon, le rapport de l'homme vis-à-vis du réel...mais nous y reviendrons.
En l'état, le cinéaste ausculte une société malade (qui pourrait d'ailleurs aussi bien être notre société occidentale à quelques détails près) en se servant de façon simplement brillante de tous les personnages qu'il introduit. Tout est mûrement pensé dans cette pléiade parfois improbable pour contribuer à épaissir, et l'intrigue elle-même, et la réflexion de fond. Du coup, Paranoia Agent montre bien vite une profondeur inattendue de prime abord. Surtout qu'en plus de ce qui a déjà été énoncé plus haut, la série se penche sur la paranoïa sociale (justifiant ainsi son nom). Le Gamin à la batte, avant d'être une métaphore sur la culpabilité et sur un échappatoire au réel, est également la personnification d'une menace, qu'elle quelle soit. Satoshi Kon montre comment d'une simple série d'agressions née toute une légende, voir une véritable mythologie, autour du Gamin à la batte. Ainsi, il passe du jeune garçon à roller au monstre de plusieurs mètres à peine humain. Cette évolution ne sert pas juste un but esthétique ou psychologique mais montre bien comment la rumeur se propage et comment la société s'enkyste dans une paranoïa qui la fait tombé toujours plus bas. On comprend d'autant mieux la chose avec l'excellent épisode 9 "ETC" qui met en scène des commères déformant et inventant à n'en plus finir sur les méfaits du mystérieux agresseur aux rollers dorés. Avec beaucoup d'humour et d'ironie, Satoshi Kon explique ni plus ni moins la naissance des légendes urbaines.
A côté de ça, Satoshi Kon se penche sur une autre thématique qu'il affectionne : la réalité. Tous les personnages présentés dans Paranoia Agent partage cette volonté d'échapper au réel, trop épuisant, trop stressant. Le Gamin à la batte, les agressions et, d'une autre manière, Maromi, représente autant de pistes pour fuir le réel. La série raconte avec beaucoup de justesse le besoin d'un autre univers qui pourrait violemment changer la donne (un bon coup de batte) ou plus doucereusement (Maromi ou l'univers fantasy de Kozuka). Cette aspiration culmine dans le meilleur épisode de la série, Planning Familial, où Satoshi Kon aborde le suicide, préoccupation majeure au Japon, d'un point de vue tout à fait fascinant, enlevant tout le dramatisme de la chose pour mieux frapper les esprits. Il s'agit certainement d'une des toutes meilleurs histoires autour de ce fléau qu'on ait jamais vu sur le petit écran. Le dernier des trois loners regroupe un peu tous les thèmes précédents mais en nous emmenant dans l'univers de la création d'un anime, sorte de sous-texte méta malicieux et très intéressant dans le fond.
Enfin, outre la multitude sidérante d'interrogations proposée par la série, il s'agit bel et bien d'une magnifique histoire sur le regret et la culpabilité traitée à la Satoshi Kon. C'est à dire avec folie et en mélangeant les univers (graphiquement ou scénaristiquement parlant) et en explosant les barrières du réel. Si l'on se perd parfois, c'est toujours avec délice, en sachant qu'il faut savoir se laisser porter, que d'une façon ou d'une autre le cinéaste retombe toujours sur ses pattes. Les derniers épisodes de la série resserrent son intrigue ainsi que sa galerie de personnages, prenant un ton plus intimiste et permettant de comprendre encore mieux le miroir que représente les deux (excellents) génériques. Alors bien sûr, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'en a l'air avec Satoshi Kon et l'ouverture finale rappelle que peut-être que toute cette histoire n'était qu'un écran de fumée et que certaines réponses ne viendront jamais. C'est aussi cela qui fait de Paranoia Agent une grande série, c'est qu'elle laisse la place à l'imagination.
Certainement déroutante au premier abord, Paranoia Agent contient tout le génie, le talent et l'intelligence de son auteur, Satoshi Kon. Exploration aux multiples facettes d'une société japonaise moderne malade, la série n'a pas peur d'abattre les murs du réel pour entraîner le spectateur toujours plus loin.
Bref...Note : 9/10
Meilleur épisode : Planning Familial
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 10 Juin 2016 à 17:13
Franchise vidéo-ludique culte s'il en est, Warcraft allait forcément un jour ou l'autre passer par la case grand écran, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il représente une manne financière non-négligeable du fait de la popularité de sa dernière itération, le MMORPG World of Warcraft (et cela malgré l'érosion notable du nombre de joueurs ces dernières années), ensuite parce que l'univers se prête particulièrement bien à une adaptation cinématographique (ou du moins le troisième volet de la saga, mais nous en reparlerons) et enfin, parce que depuis la trilogie du Seigneur des Anneaux - du Hobbit également dans une moindre mesure - il existe un place à prendre sur la scène fantasy épique. Après une difficile gestation, le projet a atterri entre les mains d'un jeune cinéaste, Duncan Jones, déjà connu pour ses deux excellents long-métrages : Moon et Source Code (que l'on vous recommande chaudement au passage). Le film sort enfin sur les écrans après de multiples reports et tergiversations, chapeauté de loin par le studio légendaire qui l'a engendré, Blizzard Entertainement.
Pour mieux se rendre compte des enjeux derrière cette adaptation, il est nécessaire de replacer Warcraft : Le Commencement dans son contexte. Né en 1994 avec Warcraft : Orcs and Humans, la saga a connu son envol avec le second volet intitulé Tides of Darkness l'année suivante. Ces deux opus avaient une histoire relativement simple se déroulant sur le monde d'Azeroth (il s'agit d'ailleurs également du nom d'un des trois continents de la planète) où le royaume humain de Lordaeron fait face à l'invasion de créatures belliqueuses : les Orcs. Venus d'une autre planète appelée Draenor, les Orcs sont dirigés (et opprimés) par le terrible Gul'dan lui-même émissaire du pouvoir démoniaque ainsi que par Main-Noire le Destructeur, chef de guerre Orc. C'est donc un affrontement assez classique que mettent en scène les deux premiers volets de la saga, agrémenté de quelques morts tragiques. Il faut attendre le troisième volet, le cultissime Warcraft III : Reign of Chaos, et son extension The Frozen Throne, pour que Blizzard exploite à sa juste mesure le potentiel de l'univers grâce à des personnages comme Arthas, Thrall ou Illidan. Sauf que pour son adaptation grand écran, le dévolu de Duncan Jones et Universal Pictures s'est porté sur...une préquelle au premier volet.
En quoi cela pose-t-il problème ? Tout simplement parce que non seulement Warcraft I et II présentent trop peu de matériel narratif digne de ce nom pour construire une storyline efficace au cinéma mais aussi, et surtout, parce qu'en regard du potentiel épique de Warcraft III, la démarche parait totalement inerte. Pire encore, Duncan Jones livre une préquelle à une histoire déjà mince et qui amènera forcément une répétitivité pour la suite - si suite il y a, bien évidemment. Du coup, le film part sur de mauvaises bases et accuse rapidement le coup puisque le récit met un temps fou à décoller. En fait, elle ne semble même prendre son envol que dans les vingt dernières minutes avec l'inévitable bataille finale, cliché éculé du genre fantasy au cinéma. Entre temps, on s'appesantit longuement sur le fade camp humain et de (prévisibles) imbroglios politiques. Ce n'est cependant que le premier des (gros) défauts du film. Outre son problème de rythme dû à un très mauvais choix de départ, Warcraft souffre également d'un problème de casting flagrant et de caractérisation défaillant.
Dans le métrage, tout se passe à l'image d'un jeu vidéo. On retombe sur l'un des plus gros points noirs de toutes les adaptations vidéo-ludiques, la volonté de fan-service et de vouloir montrer à l'écran un décalque de ce qui se fait dans le jeu. Sauf qu'une nouvelle fois, cela ne fonctionne pas. La plupart des personnages sont définis par leur fonction. Ainsi on retrouve le guerrier, le roi, le mage, l'apprenti-mage, le fils et la guerrière rebelle. Cette simplicité dans la caractérisation donne donc un sentiment de vide au camp humain. Pire encore, le casting de ces derniers s'avère un retentissant échec. Warcraft regorge de miscasts ! Seul Travis Fimmel en Anduin Lothar ajoute un petit quelque chose dans ce bouillon infâme de jeu d'acteurs médiocres...et encore. Non seulement les acteurs jouent mal mais ils n'ont tout simplement pas la "gueule" de l'emploi. La chose est évidente avec Ben Foster, très peu crédible en vénérable gardien, mais devient vite pathétique avec Khadgar interprété par le ridicule Ben Schnetzer, à la fois à côté de la plaque dans son jeu mais aussi complètement dénué de charisme. Ne parlons même pas de Dominic Cooper et de son rôle aussi inconsistant que cliché... Là où Le Seigneur des Anneaux faisait un remarquable sans-faute, Warcraft se vautre presque totalement.
Quid des Orcs alors ? Difficile ici de parler de miscast, puisque les acteurs ne font que prêter leurs voix aux images de synthèse qui composent ce pan de l'histoire. Globalement d'ailleurs, cet axe narratif s'en tire légèrement mieux que son pendant humain. Evidemment, et on s'y attendait, les Orcs à l'écran font un tantinet cinématique de jeux vidéos. Malgré toute la bonne volonté de l'équipe en charge des FX (et en précisant bien que le rendu n'a rien de honteux pour la Horde), les créatures ainsi que la multitude (certains diront l'overdose) de synthèse à l'écran donne un cachet fake et kitsch à Warcraft. Un écueil évité par Le Seigneur des Anneaux avec beaucoup de malice en son temps mais dans lequel tombait également Le Hobbit. Curieusement cependant, le récit des Orcs passionne davantage. Même si passionner est un grand mot. Au vu de l'ennui profond et de la mauvaise direction prise par la partie humaine de l'aventure, les péripéties de Durotan et Gul'dan apparaissent comme forcément meilleures. Pourtant, de façon objective, la trame des Orcs s'avère attendue et, comme tout le reste, atrocement manichéen avec ses traîtres et ses grand méchants. Rien que du très prévisible...si l'on omet un dernier twist de fin qui tente désespérément de venir réveiller le spectateur.
On sent une volonté de créer un monde dans Warcraft et même, en filigrane, de la passion. Sauf que cela ne suffit pas tant les tares qu'accusent la direction d'acteur, le casting, le récit et les choix artistiques étouffent le reste. Pour parachever la chose, Warcraft se retrouve le cul entre deux chaises. D'un côté, il raconte une histoire très peu palpitante pour tous les fans de la franchise qui ont encore en tête les émotions ressenties lors du retour d'Arthas ou lors de sa confrontation avec Illidan. Les aficionados n'apprennent donc rien et s'ennuient passablement devant un récit perclus de défauts. De l'autre, les novices eux ne comprendront pas complètement l'intrigue car malgré l'étirement de celle-ci, son découpage parfois aberrant ainsi que ses allusions destinées aux fans l'égareront en route. Il manquera la profondeur et la richesse visuelle d'un Seigneur des Anneaux ou l'épique de la saga de Peter Jackson justement. C'est là le dernier reproche que l'on peut faire à Warcraft : sa mise en scène. Alors que c'était certainement le dernier point où l'on pouvait espérer quelque chose, Duncan Jones est méconnaissable. Comme écrasé par le blockbuster, le cinéaste ne donne aucune véritable ampleur à ce qu'il filme, n'incarne rien et ne produit que du fonctionnel. A peine aura-t-on un plan en plongée à dos de griffon pour se consoler...
Énorme déception, Warcraft confirme une énième fois que les adaptations de jeux vidéos au cinéma ne marchent pas. Parce que les studios et les réalisateurs ne comprennent pas ce qui fait le sel d'une saga culte. Pas son visuel, pas son gameplay...mais bien son ambiance, ses personnages et son histoire. Il n'y a presque rien à sauver dans ce blockbuster sans âme qu'est Warcraft : Le Commencement. On espère juste simplement que l'univers Blizzard au cinéma sera laissé en paix à l'avenir...et que Duncan Jones retournera à un cinéma plus personnel.
Note : 2/10
Meilleure scène : Le griffon déchaîné au milieu des orcsSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 4 Juin 2016 à 14:18
Sortant dans le même laps de temps que Ma Loute, autre comédie folle et inclassable, Men & Chicken est le quatrième long-métrage d’un réalisateur danois jusqu’ici inconnu dans l’Hexagone : Anders-Thomas Jensen. Détenteur de deux oscars pour ses court-métrages, le cinéaste regroupe un casting alléchant avec Mads Mikkelsen (Hannibal, A Royal Affair…), David Denick (The Homesman, La Taupe…) ou encore Soren Malling (The Killing, Hijacking…) pour un film improbable et, pour tout dire, complètement jeté. L’humour danois mêlé au talent de mise en scène du réalisateur font pourtant de Men & Chicken une (très) bonne surprise.
Dans cette histoire difficilement racontable, Jensen nous présente deux frères, Elias et Gabriel, qui vont découvrir à la mort de leur père…qui ne l’est en fait pas. C’est un vieil homme du nom d’Evelio Thanatos (!!) vivant sur une petite île danoise loin de tout qui serait leur véritable géniteur. Arrivé là-bas, les deux compères font la rencontre plutôt brutale de leurs trois demi-frères : Josef, Gregor et Franz. Tous ont le même père mais leurs mères respectives ont disparu, supposément mortes en couche. Que se passe-t-il sur cette île inquiétante ? Voilà bien la façon la plus sérieuse de poser les choses quant à l’histoire de Men and Chicken. Parce que le film déjoue systématiquement les attentes du spectateur.
Vous pensiez voir un thriller banal ? C’est raté. Un film d’horreur ? Encore raté. Une simple comédie ? Toujours raté…
Men and Chicken c’est un peu tout cela à la fois. Anders-Thomas Jensen se focalise sur la fraternité vraiment…étrange qui unit nos cinq loustics. Pourquoi étrange ? Parce qu’ils ont tous un grain (voir deux) de folie. Elias est un masturbateur compulsif qui se balade avec un rouleau de papier toilettes dans sa poche, Josef un obèse philosophe amateur de fromage, Gregor un coureur de jupons mais qui n’en a pas vu un seul en réalité et Franz adore empailler des animaux pour frapper les autres avec. Seul Gabriel semble un peu mieux loti. Mais dans un tel milieu de doux-dingues, il est aisé de paraître plus normal. Avec cette galerie de gueules – les acteurs sont horriblement grimés pour paraître tous plus repoussants et bouseux les uns que les autres –, difficile de ne pas s’attacher devant les raisonnements débiles et les us et coutumes de ces cinq-là.
Constamment porté par un humour à mi-chemin entre les Monty Pythons et Laurel & Hardy, Men & Chicken est à mourir de rire dans ses dialogues comme dans ses (rocambolesques) situations. Le cinéaste danois arrive à trouver rapidement l’équilibre parfait entre rire et sérieux, ne réduisant pas le film à une simple comédie vite vue vite oubliée. Il développe aussi, et surtout, une vraie bonne histoire en arrière-plan, superbement filmée et interprétée. On n’aurait d’ailleurs jamais cru Mads Mikkelsen aussi désopilant. Men & Chicken se penche non seulement sur les liens familiaux, explorant avec malice l’adage « On ne choisit pas sa famille », mais également sur le besoin de racines, d’origines. C’est bien cela qui pousse Gabriel et Elias à partir sur la petite île retirée qui sert de décor au film. En parlant de décor, l’idée de filmer cette histoire loufoque dans un ancien sanatorium où les animaux vagabondent librement au milieu de la décrépitude ambiante s’avère exquise. Mariée à la mise en scène sobre et raffinée du danois, on obtient une ambiance unique entre le freaks show et le pur film d’horreur.
Mais, plus encore peut-être que tout cela, c’est un dernier choix scénaristique qui fait définitivement tomber Men & Chicken du côté du bon film que l'on attendait pas (On vous conseille d’arrêter la lecture de cette critique à ce point si vous voulez ne pas vous spoiler le récit) : la relecture intelligente d’un classique littéraire. Une île mystérieuse, des humains dégénérés, un vieil homme qui manipule les gênes, des animaux partout…oui, Men & Chicken n’est en fait rien d’autre qu’une relecture comique et contemporaine de l’île du Docteur Moreau. Avec de la zoophilie et de l’humour borderline en prime (comme la séquence épique en maison de retraite). Le réalisateur danois livre sa propre version du classique avec un luxe de détails qui permet à l’intrigue de bénéficier d’une cohérence magnifique. Si l’on devine rapidement l’origine des frères, on ne peut qu’éclater de rire devant les mélanges improbables dont ils sont issus. Enfin, et c’est peut-être la cerise sur le gâteau, Men & Chicken parle en filigrane de ces endroits oubliés qui se meurent petit à petit. L’île du film rendant un hommage drôle et tendre à la fois à ces populations s’accrochant à leurs terres d’origines envers et contre tout.
Drôle à souhait, finement mené, brillamment pensé et interprété, Men & Chicken est une petite sucrerie encore plus délicieuse qu’espérée. Anders-Thomas Jensen nous offre un moment de comédie loin d’être bête qui n’aime pas les conventions. Un délice à apprécier au plus vite.
Note : 8.5/10
Meilleure scène : La maison de retraite - Le premier repasSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 3 Juin 2016 à 19:34
Précurseur en matière d’adaptation de comics dans les années 2000, la saga X-Men au cinéma a connu diverses fortunes au cours du temps. Victime une première fois de la malédiction du troisième volet - X-Men : L’affrontement final -, elle s’est de nouveau égarée avec un spin-off douteux avec Wolverine : Origines. On pensait la franchise morte et enterrée lorsqu’en 2011 Matthew Vaughn lui donne une seconde jeunesse grâce à X-Men : First Class avant que Bryan Singer, maître d’œuvre original sur les deux premiers volets ne reviennent aux manettes par un solide Days of the Future Past. Vu la réussite critique (et publique) de cette seconde trilogie, la Fox et Bryan Singer tentent de déjouer la malédiction en proposant X-Men : Apocalypse. Reprenant le casting des deux précédents épisodes ainsi que de nouvelles têtes comme la jeune Sophie Turner de Game of Thrones ou le génial Oscar Isaac dans la peau du méchant Apocalypse, le troisième X-Men de cette seconde trilogie peut-il déjouer son funeste destin ?
Après les années 60 de First Class et les années 70 de Days of the Future Past, voici logiquement venir les années 80 pour Apocalypse. Alors que le monde semble peu à peu accepter les mutants et que la nouvelle école de Charles Xavier connaît paix et prospérité, le premier mutant de l’histoire, le terrible Apocalypse endormi depuis l’âge des pharaons, se réveille en Egypte. Enrôlant plusieurs mutants de premier plan tels que Tornade, Psylocke ou…Magnéto, Apocalypse tente de modeler le monde selon sa vision pour construire un univers où ses semblables seraient les maîtres et non les parias. L’apocalypse peut commencer. Et ceci dans tous les sens du terme. Car, non, X-Men Apocalypse n’échappe pas au piège du troisième volet malgré tous ses efforts (souvenez-vous de la saga Terminator ou des Spiderman de Sam Raimi).
Pour commencer, X-Men Apocalypse fait dans la redites. Depuis six volets, l’univers des X-Men tourne en rond sur la thématique de l’acceptation de soi et de la confrontation mutants-humains. Ce nouvel épisode ne fait pas exception à la règle. Cependant, là où les deux précédents volets pouvaient compter sur d’énormes points forts pour faire oublier définitivement cette redondance (Days of the Future past avait son intrigue temporelle, First Class la force de son origin-story), Apocalypse n’a simplement rien à proposer de neuf. Pire, sous prétexte d’un supposé hommage, le scénario est truffé de séquences déjà vues (le combat dans la cage, le retour de Stryker, un trauma pour Magnéto) … Bryan Singer arrive à bout de souffle, exactement comme l’affrontement final l'était à l’époque. Voir Apocalypse se moquer gentiment de ce dernier a de quoi laisser perplexe…
Non seulement le long-métrage empeste la redites bon marché mais il oublie la force majeure de cette nouvelle trilogie : le contexte. Si l’on n’avait pas cette courte séquence où Apocalypse se branche sur une télévision pour absorber des informations sur l’époque où il s’est éveillé, difficile de donner un quelconque ancrage politique et historique à cet opus. C’était là pourtant l’une des grandes forces des deux précédents qui rendait l’intrigue d’autant plus pertinente et puissante en incluant la fiction dans la grande Histoire. On se retrouve du coup face à un film d’action teinté très légèrement d’une ambiance eighties qui se concentre sur son scénario catastrophe faisant dans la surenchère destructrice. Sauf qu’X-Men n’avait jamais cédé à ce genre de sirènes auparavant. Le résultat est une quasi-catastrophe.
Singer ne capitalise plus sur ses personnages (à l’exception peut-être de Charles Xavier) et mouline tous ses acteurs dans un film-catastrophe sans saveur. Non seulement la dites catastrophe ne se ressent jamais à l’échelle planétaire, mais elle n’a en fait rien de bien passionnant. Il faut dire qu’Apocalypse tente de s’appuyer sur son méchant ainsi que ses quatre cavaliers, ce qui est, en réalité, le plus gros point faible du métrage. Apocalypse, interprété par un Oscar Isaac maquillé comme pas possible et dont Singer a eu la très mauvaise idée de modifier la voix, n’est en fait qu’un nouveau méchant lambda tout à fait fonctionnel. Un mégalomane en puissance qui mixe diverses influences (à commencer par un arrière-goût de Magnéto) pour devenir un vulgaire tyran déjà vu cent fois à l’écran. Pire encore que d’arriver à faire mal jouer Oscar Isaac, cet opus tente de bâtir 4 autres « méchants » mais n’en fait en fait exister aucun réellement. Psylocke est un comble de mauvais goût sexiste sans aucun background, Angel est un ado rebelle qui écoute du hard rock, Tornade une voleuse égyptienne dont on ne sait rien…et reste Magnéto. Pour justifier le passage de ce dernier du côté d’Apocalypse, Singer lui inflige un nouveau traumatisme totalement gratuit que l'on sent venir dès les premiers instants. Fassbender n’y croit d’ailleurs plus vraiment et assure le strict minimum… Le pinacle de la médiocrité étant atteint avec la réécriture de personnages pourtant passionnants. Diablo, par exemple, véritable délice du second X-Men, devient ici un personnage vide et inintéressant. Une honte !
Reste alors le côté X-Men à proprement parler. Si James McAvoy tire son épingle du jeu face à une Jennifer Lawrence pâlichonne, c’est surtout le personnage de Quicksilver qui rate le coche. Extrêmement intéressant, Singer ne fait qu’effleurer sa quête alors même que l’on sent un énorme potentiel pour ce personnage qui livre une nouvelle fois la meilleure scène d’un film finalement décevant de bout en bout. Bien sûr, les fans du comics auront un large sourire lors du caméo d’un certain Wolverine en Weapon X, peut-être l’un des moments les plus bad-ass du récit, mais cela ne suffit absolument pas à rattraper l’énorme ratage que constitue X-Men : Apocalypse. En cédant aux sirènes de la pyrotechnie et de la multiplication des méchants, le film s’écroule. Il reste alors derrière tout ce fatras un moment de divertissement honnête qui fera passer le temps au spectateur venu se détendre un tantinet devant le grand écran. Un film taillé pour un public occasionnel en somme. X-men est redevenu un produit de divertissement sans saveur.
Avec cet ultime volet concluant une deuxième trilogie pourtant excellente jusqu’ici, Bryan Singer déçoit amèrement. L’américain ne profite en aucune façon des possibilités offertes par Days of the Future Past et tombe dans tous les travers qu’il avait pourtant évité auparavant. X-Men : Apocalypse s’avère le X-Men de trop…encore. Il serait temps pour Singer de passer à autre chose et à la Fox de laisser les droits à Marvel Studios pour pouvoir offrir de nouvelles perspectives à la franchise.Note : 4.5/10
Meilleure scène : Quicksilver sauve le manoir - Le caméo de Logan
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 30 Mai 2016 à 21:42
"Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? " vont certainement s'exclamer un grand nombre de spectateurs en allant voir le dernier long-métrage de Bruno Dumont (le huitième déjà depuis La Vie de Jesus en 1997).
Avec son casting de grosses stars françaises - Luchini, Binoche et Bruni-Tedeschi - largement (et forcément) mis en avant sur l'affiche, Ma Loute replonge dans ce qui avait fait le succès de la série P'tit Quinquin du même Bruno Dumont : la comédie policière grotesque ancrée dans le Nord de la France. Passionné par cette région où il a vu le jour, le cinéaste n'a donc toujours pas fini de lui rendre hommage...à sa manière du moins. Parce que Bruno Dumont reste Bruno Dumont. Ceux qui ont vu des films aussi radicaux qu'Hors Satan ou Camille Claudel le savent déjà, le réalisateur n'est pas un des tâcherons habituels du cinéma français. C'est même tout le contraire. Du coup, quand on va voir Ma Loute, ce n'est certainement pas à une comédie lambda et médiocre comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? qu'il faut s'attendre. Accrochez-vous à votre siège (des fois que vous prendriez la tangente par les airs) et bienvenue en 1910 sur une côte d'Opale où le disparitions s'accumulent...
Pour y mettre un terme, les forces de l'ordre ont sorti l'artillerie lourde avec l'inspecteur Alfred Machin, bedonnant policier aux intuitions pour le moins étonnantes. Tandis que les cueilleurs d’huîtres - et plus particulièrement la famille Brufort - vaquent à leurs occupations, la famille Van Peteghem prend ses quartiers d'été dans leur luxueuse demeure de style égyptien. Parmi eux, Billy, la fille d'Aude Van Peteghem tombe nez à nez avec Ma Loute, l'aîné de la famille Brufort. Devant son charme...animal (au moins), une histoire d'amour débute dans les dunes. Des dunes de moins en moins sûres à mesure que les mystérieuses disparitions s'accumulent ! Voici peu ou prou le postulat de départ de Ma Loute, comédie loufoque et haute en couleur née de l'esprit pas tout à fait sain, mais carrément génial, de Bruno Dumont. Autant vous dire que si vous n'avez que de la haine et du mépris pour son P'tit Quinquin...Ma Loute ne va rien arranger.
En lieu et place de l'humour grassouillet et franchouillard bas de gamme habituel, Dumont saute à pied joint dans le grotesque, au sens noble et premier du terme. Les acteurs surjouent avec bonheur, les gags se multiplient sans aucun contrôle, l'intrigue explose toutes les limites communément admises par la comédie classique à la française, et la région du Pas-De-Calais (y'en a pas que pour le Nord non plus !) s'apprécie à l'aune de traits caricaturaux comme pas possibles. Pourquoi faire un film qui viendrait méthodiquement briser les à priori sur la région (et passant aussi à côté des tares de la dites région) quand on peut prendre le slogan Consanguins, chômeurs, alcooliques au pied de la lettre et, mieux encore, aller beaucoup plus loin ? Non seulement les habitants du Nord sont des consanguins, des imbéciles et des alcooliques notoires dans Ma Loute mais en plus ils sont cannibales ! Rien que ça. Dumont ne recule devant aucun cliché, se les réapproprie dans son jeu burlesque délicieux, les magnifie et les incruste dans son intrigue absurde au possible. Le résultat, pour qui comprend un tantinet le but du réalisateur et son second degré, s'avère à mourir de rire. De surcroît dès que les acteurs ouvrent la bouche.
On espère pour les autres régions que Ma Loute sera sous-titré...parce que comprendre les Nordistes qui parlent le ch'ti en l'écrasant bien comme il faut n'est pas une mince affaire. C'est aussi (et surtout) atrocement drôle. Ma Loute serait-il donc juste une parodie de la région et, par la même occasion, d'une enquête policière (dont on a la solution après vingt minutes de toute façon !) ? Absolument pas. Non seulement Ma Loute est superbement réalisé grâce au talent incroyable de Dumont pour croquer sa région, les dunes et tout ce qui fait le charme étrange de ce coin de la France, mais aussi parce que derrière son vernis de débilités se terre un film dense et intelligent au possible. On retrouve deux clans dans Ma Loute : les pauvres de la famille Brufort, bruyants, écœurants et, pour tout dire, moches comme pas permis, et la famille Van Peteghem, riche, parlant avec une emphase ridicule, à cheval sur les convenances et imbu d'elle-même. Le petit peuple du Nord d'un côté, et sa bourgeoisie de l'autre. Entre ces deux groupes, le trait d'union Ma Loute/Billy qui vacille forcément montrant l'impossible réunion des deux mondes. Dumont va plus loin d'ailleurs en mettant tous les acteurs connus du côté des bourgeois et les inconnus de l'autre. Directeur d'acteurs brillant, il métamorphose Luchini pour notre plus grand plaisir et nous livre en pâture une Binoche plus maniériste que jamais. Chaque détail a son importance dans Ma Loute.
La pauvreté, la force du surnaturel et du deus ex machina, la romance tragique, la débilité policière et même l'ascendant générationnel, tout concourt à faire de Ma Loute une comédie à part. Le genre d'objet indescriptible et fou qui prend toutes les libertés et emmerde à peu près tout le monde pour faire ce qu'il veut avec une grosse dose de talent par dessus. La puissance du cinéma de Dumont se niche là-dedans, dans cette capacité à faire croire au public qu'il va se plier au Diktat de l'industrie grand public en engageant des acteurs émérites pour livrer en fait quelque chose de dingue. De salvateur en somme pour les neurones et pour l'amour du beau cinéma. Reste juste à comprendre que cette peinture mi-comique mi-réaliste de sa propre région permet autant à Dumont de déclarer une nouvelle fois sa flamme au Nord (et de façon tellement plus inventive que des navets comme Bienvenue chez les Ch'tis) tout en restant lucide sur le clampin de base, franchement pas finaud. De toute façon, il faut des deux au long-métrage pour pleinement s'épanouir.
Brillante réussite, délirante et grotesque, intelligente et loufoque, Ma Loute démontre que Dumont peut plier la comédie à sa volonté. Il ne s'agira certainement pas du film qui réconciliera le grand public avec le cinéaste, mais au fond, est-ce vraiment l'important ? Le cinéma, lui, le remercie.
A consommer sans modération (et avec autodérision pour les Nordistes).Note : 9/10
Meilleure scène : Le premier repas de la famille Brufort
Meilleure réplique :
"Votre beau-frère, c'est aussi votre cousin ?"
"Oui, c'est moderne, c'est capitaliste !"
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 18 Mai 2016 à 16:23
![[Critique] Dalton Trumbo](http://ekladata.com/8KFZQnIU2X8lwgmcFwkwtDiJJDY@555x822.jpg)
Nommé Oscar meilleur acteur 2016 pour Bryan Cranston
On ne peut pas dire, loin de là même, que Jay Roach soit un réalisateur qui compte à l'heure actuelle. C'est pourtant dans son dernier film, Dalton Trumbo, que Bryan Cranston décroche (enfin !!) un rôle à sa hauteur dans les salles obscures. Jusque là cantonné à des seconds rôles plus ou moins discutables au cinéma, l'acteur de génie qui nous a tous bluffé dans des séries comme Malcolm ou Breaking Bad peut enfin déployer pleinement son talent. Endossant la trogne fatigué du légendaire scénariste Hollywoodien, l'américain s'ouvre les portes de la plus prestigieuse des cérémonies : les Oscars. Nommé en tant que meilleur acteur, Bryan Cranston semble enfin pouvoir briller sur grand écran. Malheureusement, Roach n'est pas un réalisateur habitué au genre et encore moins au sérieux d'un tel exercice. Comment peut s'en sortir l'homme derrière Austin Powers ou Mon Beau-Père et moi sur un sujet beaucoup plus délicat et complexe ?
Il ne s'agit plus cette fois de parler des délires d'un agent secret vulgaire à souhait ou de livrer un remake honteux du Dîner de Cons mais bien de raconter l'histoire d'une légende du cinéma américain, le fameux Dalton Trumbo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'homme, et sans déflorer l'intrigue du film, Dalton Trumbo fut l'un des plus grands scénaristes d'Hollywood dans l'après Seconde Guerre Mondiale et le début de la Guerre Froide. Malheureusement pour lui, il était alors membre du Parti Communiste des Etats-Unis et fut donc considéré par la commission des activités américaines comme un agent séditieux chargé de saper par son travail les valeurs américaines de l'époque. Il fut non seulement inscrit sur la fameuse liste noire d'Hollywood mais aussi condamné à une peine de prison lorsqu'il refusa de se plier aux injonctions de la dites commission. Seulement voilà, Trumbo n'est pas du genre à se laisser abattre et finira par remporter deux oscars sous des noms d’emprunt. Forcément doté d'un puissant potentiel dramatique et politique, la vie de Trumbo se prêtait extrêmement bien à un biopic...Seulement, à bien des égards, le résultat peut s'avérer décevant. En choisissant Roach, qui n'a qu'un talent de faiseur de seconde zone à Hollywood, les studios de production se prive d'une puissance dramatique certaine. On constate rapidement que le réalisateur n'a rigoureusement aucun trait de génie dans sa mise en scène et qu'il se contente de faire du fonctionnel. Le résultat n'est pas désagréable, pas du tout même, il manque juste de personnalité. Ajouté à la longueur du récit, deux heures, on se retrouve devant un métrage un tantinet longuet qui raconte de façon linéaire et totalement académique le parcours de Trumbo en tentant d'imbriquer avec plus ou moins de succès sa vie personnelle et son rôle politique ainsi que cinématographique. De ce fait, le film pourrait devenir un ennuyeux cours d'histoire saupoudré d'une morale convenue sur la liberté d'opinion. A un détail près.
Ce détail, c'est Bryan Cranston. Habité par son personnage, l'acteur de Breaking Bad navigue entre ses deux registres favoris, drame et comédie, pour trouver le parfait équilibre et porter tout le film sur ses épaules. Son charisme et sa prestance donne au récit une empathie qui vient combler la fadeur de la mise en scène. Il n'est d'ailleurs pas seul en cela puisque le film aligne les excellents acteurs et actrices. Helen Mirren en garce calculatrice, Louis C.K. en militant idéaliste ou encore Diane Lane en épouse-courage, sans oublier la jeune mais splendide Elle Fanning, Cranston peut compter sur une pléiade de bons partenaires à l'écran pour lui donner la réplique. Devant son numéro bluffant, l'américain arrive à faire passer à la fois les forces et les faiblesses de Trumbo tout en rendant son combat plus important. C'est certainement ici que le film se sauve définitivement.
Malgré la fadeur de sa mise en scène, le long-métrage cause d'un sujet d'une grande importance historique et il le fait bien. On regrette évidemment qu'un réalisateur plus audacieux ne se soit pas emparé du script de ce biopic mais, en l'état, la portée politique (et sociale) du récit s’impose malgré tout. Non seulement Dalton Trumbo cristallise une époque avec son intolérance et ses peurs, mais il trouve un écho dans la nôtre. Si l'on parle cinéma pendant ces deux heures, on y parle aussi, et surtout, d'idéaux. Doit-on défendre ses idées envers et contre tout ? Un gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, peut-il nous forcer à la délation ou à renier nos convictions ? Le long-métrage explore ces questions, avec des réponses certainement un peu trop évidentes il est vrai, mais nous pousse à réfléchir sur la liberté d'opinion, politique, cinématographique ou autre. Peu importe. On touche alors du doigt le regret initial. Un film sur un scénariste au combat aussi fort et anti-conformiste aurait mérité une mise en scène à son échelle. Il se contentera d'un acteur grandiose et d'un casting impressionnant autour d'une intrigue classique mais prenante et au message fort.
Dalton Trumbo n'avait certainement rien à faire dans la cérémonie des oscars en terme de réalisation mais il avait bel et bien sa place dans la course au meilleur acteur. Littéralement porté à bout de bras par un Bryan Cranston génial du début à la fin, le long-métrage se penche sur une page sombre de l'histoire d'Hollywood en délivrant cependant un message intemporel sur la liberté d'opinion. Un biopic conventionnel mais passionnant.Note : 7.5/10
Meilleure scène : Trumbo s'excusant auprès de sa fille
Suivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page Facebook
Suivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Regardez les étoiles


![[Critique] Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar](http://ekladata.com/gR7l1WfH-vDhlTSBMLROZ4ZxJIE@555x822.jpg)
![[Critique] Message from the king](http://ekladata.com/Li_LD2Fv4jPXLOrUM00Pi9kf1T8@555x740.jpg)
![[Critique] Patients](http://ekladata.com/cpr2X5HyqT45LDA-1WyJMTRM-4s@555x754.jpg)
![[Critique] Loving](http://ekladata.com/TSb7M9pK8bTeLN0pNbI8aE57kJY@555x822.jpg)
![[Critique] Silence](http://ekladata.com/jjMB9QbHOAv-uUd6P-dStIz6w9Y@555x724.jpg)
![[Critique] American Pastoral](http://ekladata.com/6fRhrEFFe3jgY1-IJfHcgm3FdjE@555x857.jpg)
![[Critique] Beauté cachée](http://ekladata.com/hdyjmIt4aebw3oH-fGtpUOdFQ6o@555x823.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/5vxLHCN-qDMA8cuLG1Q3UZ50HGU@555x312.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/oSqufrcuFfEWpcVBGVbPDN21y9A@559x372.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/Z24zrBp74r9wAPMO8Jrk4y8p20A@554x349.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/2Ai3HZw2sd0Z74mXjDohaS0Aw0s@553x368.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/17BAyDJxzp2jcu1bQrGf0_01408@551x332.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/9G3x28mRIMstgAa_8iEgeE2_el4@554x311.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/DN1Clav1GPr_Mx77fIGURoE1zLI@558x300.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/AUQqC6OECNYpLaPNY3ukTF5fqzA@556x370.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/Kfb53XpVUPlGlWIStWQbTUQYfcs@561x294.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/CHcao1QRANJhH7L6SYGOjW15jS0@561x313.jpg)
![[Top] Bilan Cinéma 2016](http://ekladata.com/amBgd5rBx9LuQskipvoo5YY3I5I@562x316.jpg)

![[Critique] Trolls](http://ekladata.com/_HN1_BkQspKRRxXqg-U3qC1uCTI@555x740.jpg)
![[Critique] Trolls](http://ekladata.com/VskeI_bu5Bshyt5pphUcFs6fOss@250x188.jpg)
![[Critique] War Dogs](http://ekladata.com/aMvMh4k045Krpp3GoDxTBcbx7yk@555x823.jpg)
![[Critique] Spartacus](http://ekladata.com/0snqAQyhXmezFNRIjVN12Whj5WQ@555x801.jpg)
![[Critique] Nocturama](http://ekladata.com/RYbIvdfdwWk21zwAquznt_VnRqY.jpg)
![[Critique] Les Sentiers de la gloire](http://ekladata.com/hfJVqyBcH2hGudZ3swaXRNlp2Dk@555x740.jpg)
![[Critique] The Killing (L'Ultime Razzia)](http://ekladata.com/Cb9h8Vwx6gVgvgMb7ZR2C-pB66s@555x801.jpg)
![[Critique] Fear and Desire](http://ekladata.com/lD1cr7EXQdPJOTMhqBMLUkZa0r0@555x740.jpg)
![[Critique] Independence Day : Resurgence](http://ekladata.com/d_VEPvbhm_DXq94UtmOSnJnCGHo@555x823.jpg)
![[Critique] Suicide Squad](http://ekladata.com/j4l09NPB-zZ3STxD550QVNRC2QA@555x833.jpg)
![[Critique] Comme des bêtes](http://ekladata.com/6uER34Ma5jv-WBMqNHsDiNCGAEk@555x879.jpg)
![[Critique] Le Monde de Dory](http://ekladata.com/cGNBYAH28oF7iWUh2sqc0LQC8BI@555x785.jpg)
![[Critique] The Neon Demon](http://ekladata.com/bK0vq5m4fvIOvkSasf2Tio2nfXo@555x856.jpg)
![[Critique] Paranoia Agent](http://ekladata.com/77wxGDoIQReDrxcUwhF4NxY5SyY@555x756.jpg)
![[Critique] Warcraft](http://ekladata.com/7hg-FKbBfZsOpdMdWbnoP82qYSk@555x879.jpg)
![[Critique] Men & Chicken](http://ekladata.com/5qZNhJfy1rOmsQByN8-IEMFhnn4@555x793.jpg)
![[Critique] X-Men : Apocalypse](http://ekladata.com/gkdtz1sM54_Ry7BLNwP_jNTjAuc@555x798.jpg)
![[Critique] Ma Loute](http://ekladata.com/iz2Cb65j596TS6wRzUq67gaJgOI@555x740.jpg)


