-
Par Nicolas Winter le 4 Octobre 2014 à 19:46
![[Critique] J'ai tué ma mère](http://ekladata.com/3XS0C5cwAYVBZJqhZH623NR0Y_4.jpg)
En 2008, l'acteur québécois Xavier Dolan, alors âgé de 19 ans, décide d'investir toutes ses économies dans la réalisation de son premier long-métrage intitulé J'ai tué ma mère. En grande partie autobiographique, le film se base sur le scénario écrit par Dolan lorsqu'il n'avait que 16 ans. Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2009, J'ai tué ma mère est immédiatement salué par la critique et décroche le Prix Art et Essai, le prix SACD et le prix Regards Jeunes. L'espace d'un seul long-métrage, Xavier Dolan est propulsé sur la scène internationale et J'ai tué ma mère deviendra même le choix du Canada comme candidat à l'Oscar du meilleur film étranger. Film fauché mais magnifique, la première oeuvre de Xavier Dolan reste encore, aujourd'hui - et encore davantage avec la sortie de Mommy - une des pierres angulaires de la filmographie du québécois.
Hubert est un adolescent de 16 ans comme on en trouve tant. Tiraillé par son envie de liberté et de rébellion, il ne supporte plus Chantal, sa mère. Sa façon de chantonner, de manger, sa façon de conduire ou même d'écouter la radio, tout agace Hubert au plus haut point. Il faut dire que Chantal, mère célibataire qui doit, seule, assumer l'éducation d'Hubert depuis qu'il a 7 ans, n'est pas non plus une mère parfaite. Entre petites manigances et grosses manipulations, Chantal a peu à peu perdu le contact avec son fils. Malgré le soutien d'Antonin, son petit-ami et de Julie, son enseignante, Hubert ne trouve pas le moyen de revenir à l'amour enfantin et à la complicité qui l'unissait à sa mère. Alors, il se confie. A sa caméra, par des poèmes ou du dripping, Hubert tente de surmonter son ressentiment. Parce qu'au fond, malgré ses défauts, Chantal sera toujours sa mère.
J'ai tué ma mère est un film à très petit budget, tourné avec des moyens restreints. De ce fait, dès le début, le long-métrage fait très film amateur. Pourtant, on s'aperçoit au bout de quelques scènes que si le film est fauché, il n'est pas mauvais. C'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que Xavier Dolan a non seulement un scénario génial et des personnages immensément forts, mais aussi parce qu'il est, déjà, un petit génie de la mise en scène. Le québécois déploie rapidement une foule impressionnante d'idées de mise en scène, filme ses protagonistes sous tous les angles, les saisit dans la plus grande intimité, utilise la caméra d'Hubert façon témoignage noir et blanc, monte des images bout à bout comme s'il était dans un clip de musique et justement, utilise la musique comme un outil faisant partie intégrante de sa réalisation. Ainsi, J'ai tué ma mère a beau accuser son manque de budget, il s'avère épatant visuellement. Il bouillonne d'idées, d'images, de scènes fortes. C'est une vraie révélation. Dolan n'hésite jamais même à retranscrire du texte à l'écran pour que le spectateur lise ce que le personnage à l'écran est en train de lire en même temps. Un poème, un titre, quelques lignes. Tout ici sera prétexte à entrer dans la tête d'Hubert. Quant à la musique, Dolan se constitue une BO magnifique, entre morceaux classiques style Vivaldi et musique plus populaire style Noir Désir. Épousant parfaitement le propos de chaque scène, les différentes chansons et compositions magnifient et approfondissent ce que veut dire et surtout faire ressentir Dolan. Le résultat est souvent renversant.
Et puis, il y a Xavier Dolan acteur. Incarnant Hubert, le québécois joue en grande partie son propre rôle. Focalisé sur son personnage, Dolan fait preuve d'un narcissisme certain mais qui, contrairement à d'habitude, n'handicape pas le film. Celui-ci est en effet totalement centré sur l'adolescent en pleine crise, et la surexposition de Dolan va de soi immédiatement. Elle sert son propos et donc réussit brillamment à incarner Hubert. De l'autre, il y a Anne Dorval, en mère lunatique et (un peu) boulet, déjà extraordinaire, par sa sobriété et son authenticité, qui alterne moments de silence indignés et éclats de colère monstrueux (cette séquence au téléphone avec le directeur du pensionnat !). L'interaction entre les deux acteurs est immédiate. Et le spectateur se retrouve emporté, chaviré par cette relation d'amour-haine féroce aux nombreux coups de tonnerre qui émaillent le film. On y retrouve l'universel bouleversement de l'adolescence et le changement des relations entre parents-enfants, d'autant plus fort qu'ici, Anne doit tout supporter de son fils. Le père, fugacement présent, est un fantôme qu'Hubert ne connaît presque pas. Pourtant, malgré les horreurs que balance Hubert à Chantal, malgré, parfois, les crises incompréhensibles de Chantal, on n'arrive jamais à détester ni l'un ni l'autre. Au contraire, on les aime ces personnages, on aime cette façon tellement judicieuse qu'a Dolan de présenter les choses.
Toute la magie de J'ai tué ma mère, c'est de montrer à travers des protagonistes tout à fait imparfaits et parfois méprisables, toute la complexité de la relation mère-fils. Capturée de façon poignante par Dolan, la situation est d'une justesse incroyable. On ne doute jamais que le québécois parle en grande partie de sa vie, mais il a le don pour le retranscrire de telle manière que tous se retrouveront un peu dans Hubert. Au lieu d'ailleurs de nous faire un discours sur l'homosexualité et de transformer son métrage en un banal plaidoyer sur l'acceptation par Chantal de l'orientation sexuelle de son fils, Dolan s'en sert comme d'un simple (mais essentiel) rouage, d'un simple élément d'arrière-plan, il ne se focalise jamais dessus, ne diverge jamais longtemps à ce propos. Non, il reste sur Hubert et sur son incompréhension vis-à-vis de l'évolution de ses rapports avec sa mère. Et tout sonne ainsi formidablement juste. Malgré des échappées artistiques ou amoureuses, Hubert retourne toujours à celle qui, au fond, représente la base de son existence, cette mère qu'il hait d'amour. J'ai tué ma mère ne raconte pas tant le passage adolescent d'un jeune en manque de reconnaissance affective que le désir de retrouver une enfance perdue, une mère que l'on a tant aimé, mais avec les yeux d'un jeune adulte, et non plus d'un simple enfant.
Avec J'ai Tué Ma Mère, Xavier Dolan entre par la grande porte dans la cour des grands. Émouvant, d'une justesse incroyable, le premier film du québécois refuse la facilité et se termine sur une séquence dépourvue de mot absolument magnifique et tellement plus significative ainsi.
En 2009, un grand réalisateur est né, il s'appelle Xavier Dolan.
Note : 8.5/10
Meilleures séquences : Chantal qui perd son sang-froid au téléphone, le Dripping et surtout la séquence finale.
Meilleure réplique :
"Qu'est-ce tu f'rais si je mourrais aujourd'hui ?"
"J'mourrais demain..." votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 2 Octobre 2014 à 20:24
![[Critique] Les Révoltés de l'île du Diable](http://ekladata.com/lS7WviELn12Hp-a5C6pU8vfOvv4.jpg)
Le cinéma nordique, aussi froid et austère puisse-t-il paraître, recèle nombre de pépites cinématographiques. C’est le cas du long-métrage de Marius Holst, Les Révoltés de l’île du Diable, sorti en 2011 sur les écrans. S’inscrivant dans la droite lignée de films tels que Dog Pound ou Sleepers, l’histoire des Révoltés se base en grande partie sur des faits historiques. Film à charge contre les centres de correction autant que témoignage d’un crime odieux, le long-métrage tend également à revenir sur une certaine conception historique de l’éducation au début du siècle dernier. Authentique plongée glaçante dans le cercle de la violence et de l’injustice, Les Révoltés de L’île du diable laisse un souvenir durable au spectateur.
Nous sommes en 1915, en Norvège, dans le centre de correction de Bastoy. Sur cette petite île, des dizaines de jeunes sont internés pour revenir dans le droit chemin. L’arrivée d’une nouvelle forte tête en la personne d’Erling va soumettre la direction de l’établissement à de nouveaux défis. Redoublant de sévérité et de violence, les surveillants tentent de mettre au pas le délinquant. Son influence sur Olav, un des jeunes les plus prometteurs pour le gouverneur Bestyreren, va venir bouleverser l’ordre établi et le microcosme formé par la loi du plus fort. Quand un scandale éclate à propos des relations entretenues par le surveillant Brathen avec Ivar, un des plus fragiles pensionnaires du centre, toutes les conditions sont réunies pour qu’une émeute vienne mettre à bas l’institution...
Marius Holst n’est pas un novice, Les Révoltés de l’île du Diable étant son quatrième long-métrage. Sa réalisation, typique des pays scandinaves, plonge le spectateur dans le froid et rigoureux hiver norvégien. Les images qu’il en tire sont aussi glaciales que l’environnement dans lequel évoluent les protagonistes de l’histoire. Avec une lenteur assumée, le film prend le temps de poser ses personnages et d’établir les rapports de force entre eux. Cette montée en tension, inexorable, fait peser sur le film une sorte de chape de plomb aussi lourde que son sujet. Parce que c’est bien le sujet du métrage qui va fouiller loin dans la noirceur de l’âme humaine. Holst se sert d’un fait historique – la révolte des adolescents et enfants du centre Bastoy – pour étudier l’intrication entre violence, éducation et morale. Ainsi, il édifie un système où les plus forts s’affirment non pas par leur nombre mais par la peur qu’ils instillent et les punitions exemplaires qu’ils exercent sur quelques-uns. En réalité, on se rend compte que le récit montre peu d’actes de torture par les surveillants, l’ignominie de Brathen étant d’ailleurs toujours hors-champ ou sous-entendue. Tout le talent de Holst se niche dans ce refus de faire dans le démonstratif pur mais de jouer sur l’enfer psychologique qui en découle. Il allie une réalisation sobre et relativement dépouillée, parfois proche du documentaire, avec un refus de l’esbroufe qui sert totalement son propos.
De même, le norvégien fait un autre choix surprenant. Excepté le génial Stellan Skarsgard et le non moins génial Kristoffer Joner, tous les acteurs du film sont des débutants. Que ce soit Benjamin Helstad dans le rôle d’Erling ou Trond Nilssen dans celui d’Olav, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces jeunes interprètes sont tous des novices. De cette façon, et grâce à leur insolent talent, le récit transpire de sincérité et d’authenticité. Il est véritablement impossible de deviner qu’ils n’ont jamais joué ailleurs. Les relations qui s’établissent entre eux paraissent dès lors d’autant plus poignantes et vraisemblables. Elles constituent le moteur du film et permettent de dresser un portrait convainquant de ces révoltés de Bastoy. La complicité qui s’établit petit à petit entre les personnages d’Erling et d’Olav, que tout semble pourtant opposer, permet de rendre compte de la solidarité qui peut se forger à l’ombre de la persécution et de l’injustice. Mais pour autant, les deux individus présentés par Holst ne sont pas des saints, bien au contraire, ils sont juste humains, et c’est certainement cela qui donne la force de leur histoire. Le réalisateur norvégien démontre avec brio que le recours à une forme ultrarigide d’éducation associée à une violence souvent aveugle ne mène qu’à renforcer le sentiment de rancune des jeunes pensionnaires de Bastoy, et pire, à les déshumaniser. La séquence finale de révolte et son déchaînement de violence prouvent une seule chose : Bastoy est une mauvaise réponse à une question pourtant épineuse. Car si les délinquants du centre ne sont pas des anges, les surveillants non plus, et notamment Brathen, véritable monstre et prédateur sournois. Comment dès lors espérer se revendiquer comme référence morale lorsque l’on emploie soi-même des hommes aussi répugnants ? Le gouverneur Bestyeren trouvera une réponse amère à cette interrogation au travers de la terrible conclusion du récit.
Au-delà même du propos sur la violence et sur l’éducation, Les Révoltés de l’île du Diable aborde le thème universel de la liberté. Au travers de ces enfants traités avec une sévérité totalement démesurée, il y a une certaine mise en garde contre ce que les hommes sont prêts à faire lorsqu’il s’agit de se protéger ou lorsque, simplement, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent avec l’accord tacite de leurs supérieurs. Dans ce centre, tous les éléments sont en place pour les camps de concentration ou les goulags, mais à une échelle bien moindre, forcément. Holst démontre que les origines du mal sont bien plus profondes qu’elles n’y paraissent. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Erling est un baleinier qui rêve de la mer ou que le récit y fasse si souvent allusion, visuellement ou autre. Cette étendue d’eau, prise sous les glaces en fin de récit, est finalement le symbole éternel de la liberté, celle à laquelle aspirent les personnages du long-métrage.
« Homme libre, toujours tu chériras la mer » disait Baudelaire.
Mais dans le film de Holst, il s’y terre également la cruauté la plus perfide, aussi acérée que le trait des baleiniers, aussi mortelle que les surveillants et dirigeants de Bastoy.
Magnifique fresque dramatique, Les révoltés de l’île du Diable est un des meilleurs films autour des centres de correction et une réflexion poussée sur l’éducation et la liberté. Marius Holst nous offre un joyau glacial venu du grand Nord.
Vous auriez tort de vous en priver !
Note : 9/10
Meilleure scène : L'échappée finale d'Erling et Olav votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 28 Septembre 2014 à 15:26
Pour ce court-métrage du dimanche, encore de la SF, mais cette fois, de la SF comique avec Johnny Express, ou comment une simple livraison peut tourner au drame planétaire !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 22 Septembre 2014 à 13:17

Décidément, cette année, le demi-Dieu Hercule est à l’honneur. Pas moins de deux longs-métrages en quelques mois. Soyons francs, la quantité ne rime pas souvent avec la qualité. Et c’est un peu le cas ici. Le premier film, La Légende d’Hercule, était signé Renny Harlin, qui n’a rien fait de mémorable depuis 58 minutes pour vivre. Après ce premier essai aussi risible que moche, c’est au tour de Brett Ratner de revenir sur le fils de Zeus. En s’inspirant du comic book éponyme de Steve Moore, il tente donc de dépoussiérer le mythe et de livrer sa propre vision du héros. Pourtant, pas de quoi s’enthousiasmer. Rappelons quand même que Ratner est l’homme à l’origine du médiocre troisième volet de X-Men, celui-là même que Bryan Singer a renié dans son dernier film. Malgré un certain nombre d’acteurs réjouissants, Dwayne Johnson et Ian McShane en tête, autant dire que la prudence est de mise.
Hercule est un héros, une légende. Selon celle-ci, il est le fils illégitime de Zeus et d’une mortelle, il a accompli douze travaux impossibles pour le commun des mortels et surtout, on prétend que nul homme ne peut le blesser. Accompagné par une troupe de guerriers des plus hétéroclites, le héros est mandé par le roi Cotys en Thrace, une région de la Grèce. Harcelé par Rhésus, le royaume est en proie à une terrible guerre civile. Pour protéger le peuple autant que pour l’argent, Hercule et sa troupe acceptent d’entraîner l’armée inexpérimentée de Cotys et de défaire Rhésus et sa troupe de Centaures. Pourtant, de nombreuses surprises attendent le demi-Dieu.
Commençons par le dire clairement : si vous avez lu les (excellents) comics books de Moore et que vous pensez les retrouver à l’écran, vous pouvez faire demi-tour. Du récit de Moore, il ne reste que quelques noms (La Thrace, le roi Cotys, les hommes et femmes de la troupe d’Hercule) et quelques grandes lignes scénaristiques (La guerre civile, l’entraînement des troupes par Hercule). Le reste, avec cette logique détestable d’Hollywood, est expurgé de toute l’originalité du comics. Donc, oui, Hercule par Brett Ratner est une très mauvaise adaptation du travail de Steve Moore, en plus de ne même pas signaler qu’il s’en inspire (ce qui reste honteux).
Mais relativisons. Si vous ne connaissez pas le travail original, ou si vous savez faire la part des choses, Hercule peut devenir bien plus sympathique. Contrairement à ce que l’on pouvait craindre après le film d’Harlin, la réalisation de cet opus est nettement meilleure. Dans nombre de séquences, Ratner arrive à vraiment retranscrire le souffle épique des batailles de l’Antiquité (on pense notamment à l’attaque du village des cannibales). Surprenant également, les effets spéciaux du métrage sont tout à fait corrects, sans atteindre la perfection visuelle de Weta Workshop par exemple, mais assez impressionnants pour faire naître quelques séquences plaisantes. Côté scénario, celui-ci reprend donc quelques bases de celles du comics mais les lisse pour donner un récit fait de batailles héroïques et d’intrigues politiques. De ce côté, il n’y a rien de très original dans Hercule, tout reste assez convenu et on voit venir le retournement final à des kilomètres. Le vrai bon côté d’Hercule se cherche ailleurs.
Il se trouve dans la joyeuse équipe rassemblée autour du demi-dieu (et qui doit tout à celle du comics) remplie de beaux seconds rôles et qui fonctionne très bien à l’écran. De Rufus Sewell au génial Ian McShane (mais pourquoi cet acteur est si dédaigné d’Hollywood ?) en passant par Aksel Hennie, ils sont tous aussi charismatiques qu’attachants. Seule Atalante, l’amazone, jouée par Ingrid Borso Berdal, laisse une impression persistante de miscast, tant par son costume ridicule que par sa carrure totalement inadaptée pour le rôle. De même, Dwayne Johnson est une vraie bonne surprise, qui renvoie à Schwarzenegger dans Conan, un acteur bodybuildé impliqué dans son rôle et qui s’attire assez rapidement la sympathie du spectateur par la sincérité de son travail. Il est franchement convaincant, malgré toutes les réserves que l’on aurait pu avoir à son sujet. Le dernier atout du métrage, c’est la volonté de Ratner d’explorer la voie de la démythification et de rendre Hercule plus humain. Si le procédé n’est pas convaincant à 100%, il permet d’ajouter une touche d’originalité au récit balisé du demi-Dieu.
Malheureusement, il faut tempérer cet enthousiasme initial. Ratner, malgré ses bonnes intentions, ne dépasse jamais le cadre du blockbuster de série B. C’est sympathique mais c’est anecdotique. Trop sage, trop conventionnel, le récit souffre également d’énormes lacunes au niveau de sa cohérence qui, franchement, brisent toute sa crédibilité. Le meilleur exemple ? Les pertes après la première bataille, qui réduisent le nombre d’hommes de Cotys à une grosse poignée, et qui se comble miraculeusement en une nuit (Ses hommes doivent se multiplier par mitose). On citera également le nouvel équipement qui arrive comme par magie ou encore le fait que les hommes d’armes du roi semblent tantôt subjugués par Hercule, tantôt s’en foutre royalement (sans compter que les archers Thraces sont certainement les plus nuls toutes catégories confondues). Le gros souci d’Hercule, c’est à la fois de ne jamais donner plus que son postulat simpliste de départ, mais également de tomber dans tous les pièges du film américain lambda avec les facilités que cela implique.
Un sympathique film de série B avec de bons effets spéciaux. C’est un peu ce que l’on retiendra d’Hercule, à condition de ne pas avoir lu le comic book original. Fun et comptant assez d’acteurs convaincants dans ses rangs, le métrage de Brett Ratner n’est pas la catastrophe annoncée.
Dommage cependant, il aurait pu être tellement plus que ce qu’il est au final...
Note : 6/10
En tant qu’adaptation : 3/10 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2014 à 20:19
![[Critique] Le Secret de Kanwar](http://ekladata.com/M1uFdxcI2hip3kq7Ay9iBck2W1s.jpg)
Inconnu en France, Anup Singh signe avec Qissa, the tale of a Lonely Ghost (stupidement traduit par Le Secret de Kanwar...) son second film. Le réalisateur indien porte son dévolu sur une question cruciale et extrêmement sensible dans la société Indienne : la place de la femme. Il confie son rôle principal à Irrfan Khan, l’excellent acteur de The Lunchbox ou L’odyssée de Pi, qui donne ici la réplique à la jeune actrice Tilotama Shome. Véritable portrait de l’Inde post-partition, Qissa est également une histoire profonde entre un père et sa fille. Sorti un peu en catimini en France, le long-métrage mérite pourtant une bien meilleure visibilité que nombre de films actuellement à l’affiche...
Nous sommes en 1947 et les Indes se scindent en deux parties distinctes : Le Pakistan, musulman, et l’Inde, Hindouïste. Alors que de terribles nettoyages ethniques ont lieu dans le Penjab, Umber Singh, un sikh, décide d’abandonner sa maison et de passer dans les territoires Indiens pour mettre sa famille à l’abri. Sa femme vient d’accoucher de son troisième enfant... une troisième fille. Alors que la vie reprend petit à petit son cours dans la nouvelle demeure familiale, une nouvelle naissance approche. Umber décide alors de faire une chose aussi extrême que folle : nier le sexe de son dernier enfant, encore une fois une fille, et de l’appeler Kanwar. Cachant au monde sa nature féminine et l’élevant comme un garçon, Umber se voit contraint à de nouvelles extrémités lorsque Kanwar arrive à l’adolescence et que l’inévitable mariage approche avec Nelli, une gitane.
Pour aborder un sujet aussi épineux, Anup Singh décide d’ajouter une touche de fantastique à son film. Le métrage s’ouvre sur les cent pas effectués par le fantôme d’Umber Singh, ressassant inlassablement sa faute passée. La suite reste plus classique et revient en arrière, lors de la fuite de Singh à travers le Penjab. Disons-le clairement, Qissa n’est pas du tout le récit des massacres ethniques de cette période, ils ne sont qu’entrevus et servent de point de départ à l’histoire du patriarche et de sa famille. Tout se concentre en réalité sur la décision incroyable d’élever le quatrième enfant comme un garçon alors qu’il s’agit en réalité d’une fille. Avec une précision et une justesse absolues, Anup Singh amène cette réalité toute indienne devant les yeux occidentaux de ses spectateurs. Dès lors, le récit ne parle plus que de la relation père-fille contrariée et de la douleur de Kanwar, qui comprend, petit à petit, l’horreur de la supercherie. Cette plongée en apnée dans une société qui confine la femme à un rôle dégradant dénonce une réalité terrible et poignante.
Non seulement Kanwar se retrouve étranger dans son propre corps qu’il ne peut pas accepter décemment – son père et sa famille l’ont toujours traité en garçon – mais en plus, il doit supporter une impossibilité de développer une relation mère-fille convenable. Hantée par le poids de la culpabilité – outre Umber Singh, elle seule connaît le secret de Kanwar – elle évite sa fille et se retrouve incapable de s’opposer à la folie de son mari. C’est la stupeur qui règne dans le long-métrage, la stupeur du spectateur devant les extrémités auxquelles se plient Umber, des petits mensonges aux véritables outrages, rien n’est épargné à l’identité profonde de Kanwar. De ce fait, la relation avec son père, ombre écrasante et étouffante, a quelque chose d’extrêmement dérangeante, tant Kanwar veut rendre fier ce dernier qui nous apparaît pourtant comme un monstre. Anup Singh dénonce une société qui non seulement condamne les femmes à un rôle de « fardeau » – elles ne sont qu’un poids pour une famille, puisqu’il faudra épargner pour la fameuse dote – mais qui en plus, arrive à gommer l’aspect humain du mariage, simple tractation entre familles qui décide quasiment de l’avenir des époux et de leurs parents. Le constat est terrible, le bilan de ce mode de pensée proprement horrifiant.
Pour porter ces deux rôles complexes et délicats, Irrfan Khan et Tilotama Shoma, respectivement Umber et Kanwar, déploient un génie incontestable. Leur interaction apparaît sincère dès les premières minutes. Mais Rasika Dugal, Nelli, ne démérite pas non plus. La seconde partie du film fait toute la lumière sur le mal-être de Kanwar et développe un nouvel axe, celui d’un amour impossible entre des époux qui ont été dupés. C’est ici que le métrage prend son tournant le plus tragique et que la question de l’identité éclate au grand jour. Le personnage de Kanwar se déteste, n’arrive pas à accepter sa nature. Hanté par son père, il finira totalement absorbé par le mode de pensée qui l’a vu grandir... le détruisant définitivement. C’est à ce niveau, en toute fin du film, que le fantastique revient doucement. La séquence dans la mare ne laisse pourtant aucun doute sur la seule voie qui s’ouvre devant Kanwar, désormais écho funeste de son propre père.
Qissa, A Tale of a Lonely Ghost, a tout du grand film. D’une justesse surprenante, brillamment interprété et surtout troublant portrait d’une Inde où la femme n’existe pas, le métrage captive en plus par son questionnement sur l’amour paternel et l’identité sexuelle.
A découvrir absolument si le sujet vous intéresse un tant soit peu !Note : 8.5/10
Meilleure séquence : Nelli qui tente de faire ressortir la féminité de Kanwar en l’habillant comme une femme, pour la première fois de sa vie. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2014 à 11:14
![[Critique] Party Girl](http://ekladata.com/rjUD5e8zqUpjoTI7UIBQKiNrg7k.jpg)
Véritable surprise lors de la dernière sélection d’Un Certain Regard de Cannes, Party Girl est un film surprenant. Emmené par un casting majoritairement composé d’amateurs, Angélique Litzenburger en tête, le long-métrage est également signé par trois co-réalisateurs/co-scénaristes à partir de l’histoire de l’un deux, Samuel Theis. En grande partie autobiographique, le récit de Party Girl fait la part belle à l’improvisation et la spontanéité, tout en abordant un sujet peu exploré au cinéma avec la fin de carrière triste et difficile d’une fille de cabaret. Véritable plébiscite sur la Croisette, le film a remporté le Prix D’ensemble pour son casting et surtout la Caméra D’Or. Malgré tout, avec la déconvenue La Vie d’Adèle l’année dernière, qui se voulait aussi dans une veine réaliste/naturaliste, Party Girl était attendu avec une certaine appréhension.
Party Girl, c’est l’histoire d’Angélique Litzenburger, une danseuse de cabaret vieillissante de Forbach. Bien consciente que sa carrière touche à sa fin, et malgré l’immense tendresse qu’elle voue à sa vie au sein de ses amis du cabaret, Angélique accepte la demande en mariage d’un client, Michel. A cette occasion, elle décide de renouer les liens avec la dernière de ses filles, Cynthia, soustraite à sa garde dès son plus jeune âge par les services sociaux. Avec l’aide de ses trois autres enfants, elle entreprend de la rencontrer pour qu’elle assiste à son mariage. Malheureusement, si la cellule familiale semble se reformer, Angélique commence à douter de sa future union avec Michel.
Pensé dès le départ comme un film réaliste, Party Girl a de quoi désarmer au premier abord. Ses acteurs, pour la plupart des novices, semblent un peu perdus au départ. Mais heureusement, ce n’est qu’une impression. La grande force de Party Girl réside dans son authenticité, qui, contrairement à celle, forcée, de La Vie d’Adèle, joue grandement pour nous rapprocher des personnages. Bien loin des standards habituels, ceux-ci appartiennent aux classes déshéritées – Michel est un mineur à la retraite, Angélique une petite danseuse de cabaret qui possède à peine de quoi se payer une chambre pour vivre... – mais pas de cliché ici, pas de caricature. Tout aussi pauvres et simples soient-ils, les réalisateurs ne les utilisent pas pour faire passer un pseudo-message politique ou social à la façon hautaine d’un Kechiche. Au contraire, le métrage se concentre sur Angélique et ses enfants, alternant entre la mélancolie qui accable cette dernière mais également la joie de retrouver enfin une famille au grand complet grâce à son futur mariage.
Filmé au plus près, mais sans abuser des gros plans et autres artifices du cinéma-vérité, Party Girl tend souvent vers le documentaire. En prenant place dans une petite ville non loin de la frontière allemande, le long-métrage bénéficie d’une saveur particulière et atypique, un peu à la façon d’un Bullhead filmé entre Wallonie et Flandres. Il en va de même pour les acteurs, qui, au-delà de posséder un accent parfois très prononcé, ne déparent jamais avec le cadre dans lequel ils évoluent. De par l’idée autobiographique de départ et son choix d’un casting amateur jouant son propre rôle, Party Girl s’attire la sympathie et l’empathie du spectateur. Criante de vérité, Angélique Litzenburger émeut avec ce personnage de vieille fille qui a fait les mauvais choix et qui continue, par désespoir, à en faire de mauvais. Sa relation avec Michel, compliquée mais aussi pathétique, touche presque autant que l’amour qu’Angélique porte à ses enfants, malgré les affres de sa vie passée. On sent, notamment lors d’une superbe scène de discours pendant le mariage, toute l’intensité et la vérité des mots prononcés par les enfants à leur mère. Là où Party Girl touche juste, c’est qu’il se concentre sur ses forces et ne cherche pas à aller plus loin, à tomber dans la revendication sociale. Il ne cherche pas à opposer deux classes de la société ni à délivrer un couplet sur un hypothétique amour impossible. Le film parle simplement d’un destin pas comme les autres, aussi tragique qu’émouvant.
Dans les pas d’Angélique, le spectateur se retrouve un peu. Paumée, prisonnière d’une vieillesse qui a fané sa beauté passée, elle tente, par désespoir, de bâtir autre chose pour la fin de ses jours. Malheureusement, on ne quitte pas le cabaret comme ça. Outre la tristesse, Party Girl dégage aussi beaucoup d’humour et file souvent de grands sourires. Par le naturel de ses acteurs, d’une part, mais aussi par cette solidarité entre filles de cabarets, à mi-chemin entre amour et haine, impeccablement retranscrite. Toutes ces habituées du monde de la nuit trouvent, en Angélique, un écho étrange. Le personnage de Michel, le vieux mineur pas méchant mais qui ne réalise pas qu’Angélique lui dit oui pour de mauvaises raisons, arrive à conjuguer le stéréotype du pauvre type et l’originalité de l’homme vraiment tombé amoureux de sa danseuse favorite. Ainsi, il n’y a pas vraiment de bons ou de mauvais personnages dans le métrage des trois compères, juste des humanités brisées et bancales, comme on en croise chaque jour sans même le savoir. Malgré le ton résolument tragique de la toute fin, Party Girl atteint ses objectifs et raconte, avec une grande sensibilité, le parcours d’une vieille femme bouffée par le cabaret qu’est devenue sa vie.
Party Girl a amplement mérité sa Caméra D’Or et le coup de projecteur que ce prix a permis sur le film de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis. Criant de vérité, touchant et drôle à la fois, Party Girl est une authentique réussite.
Note : 8.5/10
Meilleure scène : Le discours des enfants à leur mère, et notamment Cynthia. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 18 Septembre 2014 à 00:37
![[Critique] Rock-O-Rico](http://ekladata.com/7cwYr6RC06cA1foiV3BMBZc-CI8.jpg)
Après l’échec public de All dogs go to heaven, écrasé par la concurrence de La Petite Sirène, Don Bluth amorce une lente descente aux enfers. Film de la dernière chance pour ses studios d’animation, Rock-O-Rico (Rock-O-Doodle en VO) pèse lourd sur les épaules de Bluth et ses collaborateurs Gary Goldman et John Pomeroy. Avec un budget de 18 millions de dollars, un échec du métrage signifierait purement et simplement la fin de l’aventure pour les studios Bluth. En prenant le parti de revenir à une histoire plus traditionnelle tout en réemployant des techniques d’animation semblables à celles de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Rock-O-Rico n’aura pas du tout le succès escompté et viendra mettre un terme momentané à l’aventure de Bluth dans le domaine de l’animation indépendante. Retour sur un échec annoncé.
Chantecler chante tous les jours pour que le soleil se lève sur la ferme avec son fameux Rock-O-Rico. Lorsqu’un hibou appelé Le Grand Duc le provoque en duel, notre coq chanteur oublie de donner sa prestation journalière. Pourtant, à la stupeur générale, le soleil se lève quand même. Humilié, il s’exile de la ferme et le Grand Duc prend peu à peu le pouvoir sur le monde. Pendant ce temps, le jeune Edmond écoute l’histoire de Chantecler dans son lit tandis que l’orage s’abat avec fracas sur la ferme de ses parents. Pour sauver son domaine et sa famille, Edmond appelle de ses vœux Chantecler pour que le soleil se lève à nouveau et chasse la tempête. Il se retrouve alors entraîné lui-même dans le conte et devient un des personnages de son histoire favorite. A présent, il lui faut retrouver Chantecler !
Dès le départ, on sent bien que la manière de raconter de Don Bluth a changé. Et pas en bien. Porté par une voix-off lourde et dirigiste, le long-métrage ne peut pas compter sur la poésie d’un Petit Dinosaure et s’embourbe instantanément dans un registre ultra-enfantin et simpliste. Rock-O-Rico semble vouloir prendre le contrepied de Charlie, et rapidement tout échoue. D’abord à cause de son héros, Chantecler, hommage évident à Elvis, il n’atteint jamais l’originalité et la complexité des personnages précédents créés par l’américain. Semblant le comprendre, Bluth introduit Edmond, l’enfant qui sera le véritable héros du film. Pour le faire intervenir, il passe par un court instant de film live avec des acteurs très peu convaincants, et bascule dans le monde animé son protagoniste du réel d’une manière qui n’est pas sans renvoyer à L’Histoire sans Fin ou Qui veut la peau de Roger Rabbit ?. Seulement voilà, l’animation et l’incrustation sont d’une laideur incontestable. Heureusement que les passages combinant les deux s’avèrent courts, la chanson de fin est une catastrophe graphique irregardable aujourd’hui... En parlant de chanson, et puisque Chantecler est un « chanteur », c’est bien la musique qui occupe une place primordiale dans le métrage, mais elle est beaucoup, beaucoup moins convaincante que dans les précédentes œuvres de Bluth, pour ne pas dire anecdotique.
Mais le pire de tout reste l’histoire, d’une banalité affligeante, expurgée de toute complexité ou sous-texte plus adulte et/ou avant-gardiste. On se retrouve en face d’un simple récit d’aventures où Chanteclerc devra affronter le méchant (Le Hibou qui renvoie furieusement à celui de Brisby, en bien plus raté) et sauver ainsi le monde d’Edmond. Le tout véhicule des valeurs de courage et de confiance en soi des plus banales. Au fur et à mesure des péripéties, on s’aperçoit non seulement du ton très enfantin employé mais aussi du peu de passion qui ressort du film. Celui-ci aurait pu être enfantin mais dégager une poésie certaine tout en explorant des thèmes encore peu abordés – à l’image du deuil dans le Petit Dinosaure – mais on ne trouve rien de cela dans Rock-O-Rico. C’est à peine si l’on effleure le monde du star-system avec le manager ripoux de Chantecler... Là où les autres films de Don Bluth avaient des années d’avance, Rock-O-Rico a, lui, des années de retard. Moins entraînant qu’un Mary Poppins qui mélangeait aussi animation et film live, bien moins abouti et jouissif qu’un Roger Rabbit, le long-métrage n’arrive jamais à décoller, ni à nous toucher à travers ses personnages qui restent désespérément vides. Le seul instant où l’on retrouve un peu de cette folie visuelle et atmosphérique qui caractérise Bluth, c’est dans l’antre du Grand Duc avec cet orgue monumental producteur de tempête. En somme, un vrai désastre qui s’achève, en plus, sur une séquence hideuse au possible, comme déjà évoqué plus haut. Arrivé à la fin du film, on a toute les peines du monde à croire que c’est le même Bluth qui avait fait quelques années plus tôt ce petit chef-d’œuvre qu’était Charlie, mon héros.
Désastre artistique et commercial, Rock-O-Rico marque le début de la longue traversée du désert de Don Bluth. Mal pensé, peu original, techniquement à la traîne et surtout tout à fait quelconque, Rock-O-Rico est une immense déception.
Note : 3/10
Meilleure scène : Le Grand Duc et son orgue votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 12 Septembre 2014 à 18:42

Le sergent de police Ralph Sarchie a un don assez unique, celui de pressentir le « potentiel » de certaines enquêtes. Lorsqu’une femme jette son bébé dans la fosse aux lions au Zoo du Bronx et qu’un mystérieux individu encapuchonné s’enfuit des lieux de l’incident, Ralph tombe dans une spirale d’horreurs qu’il n’aurait pas soupçonnées. Confronté à ce qui semble être la possession de Jane Crenna, la mère de l’enfant en question, il trouve une aide inattendue en la personne de Mendoza, un prêtre aux manières peu usuelles et au passé trouble. Reste aux deux hommes à vaincre le mal, celui des origines, qui s’insinue lentement dans les rues de New-York, dans le sillage de trois anciens Marines...
Avec sa bande-annonce léchée, Délivre-nous du mal a de quoi appâter les fans de films d’horreur. Aux commandes, un habitué de la chose avec Scott Derrickson, un réalisateur à qui l’on doit le sympathique Sinister... ainsi que le très moyen L’Exorcisme d’Emily Rose. Pourtant, il faut bien se pencher sur son dernier film car, outre l’amour qu’il semble porter au genre horrifique, le monsieur sera bientôt à la tête du prochain opus Marvel : Docteur Strange. En attendant, il convie le trop rare Eric Bana à un petit tour dans les rues poisseuses du Bronx entre exorcisme, satanisme et autres joyeusetés démoniaques. Pas sûr que l’originalité soit au rendez-vous...
Comme tous les films d’horreurs de ces dernières années, le métrage s’ouvre sur le panneau « Inspiré de faits réels ». Bon, ça commence mal. On découvre alors rapidement une petite histoire bien effrayante qui mêle joyeusement la guerre en Irak, l’occulte et surtout l’exorcisme, un thème qui semble définitivement fasciner Derrickson. Si l’intrigue suit un cheminement plus ou moins convaincant, on s’aperçoit rapidement qu’elle accumule à peu près tous les clichés inhérents à ce type de film. D’abord, le flic intègre mais pas trop, qui aime à son temps perdu tabasser du pédophile – ce qui est bon pour la santé à croire -, ensuite le prêtre très très mystérieux qui fait aussi prêtre que Luc Besson fait réalisateur, et surtout les méchants démons forcément à comploter pour envahir la terre de partout. Alors heureusement, avec tous ces clichés, Derrickson bricole tout de même un scénario assez prenant et arrive facilement à susciter l’intérêt grâce à une réalisation correcte et quelques moments bien flippants. Mais voilà, l’esthétisme ne suffit pas.
Le souci majeur de Délivre-nous du mal c’est qu’il n’y a qu’Eric Bana d’intéressant. Et encore... Son personnage enquille aussi joyeusement les clichés comme on l’a déjà dit. Les retournements de situation se prévoient à dix kilomètres – « Tiens, le prête et le sergent font équipe ? Bon ben on va pouvoir buter l’ancien coéquipier »... ou encore « Oh, mais il a une fille et une femme le héros ! Allez, on va les kidnapper/torturer/violer » (rayez la mention inutile) et pire encore, des incohérences et invraisemblances crèvent l’écran au fur et à mesure de l’avancée de l’intrigue. Au premier rang de celles-ci, on trouve le fameux syndrome Dracula du film d’horreur : tout, ou presque, se passe de nuit. A croire que dans cette partie des Etats-Unis, on a opté pour le 20h de nuit, 4h de jour. C’est plus utile pour les forces démoniaques, c’est bien connu. Le meilleur exemple de ce syndrome : le sergent qui prend une affaire de sous-sol louche à aller inspecter – oui, ça part déjà mal – avec lorsqu’il sort un grand soleil. Coupure... et arrivée à la maison en question en pleine nuit et en pleine tempête – oui parce que le film se passe aussi pendant la moitié du temps sous la pluie. Soit c’était très, mais alors très très loin, soit la nuit tombe avec une vitesse insoupçonnée dans le Bronx. Ce genre de détail, qui semble infime comme ça, décrédibilise tout le film. Sans parler du méchant qui copie totalement le look de celui de Blade II pendant les trois quarts du métrage.
De même, dès le départ, on sent que la famille de Ralph sera un des enjeux finaux et on est obligé de se farcir une bonne vieille intrigue parallèle à base de « T’es pas assez à la maison », « Mais non je t’aime », « Ta fille a besoin de toi », « Et moi, j’ai besoin d’une pute » (enfin dans les grandes lignes quoi). Non seulement on se fout de la chose mais en plus on sent que tout est artificiellement gonflé. Là où la famille de Sinister se justifiait totalement (c’est même le cœur du film), celle de Délivre-Nous du Mal fait pièce rapportée. On passera rapidement également sur cette idée monstrueusement débile d’inclure une chanson des Doors (mais vraiment l’idée la plus débile du siècle) pour terminer sur le morceau de bravoure du film, l’exorcisme. Plutôt bien filmé, tendu et assez effrayant, c’est un des seuls bons éléments qui sauvent le long-métrage (en faisant abstraction de The Doors... encore). Cependant, arrivé à la conclusion bien, mais alors bien bien bien puritaine, on a un sentiment très étrange et extrêmement dérangeant : avoir assisté à un spot publicitaire de deux heures sur la religion catholique style « Devenez exorciste, on a des enfa...euh des cookies ! ». Un coup à rendre le film nauséabond, et pas qu’un peu.
Délivre-Nous du mal est une mauvaise surprise. Même si on le prend comme un film d’horreur de série B, même si Eric Bana porte tout le film sur ses épaules et même si l’ambiance reste assez soignée, il y a bien quelque chose de dérangeant dans le message du film et dans le nombre de clichés qu’il régurgite à longueur de temps. Une grosse déception qui incite surtout à se contenter de la vision de Sinister, autrement plus sympathique. Du coup, pour Docteur Strange, on peut légitimement s’inquiéter...
Note : 4/10
Meilleure scène : L’exorcisme finalSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 11 Septembre 2014 à 23:36
![[Critique] Enemy](http://ekladata.com/p3mKJ5ubiEWG6aD4XHsEu5YBSuE.jpg)
En l’espace de deux films, le canadien Denis Villeneuve s’est fait un nom. Avec Incendies d’abord, film choc bouleversant et renversant qui doit beaucoup à l’écrivain Wajdi Mouawad, et Prisoners ensuite, plongée rude et noire dans les méandres de la vengeance d’un père esseulé. Cette fois, pour son troisième long-métrage, il choisit d’explorer le drame psychologique avec un acteur qu’il affectionne particulièrement : Jake Gyllenhaal. Basé sur la nouvelle de José Saramago, L’autre comme moi, Enemy tombe pile-poil après la sortie de The Double, autre film sur le thème du double. Cette coïncidence n’empêche pourtant pas le métrage de Villeneuve d’adopter une voix plus singulière et d’emprunter cette fois purement au genre dramatique. Enemy sera-t-il le film de la consécration pour Villeneuve ?
Adam est un professeur d’université. Plutôt du genre effacé, il mène une vie tout à fait ordinaire avec Mary, sa femme. Tout bascule le jour où il visionne un film et découvre l’existence d’un acteur qui lui ressemble trait pour trait. Troublé dans un premier temps, il se met à rechercher après cet Anthony Saint-Claire. Sans pouvoir l’expliquer lui-même, Adam devient complètement obsédé par Anthony et tente de le rencontrer. Il ne s’imagine pas que sa curiosité va venir mettre en danger son couple et sa petite vie paisible.
Deux semaines après la sortie en salle de The Double, l’arrivée de Enemy a de quoi étonner. Pourtant, là où l’on aurait pu redouter la redite, Villeneuve se concentre essentiellement sur l’aspect psychologique de cette brutale confrontation à un « autre soi ». A l’instar d’Eisenberg, Jake Gyllenhaal incarne à la fois Adam et Anthony et livre une remarquable prestation. On retrouve encore une fois deux hommes aux personnalités totalement opposées, l’un introverti et effacé, l’autre exubérant et charmeur. Au lieu de jouer sur la peur du remplacement comme l’a fait Ayoade, Villeneuve tente de raconter une autre facette de cette troublante découverte. Celle de la dualité. Tout du long, le réalisateur n’a de cesse de confronter ses deux protagonistes et de montrer la peur irrationnelle que l’un éprouve par rapport à l’autre. Pourtant pas de prise de pouvoir au niveau professionnel mais seulement un trouble profondément enraciné à l’encontre de ce qui apparaît comme un paradoxe, une anomalie. Adam est terrifié de retrouver Anthony et, pendant longtemps, difficile de dire exactement pourquoi. Villeneuve joue avec le spectateur, joue avec son trio d’acteurs – Mélanie Laurent, Jake Gyllenhaal et Sarah Gadon – pour accoucher d’un imbroglio amoureux aussi dangereux que fascinant.
La caméra de Villeneuve reste toujours aussi acérée, sa mise en scène soignée et sa façon de capturer ses personnages formidable. Malgré des filtres jaunâtres qui deviennent rapidement rédhibitoires, le réalisateur crée une atmosphère pesante et sinistre. Surtout, il installe un symbolisme venimeux grâce à cette figure de la mygale, que ce soit à travers des visions directes de l’araignée ou des cauchemars réellement dérangeants. Le souci, c’est qu’à trop vouloir pénétrer dans le monde du psychisme et de ne donner quasi aucune clé au spectateur, on se trouve rapidement perdu dans le récit qu’il nous livre. En effet, on se doute que les deux couples profitent d’une certaine symétrie et que l’araignée représente la figure féminine mais l’on a un mal fou à comprendre là où veut en venir Villeneuve. Si après coup on pourra comprendre lentement et âprement les choses, on se rend surtout compte que le canadien pêche par excès et tombe dans un certain hermétisme totalement absent de ses précédents films. Pour peu, on tomberait presque dans du Cronenberg style Spider (comme quoi), et sur un sujet assez accessible – le combat entre deux versants d’une même personnalité –, Enemy devient presque élitiste dans son abord.
Pour autant, Enemy est loin d’être un mauvais film, ses acteurs sont tous géniaux et Villeneuve profite de certaines scènes carrément formidables. De la femme à tête de mygale marchant dans un couloir vide à la rencontre dans la chambre d’hôtel miteuse en passant par l’échange entre Adam et Anthony, il y a vraiment des choses enthousiasmantes. Il faut d’ailleurs insister sur le fait que Sarah Gadon se révèle exceptionnelle dans le long-métrage. Certes Gyllenhaal domine le film, mais le jeu subtil et précis de Gadon, notamment lorsqu’elle se retrouve avec Adam, fait de sacrées merveilles. En somme, on assiste à un show d’acteurs réellement excitant avec une atmosphère envoûtante, mais sur une trame encore plus obscure que celle de The Double (c’est dire !). C’est tellement dommage de compliquer ainsi les choses alors qu’Enemy avait un incroyable potentiel.
Déception relative, Enemy ne se hisse pas aux niveaux de ses illustres prédécesseurs. Denis Villeneuve complexifie trop son histoire et s’enferme dans un hermétisme qui ne plaira qu’à un public très restreint. Reste un film intriguant et oppressant pour les amateurs du genre casse-tête psychologique.
Note : 7.5/10
Meilleure scène : Helen et Adam dans la chambre conjugale 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Nicolas Winter le 11 Septembre 2014 à 15:58
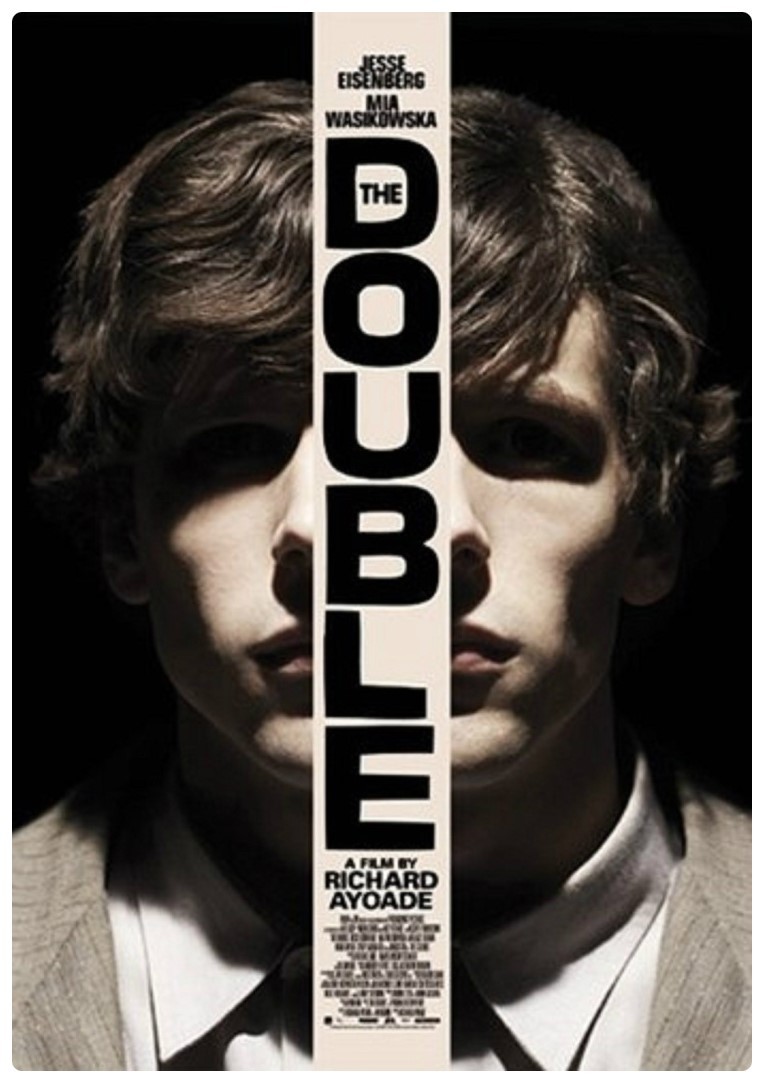
Bien plus connu pour son rôle de Moss dans la série IT Crowd, Richard Ayoade est également réalisateur. Après Submarine en 2010, l’anglais récidive avec un film aussi inattendu qu’étrange : The Double. Inspiré du roman de Fiodor Dostoïevski, Le Double, le long-métrage mise sur l’humour britannique et deux acteurs reconnus : Mia Wasikowska et Jesse Eisenberg. Par un hasard du calendrier, le film se retrouve presque côte à côte avec un récit profitant du même postulat : Enemy de Dennis Villeneuve. Pourtant, loin de faire dans la redite, les deux histoires envisagent le problème du double par un traitement bien différent. The Double choisit ainsi un ton plus comique mais aussi, plus mystérieux.
Simon travaille dans une grande entreprise. Timide et plutôt renfermé, il en pince pour Hannah du service photocopie. Malheureusement, celle-ci ne partage pas du tout ses attirances. Alors qu’il met consciencieusement au point un projet capable d’améliorer le rendement de sa firme et donc de s’attirer les bonnes grâces de son patron, le « colonel », Simon voit débarquer un nouvel employé. Energique, sûr de lui, rusé et charmeur, ce nouveau collègue, James, va aider Simon à sortir de son anonymat. Pourtant, Simon est troublé...car James a une particularité : il lui ressemble trait pour trait. Lorsqu’il tente d’usurper sa vie, les choses tournent mal.
The Double est un film atypique. Il se construit autour de la personnalité effacée de Simon, incarné par un brillant Jesse Eisenberg. Presque un anti-héros, Simon vit dans un quasi-anonymat, ignoré par le vigile alors qu’il se présente tous les jours, à peine remarqué par son chef de service et pire, royalement ignoré par celle qu’il aime en secret, Hannah. Attachant par sa fragilité et sa balourdise, Simon n’est pourtant pas l’élément le plus frappant du long-métrage. Là où l’on s’attendait à quelque chose d’assez conventionnel, Ayoade imagine un univers très noir et désespérant, sorte de dystopie étouffante où les barres d’immeubles embrumées cachent des suicidaires en puissance, et où les entreprises ressemblent bien plus à des mini-dictatures qu’autre chose. Très sombre, le film du britannique convoque un peu du Brazil de Terry Gilliam avec lequel il partage l’amour pour des technologiques de pointe faites de bric et de broc, et surtout une description très brumeuse de l’entreprise dite moderne. On ne sait jamais réellement le but de l’employeur de Simon, ni même avec précision à quoi il sert dans l’entreprise. Cet épais voile de mystère qui enrobe l’ensemble du long-métrage donne une tonalité inquiétante et déroutante au récit, et si l’humour tranche à certaines occasions, il reste moins marqué que dans Brazil, créant ainsi une ambiance plus oppressante encore.Au-delà de ce simple aspect « background », extrêmement enthousiasmant au demeurant, The Double voit l’affrontement de deux « individualités » : celles de James et de Simon. James incarne tout ce que Simon n’est pas, et s’il nous parait immédiatement sympathique, c’est pour mieux mettre en abyme l’effet premier qu’il produit sur Simon et ses collègues de travail. Ayoade démontre que ce n’est pas l’apparence qui compte mais purement et simplement le magnétisme, le charisme d’une personne. Pourtant physiquement identiques, les deux hommes n’ont rien en commun au niveau de la personnalité – ce qui est impeccablement rendu par Eisenberg. Le réalisateur britannique souligne ici l’importance de la communication et du langage corporel. Plus loin, et plus sournoisement, il joue avec le spectateur et l’embrouille sur la nature de James : Est-il un double imaginé par Simon ? Est-il un véritable personnage lié par un quelconque lien fantastique à Simon ? Ayoade ne tranche jamais et nous laisse décider, préservant cette ambiance surnaturelle qu’il a mis tant de temps à installer. En assumant son parti-pris jusqu’au bout, on peut dire que le britannique réussit son pari de l’étrangeté.
Outre la dystopie, ce qui captive également dans The Double, c’est la capacité d’Ayoade à glisser lentement dans un vrai cauchemar pour son personnage principal et de jouer sur une peur commune à tous : celle du remplacement, et notamment en amour. Mia Wasikowska incarne une Hannah crédible, jeune femme évanescente tantôt suicidaire tantôt rêveuse. Son interaction avec James permet de confronter le spectateur à une peur primale, celle de se voir supplanter par un individu meilleur mais qui, paradoxalement, nous ressemble énormément. Une peur toute schizophrénique mais qui culmine pourtant avec la scène du restaurant, glacialement géniale. Rapidement, le remplacement ne se limite plus à l’espace amoureux mais aussi au versant professionnel pour finir par l’aspect le plus dérangeant, le microcosme personnel. En fin de compte, James supplante Simon, même aux yeux de sa grand-mère. Ayoade marie avec un talent évident le registre comique avec l’angoisse latente de son histoire. Il en résulte une intrigue certes brumeuse, mais véritablement originale et percutante.
Sorte de fils bâtard de Brazil, The Double constitue une très bonne surprise qui aborde de façon inattendue la thématique du double grâce à son univers dystopique dérangeant et au talent insolent de Jesse Eisenberg.
Une curiosité à découvrir.
Note : 8/10
Meilleure scène : Le restaurant avec Hannah votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 9 Septembre 2014 à 00:04


Arnaud et Victor viennent de perdre leur père et se voient dans l’obligation de reprendre l’entreprise familiale. Chez un de leurs clients, ils font la connaissance de Madeleine, une jeune fille au caractère bien trempé et qui n’a qu’une obsession : intégrer un corps d’élite de l’armée française. Pour se faire, elle décide de tenter un stage de formation militaire de 15 jours chez les Dragons. Fasciné par le magnétisme sauvage de la jeune fille, Arnaud décide de la suivre. Il va alors découvrir une adolescente pas comme les autres et vivre une expérience unique loin de tout ce qu’il avait pu imaginer.
Présenté au Festival de Cannes 2014 dans la Quinzaine des Réalisateurs, Les Combattants est un premier film français de Thomas Cailley, qui n’avait jusque-là œuvré que sur des courts-métrages. Il choisit d’aborder l’amour, l’adolescence et le dépassement de soi d’une façon originale et fraiche, tout en donnant les rôles principaux à de jeunes acteurs pas forcément très connus. Précédé par un buzz très positif et mis en valeur par une bande-annonce des plus accrocheuses, Les Combattants rassemble tous les ingrédients pour appâter le spectateur en quête d’inattendu.
Les Combattants est, avant toute chose, un film drôle. Mais heureusement pas comme une comédie lambda à la française, où l’on cherche désespérément à nous faire rire toutes les cinq minutes avec des gags vaseux. Thomas Cailley fait preuve d’un humour tantôt subtil tantôt caustique avec le portrait de Madeleine, une adolescente totalement hors-norme, avec un répondant hallucinant et incarnée à la perfection par la jeune Adèle Haenel, véritable révélation du long-métrage. Ce personnage au caractère bien trempé et bien barré sert de pivot au récit de Cailley, qui arrive à nous attacher à ses deux principaux protagonistes avec une rapidité étonnante. Car de l’autre côté, Arnaud, même s’il reste plus conventionnel, est un jeune homme attendrissant et drôle. Le contraste entre la rudesse et l’énergie de Madeleine d’une part, et le flegme d’Arnaud d’autre part, crée non seulement un décalage comique, mais donne une dimension humaine et crédible à ce couple improbable.
On peut, il est vrai, prendre Les Combattants comme un film d’amour. Mais dans ce cas, c’est un des films d’amour français les plus atypiques depuis un sacré bout de temps, non seulement pour les deux « tourtereaux » mais également pour leur parcours dans le film. Tomber amoureux pendant un stage militaire n’est pas donné à tout le monde. En refusant de céder aux clichés habituels, Cailley offre une vision plus authentique et terriblement touchante au fond. Il se permet même, en jouant avec cette séquence d’incendie et l’obsession d’apocalypse de Madeleine, de donner un côté prince charmant moderne à Arnaud, sans pour autant briser le féminisme revendiqué de Madeleine. De même, jamais le réalisateur ne juge la jeune femme ou le jeune homme, il se contente de nous confier cette tâche avec une simplicité désarmante. Entre les entraînements de Madeleine et le monde militaire, impossible de ne pas adhérer au délire de ces deux doux-dingues.
En prime, le long-métrage prend un malin plaisir à se moquer rudement du monde militaire français. Encore une fois, Cailley n’est pas frontal, il trouve même des qualités à cet environnement – l’esprit d’équipe par exemple – mais se paye rapidement la tête de cette armée loin des mythes qu’elle entretient, où l’on mange frites et flamby au calme, au grand dam de Madeleine. De même, le réalisateur français apporte son modeste petit message, sur le refus d’être le mouton bêlant qui suit le troupeau – la séquence cultissime de la grenade – et finit par une tranche de vraie survie qui, même si elle tourne court, célèbre le dépassement de soi et l’envie d’aller là où les autres ne vont pas, en passant outre les préjugés et les critiques. Pas si mal pour un premier film !
Grâce à son authenticité savoureuse, à son humour savamment dosé et à ses deux acteurs géniaux, Les Combattants décroche la palme du film sympathique qui va au-delà des espérances.
Un vrai moment de bonheur à consommer sans modération.
Note : 8/10
Meilleure réplique : « C’est courageux, moi je l’aurais pas fait »
Meilleures scènes : Le grenade dans le réfectoire – L’incendie – le final votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 7 Septembre 2014 à 14:32
C'est le retour du court-métrage avec Tears of Steel, une histoire de SF entre poésie et comédie...et avec un acteur que les fans de Poltergeist (la série) auront plaisir à retrouver !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 4 Septembre 2014 à 17:50

Premier « vrai » film de Jake Paltrow – le frère de Gwyneth – Young Ones se risque au pari de la SF. Jusqu’ici, Paltrow n’avait réalisé que des épisodes de séries et un obscur petit film, The Good Night. Avec Young Ones, il rassemble une superbe galerie d’acteurs – Michael Shannon, Elle Fanning, Kodi Smith-McPhee et Nicholas Hoult – pour livrer une histoire post-apocalyptique aux prétentions modestes. Sans grande débauche d’effets spéciaux ou bataille tonitruante, le jeune réalisateur arrive pourtant à tirer son épingle du jeu avec ce long-métrage qui constitue en réalité une bonne petite surprise.
Dans un futur relativement proche, la sécheresse s’est abattue sur le monde et l’eau est devenue le principal enjeu pour la survie des hommes. Ernest Holm, le patriarche de la famille Holm, défend jalousement son puit et sa terre tout en commerçant avec les équipes ouvrières forant les montagnes à la recherche d’eau. Ses deux enfants, Mary et Jérôme, vivent dans l’ombre imposante de leur père dont le penchant prononcé pour l’alcool a causé la paralysie de sa femme, Katherine, désormais à l’hôpital. L’arrivée du jeune Flem Lever, le fier et rusé fils de leur voisin, va bouleverser la cellule familiale. Le jeune Jérôme devra bientôt décider comment défendre l’honneur des siens.
Pas forcément très attendu – même carrément pas – Young Ones réserve son lot de (bonnes) surprises. Son univers, à la fois aride et très sobre, arrive à conjuguer un budget que l’on devine restreint, avec une histoire assez classique de vengeance mais suffisamment bien incarnée pour atteindre ses objectifs. Le monde de la famille Holm renvoie à nombre de récits post-apocalyptiques de SF mais a le très bon goût de ne pas en faire le pivot central du film. Paltrow sait qu’il n’invente rien et se sert au contraire du background pour ajouter une originalité à la structure de son intrigue. L’exemple du robot de chargement, une idée toute simple mais géniale, est un peu l’archétype de ce que tente le réalisateur : se servir de quelques éléments science-fictifs pour faire avancer son récit. Il en va de même pour cette histoire de sécheresse qui sert à justifier le ressentiment de Flem et toutes les histoires de convoyages (et de frontière sécurisée). Young Ones relève au final d’une SF « light » certes, mais une SF de qualité quand même.
Le vrai cœur du film se situe dans le personnage de Jérôme, incarné par un Kodi Smith-McPhee bien plus impressionnant que dans son « non-rôle » de la Planète des Singes. Paltrow expose avec celui-ci la passation de pouvoir entre un père et un fils et de quelle manière l’influence paternelle peut se faire ressentir bien des années plus tard. A ce petit jeu, Michael Shannon livre une nouvelle magnifique prestation avec ce personnage torturé d’Ernest Holm. Son interaction avec sa famille, et surtout avec Jérôme, fournit le principal point d’intéressement du récit. Seule Mary semble en retrait dans ce portrait, écrasée par la présence de Flem, porté, il faut dire, par un très bon Nicholas Hoult. Tout le propos de Young Ones tient dans l’héritage et dans une passation de flambeau générationnelle aussi rude que juste. Malgré une vengeance somme toute assez conventionnelle, le récit arrive à ferrer son spectateur grâce aux interactions de ses personnages et au bâti dramatique de l’histoire.
Malheureusement, comme nombre de premiers films, Young Ones est également un film imparfait. La faute à une réalisation encore très maladroite où Paltrow abuse très largement des fondus – quasiment toutes les transitions du film – et lasse terriblement le spectateur qui frôle l’overdose de cet artifice bien pataud. De même, le réalisateur américain divise artificiellement son film en trois chapitres, sans aucune véritable raison autre qu’un didactisme exacerbé qui ne sert jamais l’histoire, au contraire même puisque le nom de chaque partie a tendance à spoiler la suite... C’est d’autant plus dommage que ces défauts viennent plomber une mise en scène assez bonne, qui sait économiser ses moyens pour ne pas tomber dans le piège de la surenchère sur un film qui n’en aurait pas les capacités.
En profitant d’un background SF soigné et discret, Young Ones construit une intrigue efficace magnifiée par des acteurs excellents. Pas forcément mémorable, le premier long-métrage de Jake Paltrow mérite pourtant votre attention, ne serait-ce que pour apprécier un sympathique film de science-fiction par ces temps de surenchère visuelle.
Note : 7.5/10
Meilleure scène : La mise à mort de l’âne.
Meilleur réplique : « J’aurais pu le faire » « Je sais fils » 5 commentaires
5 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 28 Août 2014 à 23:38

La grande interrogation d’un critique devant un film qui n’a même pas le début d’une poussière d’intérêt, c’est de se demander qu’en dire ? Pour être tout à fait honnête, Black Storm entre directement dans cette catégorie, mais pas par la petite porte. Non, par la grande porte. L’époque des films catastrophe est passée de mode (2012 commence à dater) et surtout à peu près tout a été dit sur le sujet. On a eu droit à du volcan dans Volcano ou le Pic de Dante, à du réchauffement climatique global avec Le Jour d’Après, à de la totale fin du monde avec 2012 et à l’annihilation de l’intelligence humaine avec Twilight (qui a aussi tué le mythe du vampire, c’est dire la catastrophe). Alors lorsqu’il s’agit de se tourner vers un dernier type de calamité naturelle, Steven Quale porte son attention sur les tornades, oubliant à moitié que Twister avait réalisé une sympathique synthèse sur le sujet (en même temps, on ne va pas faire 3 heures sur les tornades non plus). De cet opportunisme est né Into the Storm (rebaptisé en France Black Storm, parce que tout le monde sait que le noir, ça fait peur).
Dans Black Storm, Quale nous fait découvrir les tornades en compagnie de plusieurs groupes de personnages tous plus cons les uns que les autres. D’abord, la traditionnelle cellule familiale avec ici Donnie et Trey Morris, ainsi que leur père Gary, également adjoint au proviseur du lycée de ses fils. Pas de mère dans le tas, parce qu’il faut bien un petit trauma au gamin-star Donnie pour s’envoyer en l’air avec la fille canon de service Kaitlyn. De l’autre côté, il y a aussi une équipe de chasseurs de tornades menée par Pete – quelle originalité, on y aurait jamais pensé – qui, outre de se trimbaler avec un super véhicule blindé tout-terrain de la mort qui tue, adorent jouer les kamikazes en pleine tempête. Enfin, et c’est un peu le gros WTF du film, il y a deux débiles qui font des vidéos de cascades pour mettre sur Youtube. L’intrigue se pose rapidement. En gros, c’est la remise des diplômes, on annonce un orage mais le directeur du lycée lui, il n’en a rien à cirer de ses élèves et maintient la cérémonie, où se retrouvent Donnie et Trey, ainsi que Gary. Bien sûr, ça tourne au vinaigre et ils croisent l’équipe de chasseurs de tornades qui les aide à retrouver Donnie et Kaitlyn qui sont partis roucouler dans une usine abandonnée entre temps (logique, on fait tous ça).
Avec un tel scénario de base et des personnages si « originaux », on se doute bien que ce n’est pas de ce côté qu’on va trouver du bon. Chaque protagoniste fait exactement ce qu’on attend de lui dans ce type de film, c’est-à-dire être con. Pas la peine non plus de chercher une once d’épaisseur psychologique dans ceux-ci, parce qu’il sont tous des stéréotypes ambulants. Du scientifique obsédé par son travail et qui s’en fout des autres... mais qui devient un héros à la fin, au père de famille chiant mais héroïque quand même, en passant par la gourdasse de base qui passe son temps à être secourue. Oui, on est bien gâté. Le pire reste pourtant à venir. Non content d’avoir des personnages jetables dont on se cogne totalement (mais vraiment, à un moment on prie pour qu’ils passent à la moissonneuse-batteuse, hypothèse peu probable mais quand même jouissive), Black Storm nous rejoue le couplet des valeurs familiales traditionnelles puissance 10 avec une pseudo-idée très mais alors très mauvaise : la capsule temporelle. Les gosses ont eu la grande idée de se filmer caméra au poing pour se revoir dans le futur. Ce qui occasionne des séquences shaky-cam non seulement insupportables mais qui véhiculent aussi de la bonne grosse morale à l’américaine comme on ne pensait plus jamais en avoir. Il faut le voir pour le croire. C’est terrible (et ça laisse des séquelles).
Mais dans ce genre de film, ce n’est pas le fond que l’on cherche – heureusement. Ce sont les effets spéciaux et le grand spectacle. Là encore, Black Storm a de quoi laisser perplexe. Sans moyen ou presque, le métrage arbore des FX consternants. Il emploie plusieurs moyens pour cacher sa pauvreté : le plan serré avec un petit bout de tempête, le flou artistique bien conséquent pour masquer les détails, ou encore quelques effets clinquants pour attirer l’attention. En gros, même sur ce qui devrait être son point fort, le film se ramasse totalement. Pour dire, ses images sont nettement moins impressionnantes que celles de Twister qui a pourtant plus de 15 ans... Le constat est d’autant plus amer pour le spectateur que le tout se termine par une séquence absurde au possible dans un égout en construction, et où la cohérence s’envole bien avant les personnages...
Pas la peine de parler du reste, Black Storm est une honte, pure et simple. Steven Quale n’avait réalisé jusqu’ici que le 5ème volet des Destination Finale, et on lui serait reconnaissant qu’il prenne sa retraite rapidement. Une bouse, une vraie.
Note : 0/10
Meilleure séquence : Quand ils récupèrent Kaitlyn et Donnie... Le T-Shirt mouillé de la fille est le seul FX réussi du film. 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 24 Août 2014 à 16:15
Cette semaine, une petite perle venu d'Espagne, récompensée à SITGES, où un homme dépressif se métamorphose en éléphant.
Non sans rappeler Kafka et sa Métamorphose, le court-métrage de Pablo Larcuen oscille entre mélancolie et absurde. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 21 Août 2014 à 00:47

Gretta vient de se faire larguer par son petit ami chanteur. Dan vient de perdre sa place dans sa propre maison de production de musique. Par un coup du sort, les destins de ces deux âmes en peine vont se rencontrer dans un petit cabaret un soir à Brooklyn. Immédiatement charmé par la voix de Gretta, Dan va lui proposer de devenir son producteur et de la propulser sur le devant de la scène. Et ce n’est pas le refus de son ex-boîte de les financer qui va les arrêter, car, sur un coup de tête, ils décident d’enregistrer eux-mêmes les chansons aux quatre coins de la ville de New-York. Plus qu’une virée entre musiciens et chanteurs, la ballade de Gretta et Dan va aussi ouvrir des chapitres douloureux de leur passé.
Chaque été, ou presque, a droit à son feel-good movie. De qualité souvent inégale, ce genre de long-métrage trouve un nouveau représentant avec Begin Again (aka New York Melody). Réalisé par John Carney, un habitué de la chose, le film fait pourtant un peu peur par son côté « romance new-yorkaise » annoncé. On y retrouve deux acteurs excellents mais également un peu en retrait actuellement : Mark Ruffalo et Keira Knightley. Misant quasiment tout sur sa bande-annonce et son « couple » de stars, New York Melody a pourtant quelques sérieux atouts à faire valoir.
A commencer justement par la ville où il situe son action. Carney aime New-York et sait la filmer comme il se doit et en saisir quelques plans magnifiques. L’atmosphère qu’il en retire donne tout son charme au métrage, d’un cabaret obscur à un toit d'immeuble au pied de l’Empire State Building. Mais ce décor sert avant tout à supporter ses deux formidables acteurs. Mark Ruffalo en vieux divorcé blasé mais attachant, jamais plus à l’aise que dans un rôle dans lequel on ne l’attend pas. Il est merveilleux. Et puis Keira Knightley, plus proche du registre de Never Let Me Go que d’A Dangerous Method, parfaitement à l’aise pour jouer une petite anglaise à la voix d’or et au cœur plein d’espoir et de mélancolie. Plus surprenant, l’alchimie entre les deux fonctionne à plein tube, on y croit dès la première minute et la chose ne se démentira jamais.
Heureusement, et contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, Carney évite le piège de la romance. Il bâtit son récit d’abord en deux temps avec l'histoire de Dan puis celle de Gretta, avant de nouer les deux fils et de broder autour. Au lieu de les faire tomber amoureux l’un de l’autre comme un tas de métrages vus et revus, le réalisateur explore la voie de l’amitié, autrement plus salutaire pour ces deux-là et qui permet de faire vivre les personnages secondaires tels que Miriam et Violet ou encore Dave. Ceux-là trouvent naturellement leur place, nullement étouffés par l’histoire des deux protagonistes principaux. Alors, bien sûr, on n’évite pas une intrigue amoureuse un peu chiante avec le retour de Dave. Mais encore une fois, Carney arrive à bien faire passer ce revirement et à s'en servir pour enrichir le personnage de Gretta au lieu de le dégrader. La meilleure partie finalement revient à Mark Ruffalo et l’aspect familial, tendre et joliment abordé, sans jamais trop surligner les choses.
Reste alors la musique, et l’évident message de Carney. New York Melody s’emploie à retrouver le bonheur d’artistes « authentiques », et rejette en bloc le travail dénaturant et prémâché des grandes boîtes de prod’. Exit les chanteurs issus du même moule, le métrage nous présente une musique plus authentique et sensible (avec la belle voix de Knightley en prime) tout en revenant à la base de l’art musical : la passion. Dans le fond, c’est ça que cherche à transmettre New York Melody, une passion dévorante pour la belle musique, celle qui vient de la rue, du cœur et non celle des usines à hits. La BO, magnifique, achève de convaincre du bien-fondé de l’entreprise en enrobant le métrage dans un voile mélodieux et entêtant.
Ce New York Melody se révèle surprenant. Touchant, simple, emporté par deux acteurs sublimes et se jouant des clichés de la comédie romantique, le long-métrage de John Carney fait du bien aux yeux comme aux oreilles.
Note : 8/10
Meilleure scène : La discussion entre Gretta et Dan sur ce qu’apporte la musique au quotidien. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 19 Août 2014 à 20:37

L’indien Pan Nalin nous propose cette année un nouveau documentaire après Ayurveda. Cette fois, il nous emmène sur les rives du Gange, à sa confluence avec 2 autres fleuves sacrés. Tous les 12 ans, le plus grand pèlerinage du monde s’y déroule avec près de 100 millions d’Indiens qui viennent s’immerger dans les eaux du fleuve divin. Nalin choisit de prendre sa caméra pour y participer et rapporter les images à son père. Il ne se contente pourtant pas de filmer les festivités mais va également suivre quelques destins hors du commun dans ce rassemblement extraordinaire et unique au monde où fidèles, gens du peuple, sâdhus et yogis se croisent. Kumbh Mela, Sur les rives du fleuve sacré est une invitation au voyage en même temps qu’une extraordinaire peinture humaine.
Pour nous immerger dans ce pèlerinage au bord du Gange, Pan Nalin laisse vagabonder sa caméra d’un bout à l’autre de la manifestation. Ses images, formidables, capturent la grandeur et la démesure incroyable de Evènement, et s’arrêtent sur des visages, des hommes noyés dans la multitude. Chaque regard trouve un écho dans le cœur du spectateur et au-delà de ce fourmillement de vies et de destins, Nalin nous dévoile une humanité foisonnante. On s’étonne devant les défilés de sâdhus, ces sortes d’ermites vénérés comme des saints par les Indiens, ou devant cette dévotion quasi-unique au monde. Plus encore, ce sont les images nocturnes où le flamboiement des campements et des défilés dessine une constellation incongrue, spectacle fugace d’une humanité qui brûle de mille feux dans la foi. Celle-ci rejaillit sur tout mais s’avère d’une grande bonté et d’une grande tendresse, Kumbh Mela montre le meilleur de l’homme. Et parfois le pire. Nalin ne se fixe pas de limite claire, il se contente de nous faire partager son ébahissement que l’on devine intense.
Les images qu’il nous rapporte, Nalin prend bien soin de les monter et de leur donner un sens. Un sâdhu qui semble courir sur l’eau, des hommes et femmes disparus réduit à l’état de bouts de papier dans un panier... Tout trouve un sens, sans forcément décrire, sans presque jamais intervenir. Des mots, il y en a pourtant dans Kumbh Mela. Le réalisateur indien donne voix à plusieurs destins : celui de parents dont l’enfant s’est perdu dans la masse confuse qui gravite autour du fleuve et qui tentent désespérément de le retrouver, celui d’un jeune gosse fugueur qui rêve de devenir soit un parrain soit un sâdhu, ou encore celui de Yogi Baba et de Bajrangi, l’enfant perdu. Ces trois fils s’entrelacent et se croisent, Nalin les laisse s’exprimer, les laisse, mine de rien, inclure leurs petites histoires dans la grande.
Chacun des protagonistes que l’on rencontre apporte sa pierre à l’édifice bâti patiemment par Nalin si bien qu’à la fin, l’ensemble des mots et des voix qui s’élèvent forme un hymne à la vie et à l’humanité vibrant d’authenticité. C’est cela qui touche le plus dans Kumbh Mela, ce sentiment de s’introduire dans un autre monde et dans d’autres existences, fascinantes et intrigantes. C’est le discours touchant de Baba Yogi qui a découvert l’amour paternel en recueillant un fils qui n’est pas le sien. Ou les bravades du jeune fugueur envers les policiers entourant les campements. Ou cet ardent courage de parents affolés. Le Gange en arrière-fond, le réalisateur indien nous inonde mais pas avec l’eau sacrée, mais bien la vie sacrée, celle des habitants, extraordinaires ou ordinaires, qui traversent son documentaire. Le résultat est beau à en tomber, touchant et d’une force hors du commun.
Document exceptionnel sur un événement qui ne l’est pas moins, Kumbh Mela, Sur les rives du fleuve sacré flirte avec la foi, l’humain et le divin. Il démontre qu’avec du talent, de la sincérité et surtout des idées, on peut faire bien plus marquant que n’importe quel blockbuster. Pan Nalin parle avec amour d’une Inde qui vous fascinera à coup sûr, et vous emmène à la rencontre d’hommes et de femmes que vous n’êtes pas près d’oublier.
Note : 9/10
Meilleures scènes : Toutes les séquences de Baba Yogi avec Bajrangi.
Meilleure réplique : Tous ces drames pour une bouteille d'eau votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 17 Août 2014 à 16:47

En 2011, La Planète des singes : Les Origines permettait à une des sagas les plus mythiques de la SF moderne de revenir sur le devant de la scène. Rupert Wyatt prenait le parti non pas de calquer son intrigue sur le film originel de Schaffner - comme l’avait lamentablement tenté Tim Burton – mais de revenir aux sources en nous expliquant comment tout avait démarré. Excellente surprise, le long-métrage introduisait César, le leader des singes, grâce à des effets spéciaux made in Weta Workshop des plus impressionnants. Près de 3 ans après ce premier succès et malgré le départ de James Franco et du réalisateur, une nouvelle suite a vu le jour sous le nom de Dawn of the Planet of the Apes (toujours bêtement traduit en France par La Planète des singes : L’affrontement). Cette fois, c’est Matt Reeves, le papa de Cloverfield, qui reprend le flambeau et tente de nous raconter la confrontation entre l’humanité et les singes. Bonne ou mauvaise idée ?
Dix ans ont passé depuis la fuite de César et le début de ce que l’on appelle aujourd’hui l’épidémie du virus Simien. Installée au cœur de la forêt, la civilisation des singes a grandi et a gagné en maturité. César commande et élève ses congénères dans le respect des autres. Mais tout semble sur le point de vaciller lorsqu’ils rencontrent un groupe d’hommes mené par Malcolm, un des leaders des survivants humains de San Francisco. Désœuvrés, les humains veulent remettre en fonction le barrage hydraulique pour récupérer l’électricité vitale pour leur survie. Seulement, Koba, le bras droit de César, se méfie toujours autant des hommes qui l’ont jadis torturé... Peut-il y avoir la paix entre les deux peuples ?
Dans ce volet, Matt Reeves choisit avec une certaine logique de mettre l’accent sur les singes et la société qu’ils ont créée. Grâce aux effets spéciaux hallucinants de Weta, l’entreprise est une éclatante réussite. Dès le départ, on est happé par cette ville en pleine forêt et ces singes qui communiquent par un proto-langage des signes. En faisant le choix de ne pas faire parler César et ses congénères dans un premier temps, Reeves fait un choix audacieux. Malheureusement, il ne respectera pas à la lettre cette décision et donnera voix aux singes – même si de façon très saccadé et simpliste. Pourtant, tout ce qui tourne autour de la société simiesque jouit d’une grande crédibilité et l’on y croit du début à la fin. Le pouvoir chez les singes est un savant mélange de domination/respect pour le plus fort/sage, en l’occurrence César, et c’est lui, justement, qui constitue le point de bascule du métrage.
Reeves excelle à décrire le personnage de César, encore une fois porté par l’excellente performance de l’incroyable Andy Serkis. Plus humain que les hommes que l’on rencontrera, mais tiraillé entre ses origines animales et celles, plus intimistes, de la famille humaine dans laquelle il a été élevé, César s’avère sans mal la plus grande réussite du film. Reeves joue un petit numéro d’équilibriste réussi autour de son héros, tout en lui donnant un double contaminé par la haine des hommes, Koba. Un peu caricatural, Koba n’en reste pas moins un choix judicieux, notamment son passé de cobaye. Le souci principal du film, son paradoxe en fait, c’est qu’il loupe tous ses personnages humains ou presque.
Car en face des singes, Reeves dépeint une société de survivants humains terrés dans un San Francisco en ruines du plus bel effet. Après nous avoir introduit le pourquoi de cette apocalypse dans la première séquence du film, Reeves peine énormément à installer un protagoniste humain aussi fort que celui de James Franco. Alors que Wyatt utilisait la cellule familiale sur 3 générations (Will, son père Charles et le «fils » César), Reeves ne peut retrouver ce schéma et se contente d’un classique héros noble parmi un tas de stéréotypes dont le parangon reste le pauvre Kirk Acevedo en Carver, un connard qui commence par faire une connerie et achève sa vie par une autre connerie. Le reste des hommes que l’on croise ne servent à rien et sont à peine effleurés, à commencer par Gary Oldman et Kodi Smit-McPhee dont on ne se sait rien, et dont les scènes au final... ne servent à rien. Il y a un étrange vide dans tout le pan humain du film de Reeves assez surprenant, à peine rattrapé par le personnage de Jason Clarke, Malcolm. Ce dernier fait un peu écho à Will mais sans la parenté qui l’unissait à César. En gros, une sorte de personnage prétexte qui, bien qu’attachant, peine à trouver un ton aussi juste que James Franco.
Pourtant, malgré ce côté bancal, le long-métrage s’avère réussi, bien plus que ce que l’on pouvait s’attendre pour une suite estampillée blockbuster de l’été. Sa progression narrative et ses quelques beaux instants – notamment la découverte des humains par un bébé singe – le hisse au-dessus du lot. Reeves arrive à lier scénaristiquement son film avec le précédent et à continuer le récit qui mènera inévitablement à la domination des singes. Le premier affrontement qui prend place dans la seconde moitié du film s’avère tout aussi convaincant qu’intense et l’ascension de Koba donne quelques frissons de colère devant tant de bêtise que l’on croyait réservée à l’homme. C’est d’ailleurs un peu le principal message du film : les mêmes vices guettent la société des singes et des hommes. De ce côté, Reeves atteint ses objectifs et livre une copie des plus satisfaisantes. Il n’oublie d’ailleurs pas de rendre un petit hommage au précédent volet avec cet arrêt à la maison des Rodman et son grenier désormais mythique. Si le film avait eu l’impact émotionnel qu’il possède dans cette courte séquence entre César et Malcolm, nul doute qu’il aurait transcendé ses intentions.
Assez réussi, La Planète des singes : l’Affrontement n’évite certes pas quelques facilités commodes (comme défendre San Francisco en cœur de ville et non devant le Golden Gate) ni quelques erreurs (tout le versant humain en fait) mais arrive finalement, grâce à une belle réalisation et une description fascinante de la société simiesque, à happer son public.
Un bon blockbuster de l’été en somme, tout le contraire d’un Transformers.
Note : 8/10
Meilleure scène : César et Malcolm dans le grenier des Rodman votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 16 Août 2014 à 00:38

Dans la foulée des films d’horreur à petit budget tels que Paranormal Activity ou Blair Witch, American Nightmare (critiqué ici) avait connu un petit succès en salles l’année dernière. Malgré sa flagrante médiocrité, il n’en fallait pas davantage pour commander une suite à son réalisateur, James DeMonaco. En reprenant la recette du premier volet, à savoir la Purge Annuelle, DeMonaco tente de varier les plaisirs en sortant ses protagonistes du carcan de la maison de banlieue pour les faire vadrouiller à l’air libre. Malheureusement, ce choix scénaristique ne change pas grand-chose à la qualité globale du métrage...
La purge approche à grands pas. Dans toute l’Amérique, les gens se préparent en se barricadant ou en s’armant selon les plaisirs qu’ils ont choisis. Alors que la contestation monte (Jusqu’à une émission de télé-pirate avec un Noir façon Black Power, c’est dire !), Eva et Cali fortifient leur appartement pour abriter leur père malade. En pleine ville, Shane et Liz font leurs dernières emplettes avant d’aller se retrancher chez eux... mais tombent en panne en pleine ville à quelques minutes du début des festivités (Ca c’est drôle !). Reste Léo, un homme seul qui a décidé de se la jouer cow-boy en allant se venger pendant la Purge. Pendant une nuit de chaos, les destins de ces différents personnages vont se croiser pour le meilleur et surtout pour le pire.Sur le papier, l’idée de la Purge pouvait passer pour intéressante... Pouvait... Seulement en réalité, non seulement la chose est explorée n’importe comment mais en plus elle s’avère intrinsèquement débile. Il est impossible de faire croire au spectateur qu’on puisse laisser joyeusement tout le monde s’entretuer pendant une nuit entière et d’arriver ensuite à regagner le contrôle de la situation. Sans même penser aux multiples vengeances que cela entraînerait. Dans ce second volet, DeMonaco insiste sur le côté « juguler la population permet des économies » mais en même temps vu qu’ils détruisent tout pendant la nuit, on se demande bien comment cette balance est viable. Ainsi, et encore une fois, la base même du film plombe d’emblée le récit. Pourtant, au-delà du concept, le réalisateur se croit obligé de nous livrer une histoire totalement caricaturale.
American Nightmare 2 se contente de marteler un message simpliste : d’un côté vous avez les gentils pauvres noirs (bon y’a quelques blancs mais ils sont cons, ça compte pas) et de l’autre les méchants riches blancs (et bien blancs, avec l’air pincé et tout). On assiste au fur et à mesure de l’avancée du récit à une surenchère hallucinante sur ce même thème. Le point culminant est atteint par l’hallucinante séquence style Battle Royale – Hunger Games (enfin quelque chose dans le genre mais dans une unique pièce) pour le bon plaisir d’un parterre de riches bien bien riches (donc avec une vieille harpie, obligatoire la vieille chez les riches). Tout est exagéré et le propos de lutte des classes semble tout droit sortir d’un manifeste de parti d’extrême gauche. DeMonaco prouve encore une fois qu’il a autant de subtilité qu’un éléphant et fait définitivement dérailler tout son métrage.Pourtant, le changement de cadre apporte un mieux au film. Une des interrogations sur le précédent opus (hormis les raisons budgétaires) était de savoir pourquoi choisir un huis-clos pour un tel sujet ? American Nightmare 2 installe cette fois son action en milieu ouvert (à savoir les rues du centre-ville) et profite mieux de ses possibilités avec quelques bonnes scènes de fusillades. Rien d’extraordinaire, mais c’est certainement le seul bon point du film, tenter d’apporter un poil de fun. Ce n’est d’ailleurs pas les acteurs recrutés qui feront illusion, même ce pauvre Zach Gilford qui semble ne pas trop savoir ce qu’il fait là. Et comme on se fout de la plupart des personnages vu qu’ils incarnent des stéréotypes déjà vu mille fois ailleurs...
Non, American Nightmare 2 : Anarchy ne peut définitivement pas nous faire changer d’avis sur le talent de James DeMonaco. Il peut tout au plus distraire légèrement plus que le lamentable précédent volet, mais sa propension à accumuler les clichés et la caricature dégoûte définitivement de l’univers. Une nouvelle purge en somme.
Note : 2/10
Meilleure scène : La sortie des diverses factions pour le début de la Purge votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 12 Août 2014 à 12:37


Sur une idée de Benoît Delépine, un grolandais, Arnold de Parscau a construit son premier long-métrage qu’il a même réussi à emmener jusque Gerardmer. Illustre inconnu, De Parscau réalise ici son premier film après deux courts. Imaginez un peu : un homme se réveille un beau matin au bord de la rivière sans aucun souvenir - ou presque - de la nuit passée. En rentrant à sa chambre d’hôtel, il s’aperçoit qu’il porte une cicatrice à hauteur d’un rein... avant de constater qu’on l’a bel et bien drogué pour lui voler l’organe en question. Pastor contacte alors sa maîtresse Anna, également médecin, pour trouver conseil. Pendant ce temps, un couple de personnages inquiétants, Wortz et son assistante, écume les campagnes pour trouver de nouvelles victimes. Obsédé par sa mésaventure, Pastor se met en tête de retrouver ses agresseurs coûte que coûte.
Si l'on peut relever un bon point dans le film de De Parscau, c’est sa réalisation. Soignée et dans l’ensemble très correcte, elle possède même quelques fulgurances dans les scènes d’hallucinations-rêves de Pastor où son obsession morbide rejoint ses pulsions primales enfouies. Passé ce constat, Ablations est d’un ridicule consommé. D’abord parce que jamais le métrage ne trouve le ton adéquat pour son sujet. On se demande si le récit se veut humoristique ou dramatique, inquiétant ou délirant... A tel point que seules 2-3 scènes affichent clairement leurs intentions – la tente Quechua par exemple... Le reste du temps, le spectateur s’interroge sur les intentions du réalisateur sans quasiment jamais les percer à jour.
La faute à un script bordélique de Benoît Delépine qui s’éparpille non seulement au fur et à mesure de l’histoire, mais aussi et surtout par son ridicule traité avec un sérieux papal. Comment trouver deux secondes crédible l’histoire d’un homme qui ne va même pas directement aux urgences après avoir découvert qu’on lui a volé un rein ? Et la réaction de son amie médecin (tiens on va faire un scanner en cachette... et Ho c’est ballot on t’a volé un rein... bon tant pis quoi) ? Et la montagne d’absurdités qui s’accumule tout du long ? Parce que le ridicule ne se limite pas aux réactions de Pastor (toutes plus débiles les unes que les autres) mais aussi au pseudo-couple de chirurgiens du dimanche à mi-chemin entre fanatiques religieux et bons samaritains extrémistes (on ne le comprend qu’à la toute fin). Yolande Moreau et Philippe Nahon se voient attribuer des personnages invraisemblables et pas crédibles une seule seconde... Dès lors, rien ne tient debout, rien du tout.
Pire encore, le déroulement du récit s’enlise, et part dans tous les sens. Entre une enquête aussi nerveuse que le dernier épisode de Derrick, une victime qu’on ne cerne jamais et pour laquelle on éprouve aucune empathie et des coq-à-l’âne incompréhensibles (le lien tenu avec le manager de foot, encore une fois totalement débile). Bref, plus le film avance, plus on décroche dans cet imbroglio que De Parscau ne sait pas démêler lui-même. Entre la sous-intrigue de la femme de Pastor et sa maîtresse, qui n’a rigoureusement aucun intérêt, ou la visite chez le médecin privé de licence ou une histoire de vols d’organes sur enfants qui tombe par on ne sait quel miracle là-dedans... Franchement, on ne comprend définitivement plus ce qu’a voulu tenter De Parscau... Même le thème de la folie, assez évident avec le recul, est traité par-dessus la jambe et déjà bien mieux géré ailleurs. Reste un Denis Ménochet convaincant mais perdu au milieu de ce grand n’importe quoi.
Après une fin aussi farfelue et à côté de la plaque que tout le long-métrage, Arnold de Parscau achève de convaincre son public qu’il n’aurait jamais dû se lancer sur un scénario aussi saugrenu et mal géré (sans parler de certains cabotinages d’acteurs intolérables). Il n’y a rien à ajouter sur Ablations si ce n’est qu’on vous le déconseille fortement.
Note : 1.5/10
Meilleures scènes : Les hallucinations de Pastor votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 11 Août 2014 à 18:29

On prend les mêmes et on recommence. 2 ans après, le trublion Gareth Evans remet le couvert avec une suite à son film d’action au succès retentissant : The Raid (critiqué ici). Pas grand-chose ne change dans la recette générale : des combats percutants, un scénario prétexte et des acteurs motivés. Sauf qu’Evans tente tout de même de s’améliorer et ça se sent, c’est pourquoi The Raid 2 sort avec un buzz très positif qui rassure clairement quant à la possibilité d’un simple copier-coller du premier. Le film d’action Indonésien a-t-il trouvé un nouveau mètre-étalon ?Après la mort de son frère des mains du terrible Bejo, Rama se voit forcé de rempiler après les terribles événements de Jakarta. Pour se faire, il va devoir se faire enfermer avec Uco, héritier d’un puissant parrain du crime indonésien, pour gagner sa confiance et infiltrer l’organisation criminel en tant qu’homme de main. Laissant derrière lui sa famille, Rama va pénétrer dans un monde où la violence règne en maître et où le fragile statu quo entre chinois et indonésiens risque à tout moment de voler en éclats sous les complots orchestrés par Bejo.
Si l’on a retenu deux choses de The Raid premier du nom, c’est bien sa faiblesse scénaristique et sa maestria visuelle. Evans, bien conscient de cela, tente de repenser son film et d’organiser une sorte d’intrigue mafieuse où vengeance et trahison font bon ménage. Bien entendu, on est loin des ténors du genre – dont il pompe allégrement divers éléments – et le scénario se perd un peu sur une durée faramineuse de 2h30. Pourtant, l’effort se perçoit et les personnages prennent un peu plus de consistance, aussi relative soit-elle pour un film d’action. On ne va pas attaquer trop frontalement le récit, trop long, trop confus parfois et parsemé de personnages archétypaux, ce serait tirer sur l’ambulance. Mais même si Evans se prend les pieds dans le tapis avec toutes ses sous-intrigues, il amène quelques scènes dantesques avec lui et fait un peu oublier le retournement de situation final prévisible au possible. Car si The Raid 2 s’est amélioré niveau scénario, il a aussi franchi une nouvelle étape visuelle et l’Indonésien livre une copie inspirée et classieuse au possible.
L’action dans The Raid, c’est un peu comme le mélo dans la comédie romantique, c’est tout le sel du film. Evans a un don vraiment inné pour monter des scènes de bastons épiques et jubilatoires pour le spectateur. Sa caméra filme avec une bien meilleure lisibilité qu’auparavant tout en conservant cette capacité à saisir les instants chocs et secs des combats. La première grande scène, dans la cour de la prison, est quasiment une leçon de mise en scène, jouissive au possible et aussi brutale que stylisée. D’autres suivront, beaucoup. Et Evans pousse les choses à fond... jusqu’à une improbable séquence où s’unissent gunfight, course-poursuite et combat à mains nues. Totalement démentiel on vous dit. Ce qui est drôle, c’est que le Mad Dog du premier volet a fait des émules (sans parler que l’acteur l’incarnant est de retour grimé sous les traits du délicieux Prakoso, de loin le personnage le plus cool du film). Dès lors, The Raid 2 se transforme en une succession de fights d’anthologies contre ce que l’on pourrait qualifier de boss de jeux vidéo (les amateurs de Street of Rages apprécieront).
De la fille au marteau au mec aux crochets en passant par celui à la batte de base-ball, inutile de dire que ces personnages n’ont rigoureusement aucun background... mais Evans se sert de leur esthétisme pour les incarner. Ce qui n’est d’ailleurs pas une mauvaise idée en soi pour ce type de long-métrage. Ce qui est saisissant par contre, c’est que face à cette surenchère, notre héros, Rama, fait un peu pâle figure. Alors oui, on sait que dès qu’il rentre dans une pièce avec tel ou tel objet, ça va faire très mal, mais son look reste des plus banals. Heureusement, son jeu d’acteur s’est lui aussi un peu amélioré et a certainement gagné en maturité, Iko Uwais assure ce qu’il faut pour son rôle de combattant revanchard. Impossible non plus d’oublier Yayan Ruhian (le Mad Dog du premier), seul personnage un peu travaillé (c’est dire) et qui possède un charisme indéniable, même en habits de clochard.
The Raid 2 ne réserve pas de grandes surprises à son public. Ceux qui ont aimé le premier, adoreront le second, les autres par contre resteront toujours aussi hermétiques. Cependant, pour un film d’action, c’est clairement le haut du panier et même un non-amateur devra prendre sa petite claque devant certaines scènes (ce plan dans le métro style Old Boy) sans parler du fait qu’Evans s’améliore et fait clairement des efforts à tous les niveaux. On attend juste que le bonhomme trouve un scénariste digne de ce nom pour vraiment obtenir du lourd. En attendant, vous savez ce qu’il vous reste à faire...
Note : 7/10
Meilleure scène : La bataille dans la boue de la prison 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Nicolas Winter le 8 Août 2014 à 11:36

C’est en rencontrant le tout jeune Ellar Coltrane à ses 6 ans que le réalisateur Richard Linklater – à qui l’on doit A Scanner Darkly ou plus récemment Before Midnight – décide de réaliser un film exceptionnel. Son idée ? Filmer une cellule familiale sur douze années de vie, de 2002 à 2013, et raconter l’enfance d’un jeune garçon, Mason. Primé au festival de Berlin avec rien de moins que l’Ours D’argent du meilleur réalisateur, Boyhood arrive sur nos écrans avec une réputation flatteuse. Que vaut réellement ce film-fleuve à la durée impressionnante de 2h45 ?
Mason a six ans. Il vit avec sa sœur, Samantha et sa mère, Olivia. Son père, lui, ne lui rend visite qu’occasionnellement pour une virée festive. Mason va vite apprendre que la vie présente ses épreuves et ses détours, mais aussi des moments de joie et de bonheur. Pendant près de douze années, le jeune garçon va devenir un jeune homme accompli et passer entre les mailles du destin. Il découvrira l’amour mais avant toute chose il apprendra ce que signifie devenir adulte.
Portrait soigné et minutieux de la vie ordinaire – ou presque – d’une famille américaine, Boyhood étonne par sa sobriété et sa subtilité. Linklater prend un peu à contrepied les attentes du spectateur et ne s’embarque pas tant dans une histoire dramatique – la piste sur le beau-père alcoolique par exemple – que dans une histoire tout court. En jonglant avec divers registres, de l’humour à la tragédie, Linklater refuse de se cantonner à un thème autre que celui de montrer Mason grandir. Car c’est bien là que réside en réalité le centre du film, ce n’est ni dans les aventures malheureuses d’Olivia ou dans les regrets de Mason Senior, ce qui importe c’est le regard que porte le jeune garçon sur les étapes de sa vie et sur ceux qui l’entourent. Sans jamais verser dans le patho et avec une intrigue finalement d’une banalité étonnante, Linklater délivre un portrait quasi-universel.
En explorant les coups durs de l’adolescence par exemple, ou le rapport complexe entre une mère seule et son enfant, voire pire entre un père fantomatique et son garçon. Même si la grande sœur Samantha – extraordinaire Lorelei Linklater – prend parfois une place importante, elle ne constitue qu’une brique de l’existence de Mason. Le réalisateur possède le talent nécessaire pour effacer ses autres trames derrière celle, primordiale, de Mason. Ainsi, le film acquiert une saveur toute particulière. Le récit se fait doux-amer avec ce temps qui passe, et toute une génération se reconnaît dans les yeux de Mason. D’une chanson de Britney Spears à une partie d’Halo en passant par des épisodes de Dragon Ball Z, c’est un peu toute une époque qui défile autour du garçon et devant le spectateur. Linklater, doucement, se fait témoin du changement.
Ce changement qui reste toujours le moteur du film. Qu’il ait recours à des ressorts dramatiques – le départ précipité de la maison du beau-père – ou plus tendres – les cadeaux d’anniversaire des grands-parents – c’est le changement qui gouverne Boyhood. On voit avec plaisir évoluer physiquement et psychiquement Mason, et sans s’en rendre compte, chacun se souviendra de telle ou telle étape de sa propre existence. Jamais Linklater n’a la mauvaise idée de s’enfermer dans un carcan scénaristique. Il aurait été très facile de plonger tête la première pour filmer les affres d’un mari violent ou ses conséquences sur les enfants. Mais il n’en est rien. Ces moments-là passent, marquants certes, mais avant tout pour être remplacés et aller de l’avant, comme le fait Mason. Le plus remarquable dans Boyhood, c’est cela, cette capacité à se focaliser sur le temps qui passe et non pas à s’acharner autour d’un évènement en particulier. De cette façon, le film atteint tous ses objectifs.
En y rajoutant une BO magnifique et quelques fulgurances – comme Olivia pleurant seule dans le silence total lors du départ de son grand garçon – Linklater touche au plus juste et finit par poser la question essentielle et fondamentale du métrage : A quoi bon la vie ? A quoi bon tout ça ? Et Mason Sr de répondre avec pragmatisme qu’il n’y a aucune raison. Parce que c’est un peu ça le message de Boyhood, il arrive une flopée de bons et de mauvaix choix dans une vie, comme il se passe une foule de choses agréables ou non, mais en définitive, c’est le temps, cette horloge implacable qui efface et remporte tout sans autre explication. Dès lors, tout peut recommencer, à bord d’une voiture sur l’air de Hero de Family of the year, fuyant le passé pour mieux se construire un futur, les yeux dans le ciel, côte à côte avec une autre étincelle d’humanité. Une humanité dont ne manque jamais Boyhood et qui, finalement, emporte tout sur son passage, comme un tsunami irrésistible.
Plus qu’une réussite, le pari de Linklater émeut profondément. Avec cette subtilité et cette humilité qu’on n’attendait pas forcément, le réalisateur sublime une histoire banale pour en faire une ode douce-amère à propos du temps, ce grand sablier qui laisse s’écouler sur près de 2h45 les grains de vie de l’enfance de Mason. Tout cela sans jamais ennuyer. Chapeau.
Note : 9/10
Meilleure scène : Olivia qui craque dans le salon votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 5 Août 2014 à 12:50

Albert est un brave gars de L’Ouest. Non. En fait Albert est un lâche doublé d’un looser. Alors même qu’il refuse de prendre part à un duel, sa petite amie Louise décide qu’elle en a assez de lui et le plaque pour un autre, l’arrogeant expert en moustaches, Foy. Par un heureux hasard, Albert va tomber sur une mystérieuse étrangère récemment installée en ville : la superbe Anna. Celle-ci lui propose alors de tout tenter pour récupérer son ancienne compagne. La seule chose que ne sait pas Albert, c’est qu’Anna est aussi la femme du plus dangereux bandit du Far West, le fameux Clinch. Fréquenter Anna n’est peut-être pas la meilleure idée qui soit...
Seth McFarlane ne se présente plus. Extrêmement connu aux Etats-Unis pour ses deux séries animées auxquelles il prête également sa voix dans l’impertinent American Dad sans oublier les Griffins, il avait en plus enregistré un gros succès au cinéma avec Ted, l’histoire d’une peluche parlante pas vraiment pour enfants. Pour son second long-métrage, il s’essaie à deux nouvelles choses : interpréter lui-même son rôle-titre et déplacer son intrigue dans le Far West. En rassemblant Liam Neeson, Charlize Theron ou encore Amanda Seyfried, McFarlane a de beaux atouts dans sa manche pour offrir une nouvelle comédie hilarante. Le souci c’est qu’A Million Ways to Die in the West (traduit certainement par un publicitaire drogué en France en Albert à L’ouest) est très loin de son ainé.
La première chose qui choque dans Albert à L’ouest, c’est sa réalisation bâclée. Même si elle tend à s’améliorer vers la dernière partie, l’intégration des décors et des FX combinée aux cadres choisis par Seth McFarlane s’avèrent des plus médiocres. Certaines scènes en intérieurs font tellement fausses que l’on en perd tout intérêt pour ce qui se passe à l’écran. Mais au-delà de cet aspect purement technique, Albert à L’ouest accumule les tares entre son scénario, ses personnages et son humour. Jamais le film ne profite de son postulat (inclus dans le titre VO), à savoir les façons dont l’on peut mourir dans l’Ouest Américain. Cette piste, pourtant prometteuse, se limite à une énumération fastidieuse d’Albert en début de métrage ainsi que deux trois scènes-gags où un homme meure d’une façon horrible et souvent sans raison. Là où les Monty Python auraient pu faire quelque chose d’absolument génial avec ce concept de base, Seth MacFarlane n’a pas du tout le même talent ni le même humour.
Celui-ci était assez borderline dans Ted, oscillant entre le gras assumé et le transgressif avec plus ou moins de bonheur. Dans Albert à L’Ouest, tout est amplifié et l’humour n’y échappe pas. On se retrouve face à des gags qui ne frôlent même pas le niveau des pâquerettes. Basé presque entièrement sur le registre pipi-caca, il en devient tellement lourd qu’on est presque embarrassé de voir ce qui se passe à l’écran (comme la séquence à la fois archi-convenue et d’une médiocrité affligeante où Foy se vide dans des chapeaux de cow-boys). Le pire, c’est que MacFarlane pense judicieux d’appuyer son humour gras par les personnages qui se trouvent à l’écran. On assiste alors à des séquences désolantes comme celle où Albert crie à son ami que c’est tellement drôle et horrible à la fois cet homme écrasé par le bloc de glace en se tenant le ventre et en tapant des pieds. Bien sûr, il reste quelques instants drôles, comme de voir Neeson se faire ridiculiser, mais franchement même le couple Edward-Ruth qui semblait avoir un gros potentiel comique s’englue dans une bouillie affligeante et répétitive.
L’autre immense problème d’Albert à L’Ouest, c’est Seth MacFarlane. Jusqu’ici, il se contentait de faire la voix de certains personnages (Ted par exemple) mais il décide cette fois de faire l’acteur en chair et en os, et pas n’importe lequel puisqu’il s’arroge le rôle-titre. Là où le bât blesse, c’est qu’il est simplement un mauvais acteur qui alterne des séquences de surjeu éhontées avec une inexpressivité consternante. Dès lors, Albert finit rapidement par emmerder le spectateur royalement sans compter que son histoire n’a rien de passionnant. L’originalité de Ted se situait dans cette peluche vivante et vulgaire, mais dans Albert à L’Ouest, il n’y a rigoureusement rien d’original. Le récit s’avère on ne peut plus balisé, avec un héros looser qui perd une petite amie au profit d’un prétentieux patenté (Le pauvre Neil Patrick Harris condamnée à rejouer une resucée époque cow-boy de son personnage d’How I Met) avant de rencontrer une beauté qui va tomber amoureux de lui parce qu’en fait c’est un gentil gars. On vous laissera la « surprise » de la fin, mais franchement tout est attendu, tout est conventionnel et prévisible. Seul le passage chez les Indiens fait preuve de quelques originalités avec une séquence animée absurde au possible (mais aussi terriblement moche). On passera rapidement sur le reste, à savoir une Charlize Theron certes magnifique mais en mode automatique, ou une tripotée de personnages secondaires qui ne servent à rien.
Alors oui, celui qui a traduit le titre d’A Million Ways to Die in the West n’était pas si loin de la vérité. Albert à l’Ouest est vraiment un film à l’Ouest. Il a quasi tout faux et condamne tous les espoirs que l’on avait pour Seth MacFarlane au cinéma.
A éviter, carrément.
Note : 2.5/10
Meilleure scène : Le caméo d'un certain Doc' votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 4 Août 2014 à 22:46

Au cœur des quartiers pauvres de Jakarta, se trouve une citadelle imprenable dans laquelle se cache le plus dangereux trafiquant du pays. Une équipe de policiers d’élite est envoyée donner l’assaut lors d’un raid secret mené aux premières lueurs du jour. Mais grâce à ses indics, le baron de la drogue est déjà au courant et a eu amplement le temps de se préparer. A l’instant où le groupe d’intervention pénètre dans l’immeuble, le piège se referme : les portes sont condamnées, l’électricité est coupée et une armée d’hommes surentrainés débarque. Piégés dans cet immeuble étouffant, les policiers vont devoir se battre étage après étage pour avoir une chance de survivre.
Précédé par un énorme buzz en France, The Raid avait un peu la réputation d'être le meilleur film d'action depuis quelques années. Et en quelque sorte, il l'est.
Bon pourtant, le film de Gareth Evans ne part pas gagnant, le scénario est bateau, avec une équipe de policiers envoyée au cass-pipe et pris au piège par toutes sortes de malfrats, des personnages caricaturaux avec le méchant bien méchant, le gentil ripoux, le méchant pas si méchant... Bref tout y est. Seul le personnage de Mad Dog apporte un brin de folie dans le tas (et une double-dose !). Tous les acteurs jouent correctement, à l'exception notable du vieux policier qui en fait un poil trop. Au contraire, l'acteur principal, Iko Uwais assure une performance tout a fait honorable.
Alors si le long-métrage reste prévisible et caricatural, qu'est-ce-qui a pu créer tant de bruits ? Eh bien la réalisation et les combats. De ce côté là, vraiment, et même pour un non-amateur de film d'action, c'est positivement génial. Tout s'enchaîne très vite, les chorégraphies sont très impressionnantes et la réalisation, les angles de caméras d'Evans s'approchent de la perfection. C'est violent, sec, virtuose, bref c'est très franchement impressionnant et jouissif. Pour son côté action-movie, le film remplit parfaitement son cahier des charges. Vous aurez mal à chaque coup et à chaque cassage de bras. L'inventivité en terme de baston du long-métrage confine au génie. Tout comme le font parfois les plans du thaïlandais.
En clair, The Raid est le parfait film de détente entre potes, mais qui ne va pas plus loin que ce qu'il propose et ne boxe jamais dans la catégorie supérieure. On gardera un œil attentif sur l'Indonésien pour son prochain long-métrage, tant l'on est impressionné par sa virtuosité formelle.
Note : 6/10
Meilleures scènes : A peu près toutes les séquences de combats 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 3 Août 2014 à 11:56

Il arrive comme ça, parfois, dans notre vie, que l'on soit confronté à un film de merde. Mais vraiment. Pas le petit film qui avait de bonnes intentions mais qui au final se ramasse ni du film nul mais qui peut faire rire involontairement. C'est le cas du dernier long-métrage de James De Monaco, The Purge - renommé sous nos contrées American Nightmare, pourquoi ? On se demande, peut-être pour éviter les mauvais jeu de mots avec la qualité du film en question ? - Mais bref, nous voici donc devant un énième film d'horreur mâtiné cette fois de science-fiction et saupoudré d'une dose de psychopathes. Bien agiter et porter le tout à ébullition et Bam, ça fait des chocapics. Ou pas. Dans le petit monde de The Purge - un univers très sympathique au demeurant, vous allez vite vous en rendre compte - les Etats-Unis ont décidé de résoudre la crise sociale et économique en instaurant une nuit par an, appelée la Purge, où les citoyens ont le droit de commettre des crimes en toute impunité (le meurtre, le viol, la zoophilie, regarder Glee, chanter du Justin Bieber...). Ainsi, la société est écrémée (oui parce que c'est souvent le clodo de base qui se fait latter) et tout le monde y gagne - notamment les armuriers et les vendeurs de système de sécurité. C'est à cette catégorie qu'appartient James Sandin, et pas qu'un peu puisqu'il est le vendeur number one des States. Celui-ci décide naturellement de passer cette nuit de "purge" à l'abri avec sa petite famille : sa femme Mary, son fils Charlie et sa fille Zoey. Le soucis, c'est qu'ils vont avoir des invités imprévus et que tout va tourner à la catastrophe.
Avec un pitch aussi fou, on aurait pu avoir un film génial. Imaginez, une critique de la violence dans la société américaine, du paraître et de la civilisation ou encore l'impact du crime sur les enfants. Mais The Purge ne fait jamais qu'effleurer ces thèmes, comme un passage en revue obligé en début de métrage avant de passer au vrai centre d’intérêt du machin, c'est à dire "tuons-nous les uns les autres dans la joie et la bonne humeur". De ce fait, The purge ne fait rien qu'accumuler les clichés, les crétineries et les scènes d’esbroufe. En reprenant à son compte tous les mécanismes du film d'horreur de base, James DeMonaco affole le compteur de clichés - personnages (et surtout les gosses) totalement débiles, propos imbéciles, du jump-scares à la pelle parce que l'on sait pas faire autrement pour faire peur, les méchants très très méchants, les salauds de riches et les gentils pauvres, et le noir qui se fait défoncer (il faut toujours un noir). The Purge voulait en fait peut-être refléter tout ce qu'on pouvait faire de mauvais dans le thème épouvante-thriller malsain. On trouve bien entendu diverses sources d'inspiration, pêle-mêle Eyes Wide Shut, Funny Games US, Panic Room, Où est Charlie... Oui bon d'accord, pour ce dernier ce n'est pas forcément évident.
Pourtant, le spectateur le comprend malheureusement rapidement, The purge écope de deux enfants boulets. Les personnages de Zoey et Charlie représentent l'archétype du môme chiant, con, inutile et un peu taré qui peuple la série B voir Z. Parlons succinctement de Zoey qui passe son temps à pleurer, à se perdre dans sa propre maison, à se barrer pour sa cacher sans qu'on sache pourquoi et qui finit par revenir alors que l'action est terminée. Oui, elle ne sert à rien. Sans compter que l'actrice Adelaide Kane, a un talent misérable. Mais attention, ce n'est pas tout. Dans un délire post-infusion de LSD-Cocaïne, le réalisateur et le scénariste ont inventé Charlie. Les parents passent leur temps à le chercher, à l'appeler, ils ne le baffent jamais alors qu'il enchaîne les conneries - "Tiens, c'est une nuit où tout le monde bute tout le monde si on ouvrait le système de sécurité de papounet pour blaguer" - et en plus, pour couronner le tout, il semble naturellement fou à lier. Le jeune Max Burkholder qui l'incarne n'est pas forcément mauvais mais son personnage est tellement débile et insipide qu'il n'a pas grande chance de briller. On ne parlera guère des parents, puisque Lena Headey s'énerve ( à croire que l'on ne veut lui faire jouer que ça la colère) et Ethan Hawke fronce un sourcil de temps à autre (peut-être conscient qu'un jour, il a été un grand acteur).
D'ailleurs, c'est loin d'être tout, puisque non content de tenter d'installer un faux huit-clos avec un SDF noir (vous le sentez le cliché là ?), The purge voit l'arrivée de deux méchants. Des blonds, évidemment, à la chevelure Petrol hahn et soyeuse. Mais qui en font des tonnes, mais DES TONNES ! La palme revient quand même à Arija Bareikis qui parvient à surjouer incroyablement son perso en cinq minutes d'apparition top chrono. C'est balèze. L'autre méchant, le blondinet incarné par Rhys Wakefiel, fait de même. Jouant une sorte de copie grotesque et crétine du blond de Funny Games US, il se veut chef de gang malsain mais s'avère aussi effrayant qu'un teckel sous amphets - Quoi, chacun ses occupations non ? - et finira par faire tout ce qu'on attend de lui. Car sachez-le, aucune surprise dans The Purge, le pseudo-twist final se sent dès la cinquième minute. Reste alors l'horreur, le glauquissime avec ces gens masqués et cette violence. Mais en fait non. Il n'y a rien, sauf peut-être un poignardage en règle du noir vu en plan rapproché - en même temps, c'était le noir du film, fallait s'y attendre. Mentionnons en parlant de ce passage que la logique des personnages et leur morale laissent perplexe. La plupart des gens hésitent à poignarder un homme sans défense AVANT de le faire, pas après. Mais bon.
Quid des thèmes alors ? Ben rien. La violence c'est pas beau et le monsieur il aimait l’Amérique mais il a perdu ses deux gosses, donc c'est fini. Aucune profondeur, aucune réflexion. Sauf peut-être qu'il faut pas tuer les SDF, c'est mal. Ça relance l'économie mais c'est immoral. Énorme révélation. De toute façon, on s'aperçoit vite que le concept de base n'a aucun sens. Une nuit de violence qui résoudrait tout. Bien sûr pas de rancœur et donc de vendetta, et pas de soucis si on bute la moitié de la population en une nuit. Bof, pourquoi pas, c'est cool. Y'a moins à entretenir. The Purge invente le concept du film d'horreur qui n'effraie pas. C'est déjà pas mal.
Que reste-t-il à ajouter ? Rien, ne perdez pas une heure et demie de votre vie à regarder une partie de cache-cache avec un noir dans le noir, à trouver Charlie ou à voir défiler le clan des bourges en masques de carnaval. Franchement, il y'a mieux à faire que regarder American Nightmare. Comme se couper les ongles ou dormir.
Note : 1/10
Meilleure scène : La présentation du chef de gang. Un parangon de surjeu... votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 2 Août 2014 à 11:56

Alors que Christopher Nolan est assez occupé avec son futur Interstellar, c’est son directeur de la photographie, Wally Pfister, qui livre son premier film avec Transcendance. Long-métrage purement SF, il nous emmène dans les traces d’un inventeur génial et ceux de sa compagne, interprétés par rien de moins que Johnny Depp et Rebecca Hall. Pour compléter la chose, Pfister engage une tripotée d’acteurs géniaux comme les trop sous-exploités Paul Bettany, Cilian Murphy ou encore Kate Mara. Avec un casting d’une telle classe, il reste à savoir si Pfister peut vraiment réaliser un film convaincant pour le sujet ambitieux qu’il a choisi, celui de l’IA.
Les époux Caster sont des chercheurs renommés. Will Caster développe un projet d’IA qui bénéficierait d’une conscience et pourrait finalement s’autogérer. Une nouvelle étape de l’évolution en somme. Si la majorité de la communauté scientifique se presse pour assister aux conférences de Will et de sa femme Evelyn, il n’en va pas de même pour un groupe terroriste qui craint cette Transcendance et organise une série d’attentats qui culmine avec l’assassinat de Will. A l’article de la mort, celui-ci demande à Evelyn et à son meilleur ami Max Waters de transférer sa conscience dans un super-ordinateur. Alors qu’ils y parviennent, Bree et son groupuscule découvrent la cachette de Will. Dans une dernière mesure désespérée, Evelyn relâche l’IA Will dans l’océan d’internet. Mais quelles sont ses véritables intentions ?
Transcendance prend tout d’abord le parti d’explorer les tenants et aboutissants de la création d’une IA autonome. L’idée n’est pas mauvaise, au contraire, et le couple Craster se prête très bien à la chose. De même, la justification de la brusque accélération des choses tient bien la route et l’émotion suscitée par la mort brutale de Will pour sa femme Evelyn justifie la séquence qui conduit Will à envahir l’internet. Pourtant, dès le début, on sent quelques soucis dans le film de Pfister. D’abord dans le couple, trop vite passé en revu et installé, le réalisateur loupe son accroche empathique et le contact envers Will reste froid durant tout le long-métrage, d’autant plus après sa dématérialisation. Ensuite parce que certaines incohérences pointent le bout de leur nez dès le départ. La balle irradiée qui empoisonne Will et le fait qu’on lui implante des électrodes intracrâniennes alors que ses globules blancs doivent frôler le 0, c’est totalement invraisemblable. Enfin, on sent rapidement que Transcendance va peiner à trouver sa voix et son originalité propre. Dès le départ avec ce danger latent autour de l’ascension de Will dans le monde d’internet et son contrôle croissant de celui-ci, on pense à d’autres long-métrages : Terminator forcément avec son Sklynet, ou encore Matrix (et plus précisément Seconde Renaissance le court-métrage d’Animatrix). Malheureusement, les bévues ne s’arrêtent pas là.
Alors que le film de Pfister avance dans le temps et installe son atmosphère paranoïaque (Will est-il encore Will ?), il se disperse au fur et à mesure. Les thématiques se divisent et le réalisateur les effleure trop rapidement. On parle de nanotechnologies, d’amélioration humaine (encore un élément qui fait penser aux Terminators) mais aussi de responsabilité et de liberté individuelle. En fait, Pfister fait une erreur de débutant et s’éparpille trop. Jamais le film n’est désagréable en soi ou mauvais, on prend même un certain plaisir à suivre l’évolution de l’entreprise des Caster. Mais le souci c’est que non seulement on ne sait plus où veut en venir le réalisateur mais en plus on y croit pas vraiment. La raison est assez simple, faute de budget, l’adversaire de Will se résume à une dizaine de terroristes menés par Bree et à ses deux ex-amis, Max et Joseph. Alors que l’IA prend une importance démesurée, détourne des fonds par millions, recrute et améliore des hommes pour en faire une sorte d’armée new-age, jamais l’on ne voit débarquer l’armée et l’on nous sert une excuse invraisemblable sur l’incapacité du gouvernement à agir contre une entité qui ne s’est pas montrée agressive. Donc, on confie le travail à quinze personnes avec deux mortiers et deux obusiers pour les attaquer. Quand on sait la tendance belliqueuse du gouvernement américain à l’heure actuelle, c’est très très difficilement crédible de les voir laisser grandir et mûrir une telle menace, qui plus est sur leur propre sol.
Ce qui est par contre plus grave, c’est que si l’action se resserre autour du couple Will-Evelyn et de la douloureuse prise de conscience de cette dernière, les personnages secondaires se retrouvent totalement bâclés. Comment Pfister peut-il embaucher Murphy, Bettany, Freeman et Mara si c’est pour faire de la quasi-figuration et les cantonner à des rôles clichés et insipides ? C’est presque une honte. On pourrait presque en dire de même d’ailleurs pour Johnny Depp, bien vite relégué à une image numérique et qui, franchement, ne force pas trop son talent. En fait, il n’y a guère que Rebecca Hall pour livrer une prestation qui sort du lot. C’est son personnage qui bénéficiera de la plus forte empathie de la part du spectateur et dont le choix cornélien entre amour et conscience donnera un des seuls moments forts du film. Malgré une réalisation pas forcément mauvaise, rien n’impressionne vraiment. Ni l’intelligence du propos, ni les plans ou les séquences de « guerre ». En fait, Transcendance ne peut pas sérieusement atteindre les objectifs qu’il se fixe et parler correctement de thèmes qui ont été déjà bien mieux exploitées ailleurs. C’est d’autant plus dommage que le long-métrage n’est même pas mauvais en soi, juste terriblement bancal et faiblard sur ce qui devrait être ses points forts. Il reste pourtant une bonne chose au film avec cette fin assez inattendue et loin des canons manichéens du genre. Pfister prend à contre-pied les attentes sur les intentions de Will et finirait presque sur une note de poésie bienvenue. Ce qui nous amène à penser que si le métrage avait maintenu ce niveau tout du long, on aurait été en face d’un excellent film.
Quel dommage que Wally Pfister ait mis la barre si haute pour son premier essai. Sans être foncièrement mauvais, Transcendance n’arrive pas à atteindre ses objectifs ou à utiliser son casting correctement. Pire, il délaisse sa vraisemblance pour une séquence d’attaque cheap et absurde en plein désert. Le long-métrage est l’exemple typique du film raté. Dommage en somme.
Note : 6/10
Meilleure séquence : La fin des deux époux. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 28 Juillet 2014 à 11:25

Ils sont de retour.
Encore.
Transformers revient pour une quatrième fois. Toujours avec Michael Bay aux commandes. On pensait pourtant qu’après le lamentable 3ème volet, il allait arrêter les frais. Mais visiblement, la production de Pain & Gain, son film personnel, lui a laissé une dette envers la Paramount. Alors évidemment, sans même entamer la critique, sans même voir la chose, on se doute fortement du résultat final. Puisque Shia Labeouf a quitté le navire (comme l’avait fait Megan Fox après le second volet), Bay recrute son chouchou Mark Wahlberg aux côtés de…bah…d’une blonde (parce qu’il faut bien remplacer la précédente) nommée Nicola Peltz, mais franchement le nom n’a aucune importance. Nous sommes dans Transformers, de toute façon rien n’a d’importance, faut juste que ça fasse boom !
On ne va pas vous faire l’affront de vous rappeler l’histoire (hum hum) juste la mise à jour nécessaire pour ce volet. Après la bataille de Chicago, les humains n’aiment plus beaucoup les robots géants et ont décidé de les pourchasser, Decepticons ou Autobots. Pour se faire, ils ont même recours aux services d’un mercenaire robotique venu de l’espace (oui, c’est génial dis comme ça) du doux nom de Lockdown. Au milieu, une famille Texane avec le père Cade Yeager, la fille Tessa et son petit-ami Shane. Voilà voilà. Faut-il préciser également que le film s’étire sur 2h45 ? Oui, précisons-le parce que ça risque d’être très long près de trois heures de robots qui se foutent sur la tronche. Très très long.
Soyons honnêtes cinq minutes. A moins de n’avoir vu aucun des précédents volets ou d’être masochiste, on sait très bien ce qui nous attend dans la salle. Ce n’est pas parce que Bay sort d’un excellent film avec Pain & Gain qu’il peut transfigurer sa saga favorite. Surtout que tous ses acteurs se sont barrés et que, de toute façon, la franchise fait n’importe quoi depuis un bail. C’est vrai après tout, Transformers à la base, c’est tout de même des jouets Hasbro avec des aliens mécaniques qui se transforment en voitures et en robots géants. Mais qu’est-ce que l’on peut espérer d’une adaptation pareille ? En sachant en plus que le premier volet était tout juste passable, on vous laisse imaginer les suivants…jusqu’à donc ce quatrième volet. Qu’en dire au final ? C’est la question… Commençons par les bons points : Lockdown et son vaisseau ont un look super bad-ass et soigné, et même si le cliché SF du chasseur intergalactique est vu et revu, c’est bien le seul qui apparait comme vraiment cool dans le long-métrage. Ensuite, les FX sont au top (comme d’habitude) et Bay filme un peu moins de façon hystérique ses combats de robots. Enfin, il y a des gros plans sur le short de la blonde et même qu’elle coure au ralenti parfois...
Passé ce dernier argument misogyne au possible, le constat ne change pas beaucoup : Transformers 4 est un film affligeant. Déjà, en un seul long-métrage, vous avez tous les clichés (mais absolument tous, ce n’est pas juste une formule comme ça !) du blockbuster Hollywoodien. Jugez vous-même : Une famille avec un père ultra-protecteur envers sa fifille d’amour qui se balade dans des tenues qui ne filent plus aucun doute sur sa virginité, le petit-ami de la dite fifille d’amour qui est un beau gosse en conflit ouvert avec la papounet parce que Papa a du mal à laisser partir sa fille, et même qu’il va prouver au père qu’il peut être un bon copain. Un méchant très très très méchant qui vendrait sa mère, son yorkshire et son slip lapin crétin pour tuer les Autobots. Un scientifique que même s’il a l’air méchant, en fait non, il a un bon fond. Des asiatiques qui font du kung-fu – sinon ce n’est pas un asiatique de toute façon. Des Robots qui parlent comme des demeurés. Les méchants qui capturent les gentils qu’il faut aller sauver. Le grand méchant de la série qui revient (ENCORE !). Le sacrifice du héros (une fois, deux fois, trois fois…). Bon, on va arrêter là, il n’y a aucune once de début d’originalité dans Transformers. Voila. Et en plus son récit traîne en longueur comme pas possible avec des ajouts dont on se fout totalement comme la sous-intrigue avec le Transformium, et qui ne sert qu’à annoncer un cinquième volet (joie et bonheur sur le monde).
Ce qui est tout de même drôle avec Transformers, c’est cette capacité hallucinante à n’avoir rien à foutre de la mythologie installée auparavant. A chaque film, on retrouve une nouvelle menace sortie d’on ne sait où (Lockdown apparait comme ça mais on sait même pas pourquoi) et que la précédente giga-menace cosmique en fait…bah c’était rien du tout. Ah non ! Sauf Mégatron. Parce que le chef des Decepticons, lui, il est increvable. Ça fait 4 volets qu’on se le tape, 4 ! Il a été noyé eu fond d’un océan, taillé en pièces et décapité mais non, il est de retour. Soyez certains que s’il vient à fondre dans de la lave, ils vont appeler Jean-Pierre Jeunet pour le cloner et le mettre dans le ventre de Ripley. Déjà qu’il n’était pas super-charismatique avant, son nouveau design s’avère banal et son rôle n’intéresse personne dans l’histoire. Alors le troquer pendant une bonne grosse demi-heure à la place de Lockdown, c’est l’idée la plus stupide du film. Mais il n’est plus à ça près.
Parce que tout de même Transformers 4 n’a aussi rien à faire de sa cohérence interne et de la vraisemblance. Les autobots sont en groupe quand ils le veulent, laissent capturer leur chef quand ils le veulent…Lockdown tue tout le monde mais se retrouve à genoux face à 3 humains armés d’un fusil et d’une dépanneuse (oui oui une dépanneuse)…Et puis on ne va même pas vous parler des multiples sauvetages d’humains pendant des chutes vertigineuses style « On vous écrase pas dans nos mains de gros robots même si on tombe de 12 km de haut en se prenant 3 immeubles ». Ne parlons pas non plus des nouveaux Autobots, même si la plupart ont un super look (et feront vendre plein de jouets), ils sont neuneus comme pas possible. Le seul soulagement c’est que depuis le départ de Sam, Bumblebee ne nous saoule plus avec sa pseudo-amitié. Il reste très lourd certes, mais c’est déjà ça de gagner. Parce qu’en plus le film se veut drôle mais il ne l’est jamais (ou presque). A un moment, avant que le sidekick du début ne brûle, on a juste envie de se pendre avec ses lacets à l’accoudoir de son siège tellement l’humour tombe bas. Et pas que l’humour puisque Bay nous gratifie des pires placements de produits commerciaux qui soient. Arriver à placer comme ça des marques comme Victoria Secret’s ou Beats Audio, sérieux, chapeau, fallait oser.
Alors oui, à la fin, les autobots chevauchent des robots dinosaures (les Dino-Bots). Oui. Bon. Qu’est-ce qu’on peut rajouter à ça ? Transformers 4 marque une étape de plus dans le ridicule de la franchise, une franchise qui continue à exploser le box-office US malgré sa totale médiocrité. De là à penser que nos amis américains ont un cerveau de bulot… Non, nous n’irons pas jusque-là. Vous l’avez maintenant deviné, il n’y a rien à tirer de ce volet, rien qui mérite de se déplacer. Pire, même les scènes de combats impressionnent moins que les précédents opus, comme si Bay lui-même en avait définitivement marre. Alors laissez-le faire des films personnels comme The Rock ou Pain & Gain et arrêtez avec ces Transformers…Parce que là, ça devient vraiment pathétique.
Note : 1/10
Meilleure scène : Le passage dans le vaisseau de Lockdown
Meilleure réplique : « Tire sur mon manche ! » 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Nicolas Winter le 27 Juillet 2014 à 23:16

Isao Takahata est un génie. Tout le monde connait Hayao Miyazaki mais, étrangement, en Occident, Takahata est un peu moins connu. Pourtant avec des dessins animés comme Pompoko ou Mes Voisins les Yamada, le monsieur n’a pas de quoi rougir, bien au contraire. Ajoutez-y le chef d’œuvre Le Tombeau des lucioles, un des plus grands et puissants dessins animés de tous les temps (rien que ça), et vous commencerez à comprendre pourquoi la sortie d’un nouveau long-métrage du maître constitue un événement. En restant dans un strict registre japonais avec l’adaptation d’un des contes populaires les plus anciens et les plus connus du pays du Soleil Levant (Le Coupeur de Bambou), Takahata choisit également de conserver un style d’animation désuet là où les productions occidentales l’ont totalement délaissé. Que nous réserve ce Conte de la princesse Kaguya ?
Alors qu’il part couper des bambous sur la colline, un paysan découvre lové au sein d’une tige de bambou une minuscule princesse. A peine l’a-t-il ramené chez lui qu’elle se métamorphose en bébé : la petite Kaguya. Alors que ses grands-parents adoptifs comprennent immédiatement son origine divine, la fillette se prend d’amour pour la nature qui l’environne et s’aventure avec d’autres enfants au cœur des collines. Malheureusement, persuadés qu’un tel cadeau des Dieux ne pourra pas s’épanouir dans un lieu si reculé, les grands-parents prennent une décision difficile à vivre pour Kaguya, s’installer à Tokyo pour asseoir son statut de princesse.
Comme ses compatriotes de chez Ghibli, Takahata ne veut pas de la 3D. Ainsi, visuellement, Le conte de la princesse Kaguya est un dessin animé à l’ancienne. Mais avec une maîtrise hallucinante et une poésie tout à fait merveilleuse. Tout en crayonné, dense et épuré à la fois, le métrage s’affirme purement et simplement comme une perfection visuelle. A peu près la moitié de la subtilité et de la sensibilité du message que véhicule Takahata passe par l’image et non par le scénario ou la musique. Attention, pas que ces deux éléments soient plus faibles, bien au contraire, mais ils se trouvent amplement magnifiés par la beauté visuelle du dessin animé. Son trait fin et sa vivacité donnent naissance à quelques séquences mémorables dont la plus marquante reste celle de la fuite de la princesse, emportant tout sur son passage et où ses vêtements s’envolent et se fondent aux décors qui éclatent à leur tour. Takahata n’oublie jamais que la beauté visuelle ne doit pas forcément rimer avec prouesse technologique mais avec sincérité et authenticité. De ce côté, le long-métrage s’affirme comme une éclatante réussite.
Puis vient le scénario lui-même. Au-delà de tout son aspect visuel, Le conte de la princesse Kaguya nous invite à suivre le parcours d’une enfant hors du commun et qui, contre toute attente, s’humanise et rejette presque sa nature divine. Plus qu’un simple parcours d’apprentissage, le récit de la fillette jette un regard tendre et surprenant sur le Japon rural, celui des paysans et des petites gens qui peuplent les collines et les forêts. C’est d’ailleurs leur bonté qui les pousse non seulement à recueillir Kaguya et à l’élever mais aussi à tout faire pour la rendre heureuse – du moins ce qu’ils croient être juste pour elle. Ces premiers instants de la princesse, lorsqu’elle est bébé puis quand elle devient enfant, sont simplement des petits moments de grâce où la musique, les images et les réactions des personnages se conjuguent pour créer une magie douce et poignante. Toute cette première partie du film, où Kaguya découvre les collines, la nature et les autres enfants, tout s’avère sublime.
Arrive ensuite le plus gros message du film et certainement le plus intelligent. Arrivée à Tokyo, l’atmosphère du film change imperceptiblement et oscille entre la tristesse de Kaguya et son amour pour ses grands-parents. De façon tout à fait surprenante, le conte se pare d’une modernité stupéfiante et Kaguya devient un symbole du féminisme avant l’heure. Objet de toutes les convoitises, la jeune femme va rendre fou ses prétendants et les repousser un à un avec malice et humour. Dès lors, le conte se fait politique, et déroule son propos sur la place de la femme dans la société du japon féodale. Une femme-objet, cachée derrière des rideaux de bambous, qu’on convoite par vantardise et dont les rumeurs sur sa beauté suffisent à intriguer l’Empereur lui-même. Celui-ci est d’ailleurs dépeint d’une façon tout aussi peu reluisante que les précédents nobles dans une scène magnifique qui fait de nouveau basculer le film.
Si le fantastique semblait en retrait avec l’arrivée à Tokyo, la dernière partie laisse libre cours à l’imaginaire du conte et revient sur les origines de la princesse de la Lune. Dans une explosion de beauté, embaumé par une musique encore une fois parfaite, Kaguya s’envole en même temps que le spectateur. Poétique et déchirant jusqu’au bout, le long-métrage lâche la bride sur son côté mythologique et offre encore quelques séquences oniriques magnifiques (l’arrivée du peuple de la Lune, le vol de Sutemaru et Kaguya) qui renoue avec la beauté des autres long-métrages Ghibli. Les personnages secondaires, complexes et loin de stéréotypes manichéens occidentaux sont également à saluer avant de terminer, notamment les grands-parents, qui font du mal sans le vouloir à la petite fille, et retrouve finalement toute leur bienveillance originelle en fin de métrage. Seul bémol, il est difficile finalement de conseiller aux enfants de voir Le Conte de La Princesse Kaguya, bien que beaucoup plus accessible que Le Vent se lève, le long-métrage n’en reste pas moins assez difficile à comprendre pour les plus jeunes.
Le Conte de la princesse Kaguya fait mieux que le dernier long-métrage de Miyazaki tout en reprenant à son compte une des plus vieilles histoires de la tradition nippone. Simplement enchanteur d’un point de vue visuel, il n’oublie jamais de développer un récit passionnant et d’une intelligence rare. Poétique et simplement fascinant, le bébé de Takahata ne déroge pas à la longue liste de réussites accumulées au fil des ans par les studios Ghibli.
Note : 8/10
Meilleure scène : La soirée de présentation de la princesse et sa fuite votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 27 Juillet 2014 à 12:32


La science-fiction constitue le parfait terrain pour des films atypiques et inattendus. Lorsque le britannique Jonathan Glazer décide d’adapter le roman Sous la Peau de Michel Faber pour le grand écran, on ne suspecte pas à quel point son long-métrage pourra sortir des sentiers battus. Le réalisateur de Birth enrôle la sublime Scarlett Johansson pour interpréter son personnage principal, une femme inquiétante et séductrice qui passe son temps à attirer les hommes qu’elle rencontre jusqu’à une petite maison délabrée pour les piéger et les consommer. Jusqu’au jour où l’un d’eux va changer quelque chose en elle et ainsi va la pousser à s’enfuir loin de ses maîtres. Si dit, comme ça, le scénario semble assez simple, Glazer va pourtant bâtir un long-métrage beaucoup plus difficile à aborder que ne le laissait supposer son postulat de départ.
Glazer frôle le cinéma expérimental avec son Under The Skin. La preuve immédiate en est son « générique » de début avec ce gros plan sur la construction d’un œil qui semble s’étirer indéfiniment. Grossièrement, toute la première moitié du film se bâtit de façon semblable. Le spectateur se retrouve propulser dans une histoire dont il ne comprend pas grand-chose avec une Scarlett Johansson aussi froide que séductrice, semblable à une araignée cherchant inlassablement ses proies. Jusqu’à la première séquence dans la maison, difficile de comprendre quoi que ce soit de ce que l’on voit. Glazer adopte un rythme lent, poussé par une musique hypnotique et lancinante de Mica Levi. Pourtant, par un étrange phénomène, on se retrouve scotchés et fascinés, une sorte de curiosité étrange qui nous pousse à regarder l’écran en nous demandant si tout cela a un sens.
Au fur et à mesure, et sans aucune précision claire, Under The Skin laisse entrevoir son intrigue. Rien ne passe par des mots pour expliquer ce que l’on voit, Glazer abandonne son spectateur et, soyons franc, le perd souvent. L’expérience proposée n’est d’ailleurs pas si aboutie. La répétition de la scène du lac noir, sa radicalité et finalement sa froideur, tout concourt à décrocher. Glazer semble en faire trop pendant cette première moitié du film. Under The Skin gagne peut-être en ambiance mais perd lourdement en accessibilité. Disons-le clairement, on n’est pas loin de l’ennui pur et simple à de nombreuses reprises. Reste le jeu de veuve noir de Scarlett Johansson et sa beauté, juste magnétique, qui contraste avec la laideur et la froideur des lieux qu’elles arpentent. Villes froides, obscures boîtes de nuit ou lotissement abandonné, Under The Skin installe une ambiance de misère et étudie les hommes sous l’angle cru de la pauvreté. Aucun des hommes abordés ne rentre dans les canons de beauté Hollywoodien, c’est même largement le contraire. Et cette banalité de l’être entre en collision avec l’extraordinaire plastique de Scarlett, parfaite pour le rôle.
Puis, arrive un moment charnière. Celui de la rencontre avec l’homme défiguré, un moment de grâce dans le long-métrage, aussi réussi que la première partie était cryptique. La confrontation de Scarlett avec celui-ci a quelque chose de profondément touchant, sa naïveté non feinte et l’authenticité de la misère affective que l’on ressent permet à la scène de se sublimer tout en douceur. Glazer touche à la plus profonde des misères humaines, celle de la solitude. Bien sûr, il serait de mauvaise foi d’oublier le passage sur le bord de mer avec la noyade et l’observation froide et détachée de Johansson, un autre superbe et intense moment du film, bien qu’on y comprenne goutte, ce qui amoindrit son impact …mais revenons au tournant du métrage. Après cette rencontre en apesanteur, Glazer dépasse la répétitivité de son histoire et envoie Scarlett dans une autre direction. Celle de l’émancipation. Dès lors, on comprend bien mieux le rôle de ces étranges motards, sorte de gardiens ou de créateurs selon l’interprétation que l’on choisit au récit.
Glazer emmène alors le spectateur sur le chemin de la liberté et surtout de l’humanisation. Quoi que soit Scarlett Johansson, elle découvre l’humanité qui l’entoure et qu’elle a commencé à apercevoir dans l’homme défiguré. Mais Glazer ne se dépare pas de son obscur sens de la narration. Si l’on comprend que la jeune femme est en fuite et qu’elle découvre petit à petit la bonté humaine, c’est par nous-mêmes Glazer n’emmène toujours personne par la main. Encore une fois, il arrive par moment à toucher le firmament, comme avec cette scène de sexe et la découverte traumatisante que fait Johansson vis-à-vis de son physique et de sa nature. Cette nature pernicieuse qui l’enferme dans son propre corps qui finira par « imploser » dans un final aussi inévitable que tragique. C’est seulement dans ces dernières minutes que l’on peut donner un sens à ce que l’on vient de voir et rendre compte de la sophistication du film. Une complexité qui lui pèse bien trop au final d’autant plus que certaines scènes clinquantes et prétentieuses se glissent dans l’histoire, comme le parcours dans la boîte de nuit, tellement facile. Quant à savoir la nature exacte de Scarlett – xénomorphe ou cyborg ? – le mystère reste à la libre-interprétation du spectateur.
L’énorme handicap d’Under The Skin s’avère également être sa principale originalité. La radicalité du traitement de Glazer sur un sujet de prime abord simpliste accouche d’un film totalement inclassable et difficilement accessible au spectateur lambda. Malgré d’évidentes qualités et des scènes très fortes, le long-métrage du britannique aurait immensément gagné à troquer quelque peu son caractère brumeux contre de petits éclaircissements bienvenus. C’est d’autant plus dommage que ni Scarlett Johansson ni la réalisation n’ont à rougir. Arriver à suivre jusqu’à son terme Under The Skin est une gageure…Vous voilà prévenus !
Note : 6/10
Meilleure scène : Scarlett et le défiguré votre commentaire
votre commentaire
-
Par Nicolas Winter le 25 Juillet 2014 à 13:01

Brad est un adolescent difficile, et c’est peu de le dire. Délinquant à la petite semaine, dealer de drogues et forte tête, sa mère décide de le confier aux bons soins d’un camp de redressement pour mineurs, Coldwater. A sa tête, le colonel Frank Reichert, un ex-marine, qui ne croit qu’en une seule et unique chose, les vertus de la discipline et des sanctions corporelles. Bien vite, Brad se retrouve piégé dans un univers fait de violences et de privations, et il doit apprendre à composer avec les gardiens et ses autres compagnons pour survivre. Mais Coldwater va aller trop loin, bien trop loin, et transformer des adolescents en authentiques monstres…
Illustre inconnu, Vincent Grashaw choisit un sujet difficile pour son premier long-métrage avec Coldwater. En s’inspirant des nombreux camps de redressement pour mineurs qui fleurissent aux Etats-Unis et leur réputation plus que douteuse, Grashaw s’engouffre dans le genre du film prison à l’instar d’un certain Dog Pound. Pour l’occasion, l’américain s’appuie sur une nouvelle et jeune génération d’acteurs avec en tête P.J Boudousqué et Chris Petrovski. La question qui reste en suspens est celle de savoir ce que le cinéaste peut apporter de neuf à un genre assez balisé.
Grashaw bouscule immédiatement son spectateur en nous propulsant avec Brad, enlevé en pleine nuit par les gardiens du camp qui vont l’amener jusqu’à Coldwater sous les lamentations de sa mère. Sans transition ou exposition, on découvre Coldwater avec une séquence à base de sergent-instructeur que ne renierait pas Full Metal Jacket. Frank Reichert s’improvise en caricature cheap du sergent Hartman, mais avec cette même haine et cette même violence qui couve dans sa voix. Le décor est planté, aride et tranchant, où des sales gosses se retrouvent piégés avec d’autres sales gosses, sauf que ceux-ci dirigent le camp. Le récit se scinde alors en deux, avec d’une part des flashbacks pour mettre en place l’histoire de Brad et les raisons qui l’ont amené à Coldwater, et d’autre part le quotidien du camp.
Le gros point noir du film vient en fait du manque d’équilibre entre ces deux fils. Le premier s’avère rapidement cousu de fil blanc mais, pire, coupe le rythme et l’ambiance de la seconde partie du métrage. C’est celle-ci qui fait des merveilles et tend à dénoncer l’ultra-violence comme réponse éducative. Dans le microcosme de Coldwater, Reichert joue une parodie de la formation des marines américains…mais avec des « éducateurs » plus que douteux. On se retrouve plongé dans un simili-camp de concentration où privations et sanctions physiques font office de seules réponses. Ainsi, peu à peu, les adolescents flanchent, déraillent puis finissent par rentrer dans le rang, comme de bons chiens de garde…avant d’endosser le rôle d’éclaireurs (sorte de Kapo au rabais) puis un jour celui de gardiens. Dès lors, le cycle se prolonge et la violence contenue jusqu’ici se retrouve dirigée contre les nouveaux venus. Coldwater fonctionne à la fois comme camp de torture et d’endoctrinement.
Ainsi le parcours du personnage de Boudousqué – excellent dans son rôle, même si un peu trop dans le mimétisme d’un certain Gosling – retrace cette évolution diabolique. Autour de lui gravitent d’autres victimes, comme Jonas, qui payent le prix fort et ne s’intégreront pas dans ce cercle vicieux de cette violence. Malheureusement, ceux qui ne jouent pas le jeu y perdent parfois bien plus. L’autre élément passionnant du long-métrage de Grashaw, c’est le personnage de Reichert incarné par un James Burns en grande forme. Il incarne l’exemple de la rigidité disciplinaire made in America et le glissement (in)humain qu’elle implique. Appliquée sans règles (ou presque) et à des adolescents qui ne peuvent l’assimiler, son ultra-violence ne résout rien. Pourtant, pris lui aussi dans le cycle victime-bourreau, il se révèle incapable de prendre du recul et fonce tête baissée vers l’horreur. Un pur produit de la société américaine en somme.
Le film ne joue pourtant pas la surenchère pendant les trois quarts de son déroulement et tente de dresser un constat amer de cet échec éducatif. Grashaw sait pourtant qu’à un certain moment, il doit arriver à un point de rupture. Celui-ci a lieu avec l’entrée en scène de Gabriel, personnage bancal (peut-être un de ceux qui, de toute façon, n’aurait été qu’un criminel même sans le camp) mais qui catalyse toute la frustration et la haine de ses camarades, notamment Brad. Ainsi, dans une séquence aussi sauvage qu’intenable, la violence éclate et les proies deviennent les chasseurs. Encore une fois on pense à Full Metal Jacket, sauf qu’ici Baleine n’agit pas seul dans les toilettes mais avec toute son unité en plein jour. Cette apothéose pleine de sang et de vengeance incandescente porte le film à son sommet et achève son propos : au lieu de trouver la repentance, les sales gosses sont devenus des monstres, des machines à tuer froides et implacables. Plus qu’un film sur la dénonciation de l’existence de ces camps de la honte, Coldwater analyse l’échec d’un mode de pensée et d’éducation.
Malgré quelques faiblesses structurelles, Coldwater surprend de belle façon. Plus intelligent qu’il n’en a l’air et porté par des gueules de cinéma en devenir, il invite son spectateur dans un gouffre de déshumanisation. Dénonciation en règle d’une pratique communément admise outre-Atlantique, le film de Grashaw est aussi prenant qu’il fait mal. Un impressionnant coup d’essai !
Note : 8/10
Meilleure scène : Le déchaînement de violence finalSuivre l'actualité du site :
Abonnez-vous à la page FacebookSuivez sur Twitter :
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Regardez les étoiles







